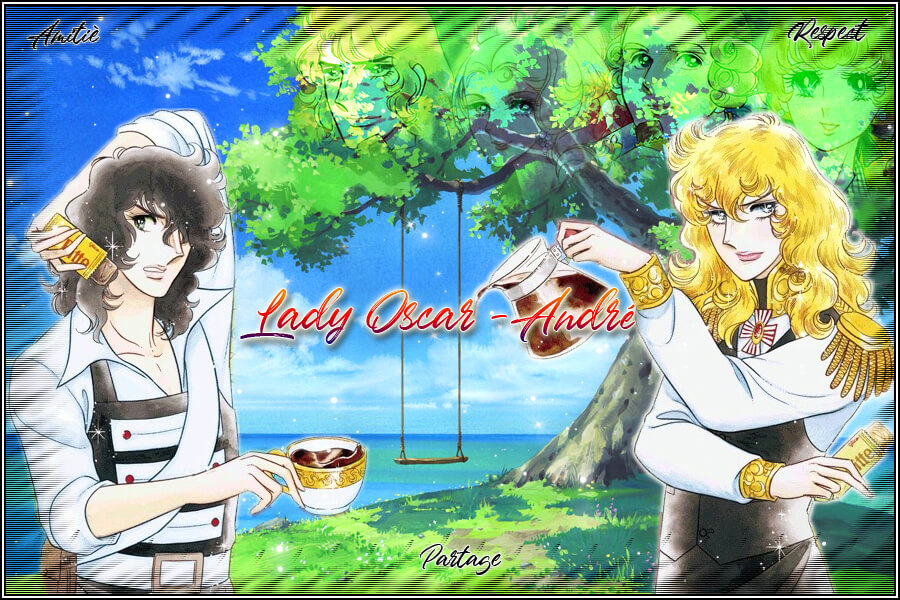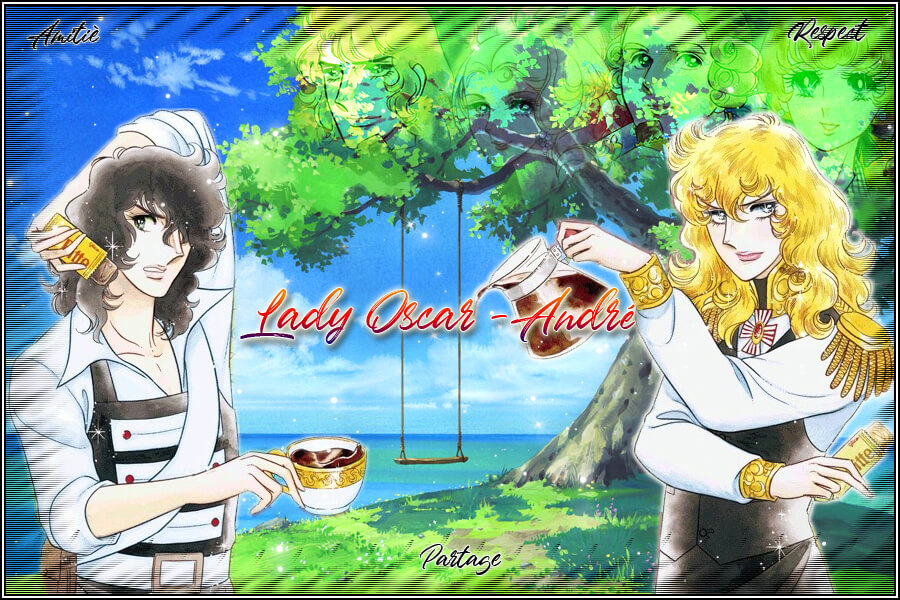
Lady Oscar - André
Forum site Lady Oscar - La Rose de Versailles - Versailles no Bara - Berusaiyu no Bara - The Rose of Versailles - ベルサイユのばら
|
|
| | Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) |    |
| | Auteur | Message |
|---|
Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Lun 11 Mar 2013 - 9:11 Lun 11 Mar 2013 - 9:11 | |
| Oui, bon, pas de titre donc... Ceci est une très vieille histoire que j'ai laissée en hiatus et sans correction depuis sept ans, et qui prenait la poussière dans mon vieux PC. Sur incitation de maria, je commence à la publier ici, mais elle est sujette à corrections (dates, noms des personnages secondaires ou des lieux, etc). C'est mon premier écrit donc il y a sans doute pas mal de maladresses, d'autant qu'elle n'est pas passée par l'étape "correction" et que, si l'intrigue est fixée dans ses grandes lignes, elle ne l'est en revanche pas dans ses détails au delà de ce qui est déjà écrit (une petite trentaine de chapitre...). Et également, il reste sûrement plein de choses à améliorer au niveau de la caractérisation des personnages secondaires... Alors justement, si vous avez des idées pour que je puisse améliorer ça, ou bien alors si vous voyez des imperfections au niveau langage (lourdeurs, ou bien des petits soucis de concordance des temps... j'en ai déjà repris deux ou trois dans le premier paragraphe hier), n'hésitez pas à me les indiquer, je ne demande qu'à améliorer cette histoire... Ah oui, autre chose : le mode de récit est assez particulier. C'est un récit raconté à deux voix (par les deux personnages principaux), chacune à la première personne. Je préfère prévenir parce que certains peuvent trouver cela déroutant. Chaque changement est indiqué par une petite * entre les blocs de texte, et je m'arrange pour mettre dès les premières lignes un indice pour que le lecteur puisse identifier aisément lequel est en train de parler. Mais si toutefois à un endroit donné ce n'était pas clair, dites-le moi également! Merci de vos retours, et je verrai ensuite si j'ai le temps / le courage / l'inspiration, bref, tout ça à la fois pour reprendre et poursuivre cette histoire... Commentaire sur la fic:ici [ Edit du 20 mars 2013 : je viens de mettre un titre de travail (provisoire et assez nul mais au moins un titre un peu plus explicite) à cette fic : "Clément et Cyprien"] *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France)
Dernière édition par Hetep-Heres le Mar 11 Juin 2013 - 22:27, édité 7 fois |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Lun 11 Mar 2013 - 9:21 Lun 11 Mar 2013 - 9:21 | |
| I Je suis né orphelin. Comme Cyprien. Et en même temps. Nés en même temps et orphelins en même temps. Signe, caprice ou hasard, ce ne furent là en tout cas que les premiers des points que nous aurions en commun, à une époque où tout le reste, pourtant, aurait dû nous opposer. Deux cadavres avaient commencé à combler le fossé qui sans cela nous aurait séparé. Et à lier nos destinées. Les cadavres de mon père et de sa mère. Un soir de Mars 1767, lors d’une promenade au crépuscule dans le parc de son domaine, la comtesse de Tanhouët, née Typhaine de Trevinou, fut attaquée à l’intérieur même de sa propriété par un bandit armé d’un pistolet. Alerté par les cris, un charpentier qui réparait les écuries se précipita à la rescousse et se jetant devant elle, il reçut la balle sans doute destinée à la faire taire ; ceci eut d’ailleurs pour effet de faire cesser les cris de la comtesse, que cette fois rien ne put protéger du coup de feu mortel que l’inconnu prit le temps de tirer avant de s’enfuir en emportant les bijoux qu’elle portait ce soir-là. La malchance avait voulu que les Granville de Tanhouët aient regagné leur manoir le jour même, après avoir passé l’hiver à Rennes, afin que leur premier enfant qui devait naître quelques semaines plus tard vînt au monde en leur fief de Tanhouët, comme les générations de Granville de Tanhouët l’ayant précédé. La veille encore, en l’absence des maîtres de maison, la vigilance de la domesticité était plus relâchée ; le pillard avait dû, lors de ses repérages, trouver là une cible facile pour ses méfaits. Quel malheur qu’il eût malgré ceci porté une arme ce soir-là… Le comte, alerté par les détonations, n’arriva sur place que pour voir au loin s’enfuir le tireur. Il ne put que constater la mort de mon père mais fit quérir de suite un médecin pour son épouse, qui avait perdu connaissance mais dont le pouls battait encore. Cependant, elle avait reçu la balle en pleine poitrine et il n’y avait que très peu d’espoir pour sa survie. Arrivé sur les lieux, le médecin déclara ne plus pouvoir rien tenter pour sauver la comtesse, mais osa proposer une idée audacieusement insensée : il allait faire naître l’enfant sur le champ, par une délicate chirurgie, afin de lui donner une maigre chance de survie. Et contre toute attente il survécut. On le baptisa Louis Yves Cyprien. * Je n’ai jamais eu de mère. Je n’ai pas connu la mienne, et mon père ne s’est pas remarié. Si je peux aujourd’hui avoir la moindre idée de ce que peut être la caresse d’une main maternelle c’est par la tendresse que m’a témoignée la mère de Clément. Elle fut ma nourrice dès mes premiers jours, et ainsi Clément et moi grandîmes en frères de lait. De nous deux je suis l’aîné, mais de quelques heures seulement. Lorsque l’on vint annoncer la mort de Valentin Guermeur à sa femme, je venais tout juste de naître. Elle-même attendait un enfant qui devait venir au monde d’un jour à l’autre. Apprenant ce qui était arrivé à son mari, elle ne voulut d’abord y croire et se précipita sur les lieux. Était-ce cette course effrénée, la vue de son époux allongé sur le ventre, les bras le long du corps, puis du trou noirâtre entre ses yeux clos, ou alors le moment était-il tout simplement arrivé ? Toujours est-il qu’elle ressentit alors les premières douleurs annonçant son accouchement. Mon père, malgré son égarement, eut toutefois la présence d’esprit de la faire de suite transporter au château et c’est ainsi que Clément naquit sous le même toit que moi, mis au monde par celui-là même qui m’avait délivré quelques heures plus tôt. Mon père se sentit sans doute redevable envers la veuve et l’orphelin de celui qui donna sa vie pour secourir ma mère. Et bien que ce sacrifice fut vain, j’aime à croire que ces deux hommes nous firent là le plus grand des cadeaux, car sans cela Clément et moi n’aurions pas eu la vie qui fut la notre. Nous n’aurions pas grandi ensemble, nous aurions été deux âmes seules. En effet, je n’avais plus de mère, et Lucie Guermeur se retrouvait veuve et sans ressources pour élever son enfant. C’est donc sans hésiter que mon père lui proposa d’entrer à son service pour devenir ma nourrice. Frappées par le même malheur, nos deux familles s’étaient donc retrouvées désormais liées. Hélas l’avenir fut bien court pour notre chère Lucie qui s’éteindrait onze ans plus tard, laissant son fils à nouveau orphelin. Orphelin mais pas seul. Jamais mon père n’aurait envisagé que Clément fût alors séparé de nous. On fit venir ma grand-mère maternelle qui venait de perdre son époux peu de temps auparavant et se retrouvait donc veuve elle aussi. Il y avait dix ans qu’il n’y avait plus eu chez nous de maîtresse de maison, elle se chargea donc des affaires domestiques, ainsi que de moi par la même occasion. Et donc de Clément, puisque l’un n’allait jamais sans l’autre. * Du plus loin que je me souvienne, Cyprien a toujours été grand et fort. Un garçon d’une belle stature qui en imposait par sa présence. Je lui ai si souvent envié sa prestance, moi qui depuis toujours suis de constitution frêle, voire fragile. Déjà, lorsque nous étions bébés, il s’était très bien remis de sa naissance prématurée alors que le nouveau-né chétif que j’étais avait mis plusieurs semaines à prendre des forces. Je crois que c’était moi qui subissais le contrecoup du choc reçu droit au cœur, droit à l’âme par ma mère au soir de ma naissance. Elle, pour sa part, devait alors s’occuper de deux bébés à la fois, dont l’un malade, ce qui lui permettait sans doute de moins penser. Moins penser à mon père, moins penser à leur avenir ensemble qui n’existait plus, disparu dans la fumée d’un coup de pistolet. Si c’est là ce qui lui permit de tenir bon à cette époque, alors je ne regrette nullement d’avoir pris sur ma personne sa part de faiblesse. Je déplore seulement de lui avoir ainsi causé des soucis supplémentaires, la pauvre femme souffrant déjà bien assez comme cela. Mais elle ne fléchit pas et je survécus. Cyprien était clairement de nous deux le plus fort. Je devais donc devenir le plus adroit afin de ne plus le jalouser, même si je mis encore bien des années à faire complètement taire en moi ce désagréable et quelque peu honteux sentiment. Enfants, lorsque nous apprenions à croiser le fer, il avait toujours le dessus. Normal, et injuste à la fois me disais-je, car j’étais plus petit et chétif que lui. Eh bien puisque j’étais plus léger, je serais plus vif, plus rapide à esquiver. Je ne sais si mon raisonnement était exact, mais nous nous retrouvâmes de même niveau à l’épée. Et tout aussi assidus à l’étude. Ma mère se moquait gentiment de notre concurrence, elle disait que des amis feraient mieux d’être complémentaires que similaires, mais voilà bien le genre de propos que l’on ne veut entendre lorsque l’on est enfant. Pourtant derrière son sourire indulgent se cachait une inquiétude : elle ne pouvait ignorer ce dont nous n’étions pas encore conscients, à savoir que le genre de vie que nous menions pour l’instant ensemble ne durerait qu’un temps. Jamais nous ne serions à égalité. Arriverait un jour où Cyprien irait vers les charges et fonctions de son rang, et où j’entrerais à son service. Mais à l’époque, et bien que conscients de la différence de rang entre nous, nous ne nous réalisions absolument pas ce qu’elle impliquait concernant notre avenir et nos rapports futurs. * Mon avenir était déjà décidé la nuit même de ma naissance. Un destin est comme une averse qui vous tomberait dessus dès votre premier cri de nouveau-né. Personne ne peut la commander, nul n’a prise sur la pluie, on la prend telle qu’elle vient. Dès que l’on vit que j’étais un garçon, n’importe quel membre de la maisonnée aurait été capable de raconter ma vie avant même que celle-ci se fût déroulée : élevé dans la douceur de la campagne bretonne, je recevrais une éducation des plus soignées qui me préparerait à faire les études de droit que mon père suivit dans sa jeunesse. Études qui une fois achevées, voire même avant, et combinées à l’achat d’une charge, me permettraient d’occuper un poste d’abord modeste, peut-être même uniquement honorifique, en attendant de succéder à mon père en héritant de sa charge de conseiller au parlement de Bretagne. Il était le second garçon d’une famille issue de la noblesse de robe. Son frère aîné, peu désireux d’évoluer dans le milieu de la Robe et de suivre les pas de leur père au parlement, s’était destiné contre l’avis de celui-ci au métier des armes et y avait très tôt laissé la vie. N’ayant qu’un fils et ne désirant ni voir de la sorte s’éteindre notre famille, ni perdre son enfant, mon père n’avait bien évidemment jamais envisagé pour moi la carrière militaire. Il croyait d’ailleurs plus à la pérennité de la plume, et se disant qu’il se trouverait toujours assez de soldats pour défendre le Royaume, il pensait qu’il fallait plutôt lui fournir des étudiants qui plus tard le feraient fonctionner. Il avait consacré sa vie à sa charge. Veuf une première fois très jeune, sans enfant, il ne s’était remarié que tardivement, à la mort de son propre père, prenant sans doute alors conscience de son devoir de perpétuer notre famille. Il avait jusque là vécu pour sa charge et venait tout juste de prendre conscience des bonheurs de la vie de famille auprès de ma mère lorsqu’il la perdit. Il se replongea alors de toute la force de sa souffrance dans les dossiers et les piles de documents au milieu desquels je l’ai toujours vu. Oui, du plus loin qu’il me souvienne il tenait toujours quelque papier dans les mains, excepté bien sûr au cours des repas. Je le trouvais important avec sa plume à la main et ses besicles sur le nez. Et lorsque j’étais enfant, ce n’était pas sans une certaine fierté que je me disais qu’un jour j’aurais moi aussi cet air impressionnant de présider aux destinées de quelque problème crucial. Pourtant je n’avais encore à l’époque pas la moindre idée de la nature de ce dont il s’occupait. Pour moi, puisqu’il était dans ces papiers question de sujets autres que ceux que nous abordions durant nos leçons, ceux-ci ne pouvaient qu’être d’une importance extrême. * Me trouvant trop chétif, trop petit, mais aussi se targuant de sa position d’aîné, Cyprien avait souvent voulu me surprotéger. Il devait sans doute me penser trop faible pour encaisser les difficultés. Il lui était arrivé plusieurs fois de s’accuser d’une bêtise que j’avais commise afin de m’éviter le sermon et la punition. Sans doute savait-il aussi qu’il serait un peu moins puni que moi. Ma mère avait tendance à en exiger plus de moi, ainsi qu’on le fait souvent avec ses propres enfants. Elle devait aussi penser qu’à l’âge adulte il me serait bien moins pardonné qu’à lui. Ce devait être sa façon de me préparer à la vie réelle. Mais Cyprien et moi avions trouvé le moyen de contourner ce système, car je me gardais alors bien de me dénoncer. Je crois même que, sans qu’il aille jusqu’à en tirer une certaine fierté, cela flattait son imaginaire chevaleresque d’une amitié renforcée dans l’épreuve. Et sans doute ne pouvait-il également se départir d’une certaine vision du suzerain protégeant son vassal. Comme nous tous, il aimait à se donner le beau rôle, et le héro injustement éprouvé pour un noble sentiment rejoignait tout à fait l’idéal courtois que nous nous étions forgé. Mais je crois également qu’il cherchait là à se racheter de ce que le sort l’avait favorisé par rapport à moi. Il était plus riche, plus fort, et d’un rang plus élevé. Il avait déjà conscience d’avoir de plus beaux jouets que moi, de plus beaux livres, et de parfois porter de plus beaux vêtements. J’étais moi aussi conscient de cela. Mais pour rien au monde je n’aurais voulu laisser paraître que je l’enviais. D’abord parce que je refusais moi-même de l’admettre, ensuite parce qu’il n’y avait pas de quoi en être bien fier. Je m’en voulais de le jalouser ainsi, et lui en voulais de me donner des raisons de le faire. Je savais pourtant fort bien qu’il n’était pour rien dans cette affaire. Je faisais donc celui à qui tout ceci était parfaitement indifférent. Mon Dieu, il y avait pourtant en moi tellement de colère lorsque j’avais une dizaine d’années ! Je me souviens d’un jour où il avait reçu de sa tante, la sœur de son père, un magnifique coffret de soldats de plomb. J’étais resté à les admirer avec lui un par un, détail après détail, mais ne lui avais plus adressé la parole pendant les deux jours qui suivirent, durant lesquels je cherchais sans cesse à fuir sa compagnie. Il n’a jamais su pourquoi, du moins je l’espère. Mais on a tort de croire qu’un enfant oublie plus vite qu’un adulte. Pourtant, même opposés, même parfois en conflit, nous ne pouvions nous passer l’un de l’autre, comme s’il y avait eu entre nous un lien invisible, sans que personne n’y pût rien. Car même inégaux nous étions amis, et même adversaires nous restions frères. * C’est une chose bien étrange de constater comme un grand malheur peut en vous frappant vous apporter également le plus beau des cadeaux que puisse vous faire la vie. Si ma mère n’était pas morte, si son père n’était pas mort, jamais il n’y aurait eu aucune raison que Clément et moi devinssions frères. Peut-être même ne nous serions nous jamais connus. J’ignore encore si derrière cela se cachait un dessein secret ou si ce qu’il advint de nous fut le simple fruit du hasard. En d’autres termes, j’ignore si le destin ou la fatalité existent vraiment. Il est frustrant de croire que nous ne sommes que les interprètes d’une partition déjà écrite, comme des comédiens jouant une pièce à la virgule près. Pourtant, au vu du déroulement préétabli de ma vie tout au long de ma jeunesse, la réponse semblerait s’imposer d’elle-même. Toujours est-il, destinée ou pas, que Clément et moi devînmes, de ce jour, chacun notre autre. De ce jour notre histoire fut commune. De ce jour nous fûmes comme des jumeaux inégaux, asymétriques. Il devint une partie de moi différente de moi. Plus les années passaient et plus nous prenions conscience à la fois de nos ressemblances et de nos dissemblances. Comme des choses naturelles. Si nous avions été chacun l’exacte réplique de l’autre, je ne suis pas certain que nous serions devenus si proches. On supporte tellement moins bien ses propres défauts chez autrui que chez soi-même. S’il est une chose dont je sois sûr, c’est que ce fut une chance de grandir avec Clément. Mon père s’était dit qu’il serait pour moi un compagnon de jeux, et il est vrai qu’il était le seul autre enfant de mon entourage. Sans lui j’aurais grandi dans un monde composé uniquement d’adultes. Mais je fus également chanceux que ce compagnon fut Clément. Avec tout autre je ne me serais probablement pas tant lié. Étrange chose que l’amitié : pourquoi s’attache-t-on plus à telle personne qu’à telle autre ? On peut bien sûr tout de suite répondre par les qualités de cœur qu’on reconnaît à cet autre : son calme, sa fidélité sans faille, la confiance dont il était digne, son courage, tout ceci a contribué à lui apporter mon affection. Mais s’ajoute aussi à cela cette part d’indescriptible et d’irrationnel que l’on n’explique pas et sans laquelle on ne se sent pas aussi proches. Et je veux croire que cet inexplicable n’est pas dû au sang versé le jour de nos naissances. Je veux croire que chose si belle n’est pas établie sur chose si laide. * Yves Louis Marie de Granville, comte de Tanhouët, était conseiller au Parlement de Bretagne qui siégeait à Rennes. Il partageait donc son temps entre son hôtel particulier rennais, le château de Pacéniac dont son grand-père avait fait l’acquisition plusieurs décennies auparavant dans les environs de Rennes et son fief de Tanhouët, berceau de la famille, situé en basse Bretagne. Le manoir de Tanhouët était à la base une gentilhommière qui, au fil des générations, avait été embellie et agrandie jusqu’à pouvoir finalement prétendre au nom de château. Elle était entourée d’un parc dans lequel était aménagé un jardin ceignant la demeure fait d’allées, de terrasses, de pelouses et de massifs de fleurs. Le reste du parc était planté d’arbres, surtout des châtaigniers, des marronniers et des chênes, mais aussi quelques pins. Au fond de ce parc un potager et un petit verger fournissaient la maisonnée en fruits et légumes. Enfin, la propriété était entourée d’un mur d’enceinte en granit de presque deux toises de haut. Le manoir était situé à une demi-lieue de la côte par le plus court chemin. A l’opposé, le village de Kertanhouët, distant d’une lieue, était le plus proche. Nous passâmes là le plus clair de notre jeunesse, confiés aux bons soins de ma mère. La gestion des terres était, elle, confiée à monsieur Mahé qui avait succédé à son propre père au poste d’intendant. Le comte, était lui souvent à Rennes, mais préférait que Cyprien soit élevé dans sa contrée natale ainsi que lui-même l’avait été. Lorsqu’en 1765, suite à l’opposition parlementaire au pouvoir royal, les membres du parlement de Bretagne démissionnèrent, le Comte revint s’établir à Tanhouët, sans pour autant négliger d’effectuer quelques séjours à Rennes. Le parlement fut rétabli dans ses droits quelques temps plus tard, mais en 1771 un nouveau coup de force du roi conduisit à une nouvelle démission en masse des parlementaires qui ne seraient ensuite rétablis qu’à l’avènement du nouveau roi en 1774. Ce genre d’évènement se répéta en 1775 puis en 1788. Notre jeunesse campagnarde se déroula donc assez loin de la guerre parlementaire livrée contre les menées absolutistes du pouvoir, et dont nous ne percevions les développements qu’au travers des allées et venues du comte au gré de ses rebondissements, prémisses de bouleversements plus grands encore que ce que l’on aurait alors pu l’imaginer. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France)
Dernière édition par Hetep-Heres le Dim 17 Mar 2013 - 22:12, édité 2 fois |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Mar 12 Mar 2013 - 13:35 Mar 12 Mar 2013 - 13:35 | |
| II Nous devions avoir à l’époque dans les sept ou huit ans. Cyprien et moi-même cherchions bien entendu par tous les moyens à obtenir de ma mère qu’elle nous laissât vaquer à nos jeux sitôt finies – expédiées ? – les leçons dont nous nous sentions accablés. Vivant non loin de la côte, nous avions fait des bords de mer notre terrain de jeux, presque au même titre que le parc du château. Les rochers et leurs escarpements nous fournissaient nombre de recoins qui nous étaient tour à tour grottes à explorer, repaires de brigands, maisons connues de nous seuls, cachettes aux fabuleux trésors. Nous n’avions qu’à tremper un pied dans l’océan pour alors presque apercevoir, là, à l’horizon, l’or du Pérou et le cacao des Amériques. En vérité nous avions en face de nous plutôt la côte sud de l’Angleterre que la côte est des Amériques, mais cela ne suffisait pas à satisfaire notre soif de rêves, de merveilleux et d’aventures. Nous nous imaginions alors corsaires aux Caraïbes ou explorateurs au Mexique. Nous passions également des heures à narguer le flux et le reflux, à ramasser des bigorneaux ou à tenter d’attraper les crevettes laissées par la marée descendante dans les petites et moyennes flaques au creux des rochers. Ma mère nous disait bien qu’il était dangereux d’y aller lorsque le vent forcissait, mais nous n’avions jamais tant envie de descendre à la grève que les jours où cela nous était interdit.
Un soir d’automne, alors que nous étions tous deux penchés sur un des livres de Cyprien, devant la cheminée de sa chambre, nous entendions le vent faire trembler les carreaux si fort que l’on aurait pu croire qu’au dehors, Éole soufflait de toute la force de ses poumons contre nos fenêtres. Le soleil couchant offrait à la façade ses derniers rayons, qui nous parvenaient à travers les vitres. Devant les gravures représentant la faune et la flore des lointaines Antilles, nous rêvions aux formidables combats navals qu’avaient livrés d’héroïques marins pour défendre nos colonies face aux Hollandais, aux Anglais, aux Espagnols. Les épopées tenaient alors une place de choix dans notre imaginaire. On aime tant entendre parler de terres inconnues et d’aventures épiques lorsqu’on est un petit garçon couvé par sa mère ou par sa nourrice, et qu’on ne s’est jamais rendu plus loin qu’à une vingtaine de lieues de chez soi.
Le mouvement des arbres au dehors nous parvenait par les tremblements des rayons de lumière qui éclairaient les images que nous étions occupés à contempler. Le vent soufflait ce soir-là plus fort encore qu’au cours de la journée écoulée. Cela faisait déjà quatre jours que nous n’avions pas eu le droit de nous rendre à la grève et comme toujours cette interdiction n’avait fait qu’attiser notre envie d’y aller jouer. Il était pourtant bien des fois auparavant où nous aurions été autorisés à nous y rendre et où cependant nous nous étions contenté du château et de son parc, et ce plus d’une semaine durant. L’homme est ainsi fait qu’il ne désire jamais rien tant que ce dont on le prive.
Il ne me souvient plus duquel de nous deux lança le premier l’idée d’aller jouer au corsaire et au pirate sitôt qu’on nous le permettrait. Toujours est-il que nous nous retrouvâmes à discuter de l’opportunité de braver l’interdit et de s’y rendre sur le champ.
– C’est terriblement ennuyeux, dis-je alors, de devoir rester ici tandis que la mer doit être si belle. Imagine donc comme les vagues doivent être grandes, et le bruit qu’elles font sûrement en éclatant sur les rochers !
– Et je suis sûr qu’il doit y avoir des gouttes projetées jusqu’au fond de la caverne du grand serpent, compléta Cyprien. Et on peut sûrement sentir les embruns depuis le sentier !
– Eh bien alors, allons-y ! J’imagine que c’est un soir comme celui-ci que les flibustiers doivent choisir pour se rendre à leur cachette. Avec un bruit pareil, ils savent qu’ils risquent moins de se faire repérer. Et avec un peu de chance, en nous cachant bien nous les verrons passer, et nous n’aurons alors plus qu’à les suivre pour aller ensuite nous emparer de leur butin.
– Ma foi, répondit alors Cyprien, je trouve que c’est assez bien raisonné, mais tu oublies que ta mère nous a défendu d’y aller.
– Et après ? Tu crois que ça aurait arrêté un Cassard ou un Duguay-Trouin ? Tu crois peut-être qu’ils demandaient l’autorisation à leur nourrice avant d’aller courser l’Anglais ?
– Tout de même, hésita-t-il encore, si nous étions pris, je n’ose imaginer combien de temps nous serions consignés, et séparément qui plus est !
– Oh, mais de quoi as-tu peur ? De ma mère ? A moins que ce ne soit de la mer. Alors, ma mère ou la mer ? C’est ça, avoue, tu as la frousse d’y aller, avec tout ce bruit qui siffle, et l’obscurité qui commence à tomber.
– Je n’ai pas du tout peur ! répliqua-t-il piqué au vif. Je sais d’ailleurs fort bien que ces bruits ne sont dus qu’au vent et à rien d’autre, et je n’ai pas du tout peur du noir ! Mais si je me souviens bien, c’est toi qui l’autre jour ne voulait plus mettre les pieds au grenier à cause des craquements qu’on y entend la nuit. Tu croyais qu’il y avait des revenants.
– C’était l’an passé, crus-je bon de préciser pour ma défense, et je n’ai jamais eu peur des fantômes, je sais fort bien qu’ils n’existent pas. Et puis ne change pas de sujet, c’est toi qui es trop couard pour sortir ce soir, tu as bien trop peur de ce que dirait ton père.
– Couard, moi ? J’ai nettement moins peur de mon père que toi ! Ni de ta mère !
– Eh bien c’est parfait ! Rien ne nous retient donc prisonniers dans cette chambre ce soir. !
– Si, tu oublies que ta mère nous a défendu de sortir.
– Mais nul n’en saura rien ! Nous ferons mine de nous mettre au lit ainsi que nous le faisons tous les soirs, nous relèverons ensuite et partirons juste après !
– Oui, tu as raison, et nous descendrons par l’escalier de service, mais séparément. Si quelqu’un voit l’un de nous, il n’y aura qu’à trouver un prétexte simple et crédible pour être redescendu vers l’office...
* Nous fîmes ainsi que nous avions arrêté. Clément sortit le premier, cinq minutes après avoir souhaité la bonne nuit à sa mère, et je le rejoignis un quart d’heure plus tard au rendez-vous que nous nous étions fixé au pied d’un châtaignier planté à proximité du mur d’enceinte. Ne restait plus alors qu’à y grimper, exercice que nous pratiquions presque quotidiennement, puis à progresser à tour de rôle le long d’une branche dont l’extrémité atteignait l’autre côté du mur. Malgré l’habitude que j’avais de cette gymnastique, ce ne fut pas sans une certaine difficulté que je l’accomplis, car j’étais encombré par la lanterne que j’avais pensé à emporter ; je dus la tenir à la bouche, l’anneau serré entre mes mâchoires afin de libérer mes mains. Une fois arrivé au bout, il suffisait de se suspendre puis de se laisser tomber de trois fois notre taille pour atterrir à l’extérieur de la propriété. C’est seulement à cet instant-là que je pensai à demander à Clément s’il avait rencontré âme qui vive en sortant de la maison. Il me répondit qu’en descendant l’escalier il avait croisé Jean-Baptiste, le valet de mon père : il lui avait raconté avoir oublié de dire quelque chose à sa mère qui se trouvait à l’office. Par chance, Jean-Baptiste y avait effectivement aperçu Lucie en passant, sans quoi le mensonge de Clément aurait pu entraîner l’échec de notre expédition nocturne avant même qu’elle eût débuté.
Nous courûmes jusqu’à la grève et nous enfonçâmes entre les rochers qui faisaient fièrement face aux flots déchaînés ; malgré l’obscurité qui nous privait de la majeure partie du spectacle – ou bien alors grâce à elle, je ne saurais trop le dire – la scène qui se dessinait, se mouvait, se jouait devant nos yeux était absolument fascinante. Des masses informes se découpaient au gré des nuages sur un fond tantôt noir comme de l’encre, tantôt scintillant des milliers de reflets mouvants et sautillants de la lune que la surface tourmentée de la mer renvoyait, comme autant de piécettes d’argent ou de diamants taillés d’innombrables facettes. Lorsque les nuages étaient chassés, on voyait les eaux sombres se gonfler et former d’énormes creux et crêtes au sommet desquelles moutonnait l’écume. Elles se rapprochaient de la rive et venaient alors se fracasser sur les rocs, qui supportaient solidement cet assaut tandis que la vague audacieuse était éparpillée en milliers de gouttelettes dans toutes les directions en un vacarme assourdissant. Tapis au creux d’un trou laissé dans la roche, nous sentions notre visage et nos cheveux se faire mouiller de plus en plus à chaque explosion de vague sur le granit.
Cependant à cet âge-là, on se lasse souvent bien vite de la contemplation de la nature, même devant les plus spectaculaires représentations que celle-ci puisse offrir. Je touchai alors le bras de Clément et lui proposai d’aller nous poster à l’aplomb de la caverne du Grand Serpent afin de surveiller les éventuelles allées et venues dont elle serait le théâtre. Il tourna vers moi un visage interrogateur, me signifiant par son expression qu’il n’avait pas saisis ce que je venais de dire, et je dus le lui répéter en criant pour que ma voix surmontât le fracas des vagues éclatant sur le granit et le souffle du vent rugissant à nos oreilles.
Ce que nous avions bien pompeusement baptisé "Caverne du Grand Serpent" n’était en fait qu’un espace d’une profondeur tout juste suffisante pour que l’un de nous s’y tînt allongé, et tout juste assez haut pour s’y tenir accroupi. Situé en contrebas du sentier, il était formé de deux rochers obliques qui semblaient prendre appui l’un sur l’autre, aménageant ainsi une sorte de toit recouvrant un sol de sable. Un autre rocher en bouchait verticalement l’extrémité côté terre, tandis que l’autre était ouverte vers la mer. Un poste d’observation idéal dans lequel nous avions passé des heures à guetter les mouvements de navires. Sur la paroi du fond, un repli de la roche formait une sorte de S majuscule, dont notre esprit fertile fit la représentation d’un serpent. Notre imagination accomplit le reste : cette marque ne pouvait qu’être les armes d’un animal mystérieux dont le repaire était fermé par cette imposante masse rocheuse. Clément et moi savions bien que derrière ce mur de granit se cachait une sorte de grand serpent fabuleux. Cependant, malgré des heures de faction tant à l’intérieur que tapis à la sortie de la "caverne", ni l’un ni l’autre n’étions parvenu à l’apercevoir, et nous en avions fort logiquement conclu que la bête devait être bien trop peureuse pour s’aventurer au dehors. En conséquence de quoi il n’y avait absolument rien à craindre à s’installer en ce lieu.
* – Dis-moi Cyprien, demandai-je au bout d’un moment, tu crois vraiment que la caverne sert de cachette aux flibustiers ?
– Aux flibustiers, aux contrebandiers, aux voleurs de grand chemin, que sais-je ? Ce dont je suis certain, c’est que si j’étais l’un deux, je ferais garder mon trésor par le Grand Serpent, pour que personne n’ose s’en approcher.
– Sauf que le Grand Serpent ne met jamais le bout de la queue hors de son repaire. Même nous, nous ne l’avons jamais vu. Alors tu penses bien que ça ne me fait absolument pas peur d’aller dans la caverne. Quant aux autres, ou ils ignorent même qu’il y a un serpent ici, ou bien comme maman ils refusent d’y croire.
– En tous les cas, notre poste d’observation est idéal. Nous verrons bien si quelqu’un passe et où il va. C’est d’ailleurs bien ce que tu proposais de faire tout à l’heure !
– Tout à l’heure nous étions secs et à l’abri des rafales. Et puis je commence à en avoir assez d’attendre. Je m’ennuie ici, il ne se passe rien, tu le vois bien. Si des brigands cachent leur butin par ici, ils ne viendront pas ce soir : impossible d’arriver jusqu’ici par bateau, la mer est bien trop grosse.
– Et pourquoi veux-tu qu’ils arrivent par la mer ? S’il s’agit de voleurs ordinaires, ils viendront des terres, comme nous.
– Mais d’ailleurs, qu’est-ce qui nous dit qu’il y a vraiment des brigands qui viennent là ?
– C’est toi-même qui l’as dit tout à l’heure, des flibustiers ou des contrebandiers qui cachent leurs marchandises ici.
– Oui, eh bien à présent je n’en suis plus si certain. Ils seraient déjà venus.
– Ça ne doit faire guère plus d’une demi-heure que nous sommes là, comment peux-tu déjà dire qu’ils ne viendront pas ?
– Oh, tu m’ennuies ! Et puis je suis sûr que nous attendons depuis bien plus longtemps que ça !
– Arrête de crier ainsi, tu vas nous faire repérer ! Il n’y a rien d’étonnant à ce que personne ne se montre avec le bruit que tu fais !
– Ah oui ? Eh bien je ne vais plus te gêner très longtemps : j’en ai plus qu’assez, je rentre !
– Comment ça, tu rentres ? Mais je te rappelle que c’était ton idée de venir ici.
– C’est toi qui en as parlé le premier, qui te plaignait de ne pas être venu à la grève depuis des jours !
– Mais c’est toi qui as insisté pour y aller ce soir.
– Oui, eh bien nous y sommes venus. Et maintenant que nous avons fini de jouer, nous pouvons rentrer !
– Tout ça c’est des histoires. La vérité c’est que tu as peur. Alors, dis-moi maintenant lequel de nous deux fait montre de couardise ?
– Je n’ai pas peur du tout. J’en ai simplement assez, et de plus, je commence à avoir un peu froid. Je m’en vais.
– Tu ne vas pas me laiss– …euh… tu ne vas pas partir tout seul ?
– Et après ? Je suis assez grand pour me débrouiller par moi-même !
Et je partis en laissant Cyprien dans notre cachette. Je n’avais fait que quelques pas lorsque j’entendis « Eh, Clément, reviens ! », mais comme j’avançais toujours il ajouta « Oh, et puis fais comme tu voudras ».
La nuit était à présent complètement tombée et, une masse de nuages épais masquant la lune, l’obscurité était totale. Je tâtonnais de rocher en rocher pour rejoindre la grève le long d’un parcours que Cyprien et moi connaissions presque par cœur pour l’avoir emprunté bon nombre de fois. Mais jamais encore dans le noir. Je sentais les gouttes d’eau salée m’arriver de côté, et la partie gauche de mon corps était à présent complètement trempée. De temps à autres, une bourrasque me faisait vaciller mais je parvenais à me rétablir. Je progressais lentement, m’appuyant autant sur mes mains que sur mes pieds. À tâtons, je reconnaissais certains points de repère. Là, sous ma paume gauche, l’arrondi du rocher où nous venions souvent pêcher la crevette. Il fallait donc grimper sur celui de droite dont j’allais trouver, à hauteur du genou, le creux qui pouvait faire office de marchepied. Voilà. Maintenant, deux ou trois pas droit devant puis descendre sur un autre rocher plus petit en contrebas. Aïe, je venais de trouver sous mon pied une flaque ne se trouvant pas là habituellement. Sans doute due aux marées plus fortes de ces jours-ci. J’avançai encore très lentement jusqu’à me retrouver en un endroit que je ne reconnus pas du tout. Les rochers qui auraient dû s’y trouver semblaient remplacés par d’autres dont les formes, les contours m’étaient inconnus. J’avais beau tâter, ces creux et ces bosses ne m’évoquaient aucun souvenir. N’y voyant rien, je me cognais sans cesse les tibias et les genoux en tachant de me déplacer. J’étais trempé, j’avais froid, le vent sifflait à mes oreilles en m’étourdissant, je ne voyais rien du tout, mes genoux me piquaient et me brûlaient, et je ne savais pas où j’étais. Je crois bien que je me mis alors à pleurer.
* Clément était parti en me laissant seul. Le jeu venait de perdre beaucoup de son intérêt et guetter seul les pirates me paraissait bien moins prudent qu’à deux. Bien évidemment, je n’avais pas réalisé que deux enfants n’avaient guère plus de chances qu’un seul face à de véritables brigands armés, tant nous nous sentions bien plus que deux fois plus forts lorsque nous étions ensembles. Là, dans la pénombre, à la seule lueur de la lanterne que nous avions plus ou moins bien tamisée, l’attente avait perdu beaucoup de ce qu’elle avait pu avoir d’excitant, et je décidai donc de rentrer à mon tour, mais en prenant tout mon temps afin que Clément ignorât que mon départ avait suivi de si près le sien. Je progressais de rocher en rocher lorsqu’au milieu des bourrasques et du fracas des vagues me parvint une voix. Je m’arrêtai pour écouter et il me sembla cette fois distinguer mon prénom. Je tendis l’oreille et j’entendis alors « Cyprien ! Où es-tu ? Cyprien, aide-moi, je me suis perdu ! Cyprien ! »
Je levai ma lanterne pour tâcher d’apercevoir Clément en portant mon regard dans la direction d’où m’avait semblé provenir sa voix. Rien. La lanterne n’éclairait pas assez loin. Je me déplaçai alors en me guidant à ses appels.
– Clément, où es-tu ? Parle-moi ! Clément ?
– Cyprien, par ici !
– Clémeeeent !
– Cyprieeeen !
– Clément ! Je ne te vois toujours pas !
– Cyprien, j’aperçois une lumière ! Est-ce que c’est toi ? Si c’est toi, fais monter et descendre la lanterne !
Le vent me portait ses paroles, mais il ne devait entendre que faiblement les miennes. Je me rapprochais peu à peu de la mer en suivant la direction dans laquelle je le cherchais. J’étais maintenant tout près du bord et j’éclairai la zone se trouvant à mes pieds afin d’éviter de trébucher contre un obstacle. Je vis soudain une grosse vague arriver, mais il était trop tard pour faire un écart. Je fus renversé par une masse d’eau qui me parut énorme, puis me sentis entraîné par le reflux le long de la roche. Ma joue fut entaillée par les minuscules coquillages accrochés au granit, mais je ne le sentis pas. J’étais trop occupé à agiter les bras afin de trouver quelque chose à agripper pour me retenir. Mais mes mains ne rencontraient que la surface trop plate de la pierre sur laquelle mes mains mouillées glissaient, et de l’eau qui me coulait entre les doigts et m’entraînait vers la mer. Dans quelques secondes j’allais y être entièrement plongé, puis deux ou trois secondes plus tard une autre vague aussi forte allait violemment me projeter en sens inverse sur la roche où mon corps irait se fracasser. Et c’en serait fini.
Soudain, alors que j’avais déjà amorcé ma glissade le long de la paroi presque verticale du rocher, ma main rencontra quelque chose de dur, une aspérité qui avait à peu près la taille et la forme d’un sabot. Vite, j’y agrippai mon autre main et contractai les muscles de mes bras du plus fort que je pus pour contrer le mouvement de mon corps vers l’arrière, entraîné par le ressac. J’avais les jambes et le bassin dans l’eau, et j’étais suspendu à une aspérité de la roche par des mains tellement glacées et crispées qu’elles m’en faisaient bien mal. Ma lanterne était tombée à la mer et je n’étais pas certain que Clément pût m’entendre hurler. Pourtant je m’époumonais à l’appeler au secours, mais dans le noir complet, comment donc pourrait-il me retrouver ? La lune n’avait pas suffit à le guider le long d’un chemin qu’il connaissait par cœur, il n’y avait donc aucune chance qu’il me trouvât. Pire, il risquait même d’être lui aussi emporté par une lame s’il s’approchait trop du bord. Pourtant, terrorisé, je continuais à crier son nom tout en luttant contre le courant qui, au gré du va-et-vient de la mer, me plaquait violemment contre la roche puis me tirait en arrière à chaque mouvement de reflux. Mes bras commençaient à me faire horriblement souffrir et après chaque vague je me disais « à la prochaine, je vais lâcher… à la prochaine, je n’aurai plus assez de force pour tenir, je lâcherai ». * La force du vent poussait les nuages vers la terre. De temps à autres, la lune se découvrait à peine une minute, puis était de nouveau cachée par une autre masse de nuages et il fallait encore attendre avant qu’elle fût à nouveau dévoilée. Mais même lorsqu’elle brillait, sa clarté n’était pas suffisante pour me permettre de repérer les lieux autour de moi. J’appelai sans cesse Cyprien, puis j’aperçus une lueur qui semblait se déplacer. Je restai alors à ma place tout en continuant de l’appeler afin qu’il puisse me rejoindre. Sa lanterne semblait se rapprocher de moi, et je me sentis tout à la fois très soulagé et un peu honteux d’avoir besoin de son aide après ce que je venais de lui dire. La lumière progressait lentement, de rocher en rocher, tout en se rapprochant du bord de l’eau. Je la voyais de plus en plus distinctement, puis tout à coup, elle s’éteignit. J’attendis alors, j’appelai Cyprien. Rien. Je décidai donc de me rendre au dernier endroit où j’avais vu briller la lanterne. J’avançai lentement, me cognant plus encore, m’écorchant plus encore. Je m’approchai toujours. Les vagues semblaient de plus en plus proches. Ce n’était plus des gouttelettes que je recevais maintenant, mais l’équivalent du contenu d’une carafe toutes les quelques secondes. J’avançais sur les genoux et les mains. Je sentis une vague me lécher les jambes. Puis j’entendis clairement la voix de Cyprien hurler mon prénom. Mais impossible de le voir. – Clément ! Au secours, je vais lâcher ! Clément ! Je réussis à tâtonner jusqu’à l’endroit d’où me parvenait cet appel. Je pus alors apercevoir une forme blanche sur la pierre sombre. Ses avant-bras ! Je m’allongeai sur le rocher et rampai jusqu’à toucher ses mains. J’entendis un cri de joie. Seulement, comment parvenir à le hisser alors que j’avais laissé une bonne partie de mes forces le long des rochers, et que lui n’en avait plus guère ? D’autant qu’il était plus lourd que moi. En rampant, je parvins à me rapprocher du bord. Cyprien me mit alors en garde contre les vagues et je coinçai donc mon pied droit, bientôt rejoint par mon pied gauche, dans un repli de la roche. Je pus alors saisir Cyprien sous les épaules pour le retenir, pour le soutenir, mais impossible de le tirer vers moi. J’essayai pourtant, pendant un temps qui me parut interminable. Je le sentais faiblir et redoublais alors d’efforts mais rien n’y fit. Je fatiguais moi aussi et de temps à autres une lame encore plus forte, plus violente que les autres submergeait notre rocher et je buvais la tasse, toussant, crachant, le nez et la gorge comme transpercés par des milliers d’aiguilles. Cyprien, exténué, avait finalement lâché la saillie du rocher à laquelle il s’était cramponné tout ce temps, et je devais retenir tout son poids rien qu’avec mes bras. J’étais moi aussi à bout de forces, je ne résisterais plus longtemps et d’un moment à l’autre mes pieds ne me retiendraient plus lorsque la mer ravalerait sa vague. Je suivrais alors son mouvement et nous tomberions tous deux à l’eau. C’en serait alors fini de nous, à cause d’une stupide idée que j’avais eue un soir d’ennui. C’est alors que je sentis quelque chose m’agripper les jambes, puis m’appuyer sur le dos. Une main passa par-dessus mon épaule et devant mes yeux pour venir se poser par-dessus la mienne et c’est d’un seul bras que le Comte remonta Cyprien, le second étant resté plaqué sur mon dos pour m’empêcher de glisser. Derrière, Jean-Baptiste avait maintenu ses jambes pour le retenir. Deux lanternes étaient posées à quelques pas de là, et une troisième en retrait éclairait le visage blême de ma mère. * Des minutes qui suivirent notre sauvetage, il ne me souvient plus grand-chose, sinon qu’il advint un fait bien inhabituel : mon père, au lieu d’élever la voix, nous serra tour à tour contre lui tandis que Lucie, avant même de nous embrasser, nous administra à chacun une gifle magistrale. Une fois que nous fûmes de retour chez nous elle nous sécha, nous changea et nous réchauffa tout en ne cessant de parler. Rien ne semblait pouvoir arrêter le flot de ses paroles. Et j’entends encore parfois, les soirs où le vent souffle fort, sa voix me répétant ce qu’elle nous dit alors. Que c’était une honte de leur avoir fait aussi peur, que désobéir de la sorte était presque une preuve d’idiotie, que si elle nous interdisait de sortir ce n’était pas par amusement personnel, que si elle n’avait croisé Jean-Baptiste lui demandant si son fils était retourné se coucher, Dieu seul sait dans quel état on nous aurait récupérés, et encore si jamais on nous avait un jour retrouvés… – Et d’ailleurs, vous ne vous êtes pas montrés très malins car, même dans le cas où nous ne nous serions aperçu de rien et où vous seriez revenus de la grève sans encombres, comment auriez-vous fait pour rentrer dans la propriété ? Comment auriez-vous franchi le mur d’enceinte ? Là, je dus bien m’avouer que c’était un point que ni moi ni Clément n’avions songé à soulever lors de la préparation de notre expédition. Bien évidemment nous avions dû expliquer par quel moyen nous étions parvenus à sortir malgré les grilles fermées. Mais ce qui nous avait échappé n’échappa pas à Lucie, à savoir : s’il est relativement aisé de monter à un arbre puis de se laisser tomber d’une branche, comment, dans le sens retour, parvenir à atteindre cette même branche située à presque trois fois la taille d’un enfant de huit ans ? Pas en sautant en tout cas, ni même en grimpant sur les épaules de l’autre. Là, notre raisonnement fut pris en défaut et j’avoue que j’en fus fort vexé. Il faut pourtant croire que pénétrer de nuit dans le parc n’était pas complètement impossible, puisque celui qui avait occis ma mère y était malheureusement parvenu. Je me demandai alors comment il s’y était pris. Il est vrai qu’il ne s’agissait pas d’un enfant de huit ans. Mon père entra dans la pièce et nous sentîmes alors que le moment d’autres réprimandes était arrivé. Mais au lieu de cela, il nous dit simplement d’aller nous mettre au lit. – Allez vous coucher, ce dont vous avez le plus besoin maintenant que vous êtes secs et réchauffés, c’est de dormir. Une bonne nuit de sommeil vous remettra de vos émotions de ce soir et vous permettra de reprendre des forces. Et croyez-moi, vous en aurez bien besoin demain. Et effectivement le lendemain, à l’issue de longues remontrances au cours desquelles je ne saurais dire lequel de mon père ou de Lucie se montra le plus virulent, Clément et moi fûmes consignés pour une semaine, séparément, chacun dans sa chambre. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France)
Dernière édition par Hetep-Heres le Jeu 27 Juin 2013 - 17:43, édité 3 fois |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Jeu 14 Mar 2013 - 21:27 Jeu 14 Mar 2013 - 21:27 | |
| III C’était au début de l’été 1777. Comme tous les ans, une fête avait lieu au village de Kertanhouët. Nous nous rendions rarement aux fêtes villageoises, le comte n’étant pas grandement assidu aux réjouissances de quelque sorte qu’elles fussent. Il me souvient pourtant qu’en mai 1770, il avait convié tous les habitants des environs à un bal nocturne, une fête de nuit qu’il fit donner sur le domaine de Tanhouët à l’occasion du mariage du Dauphin avec l’Archiduchesse d’Autriche. Nous étions alors très jeunes et je n’en conserve qu’un souvenir très vague. Mais à présent que nous avions dix ans, la perspective de prendre part à une fête villageoise nous remplissait d’excitation. La dernière à laquelle nous avions assisté avait été donnée à Kertanhouët deux ans auparavant, à l’occasion du sacre du roi Louis le seizième. J’ignore ce qui convainquit cette fois le comte de se rendre à cette Saint-Jean. Je soupçonnai sous ce changement d’habitude l’influence grandissante de ma mère, à moins qu’il ne soit dû à une éclaircie passagère dans l’humeur de monsieur de Tanhouët. A bien y réfléchir, et malgré la nouvelle scission entre le parlement breton et le pouvoir royal, il semblait plus gai, plus vivant depuis quelque temps. À l’image des fois précédentes, il y avait à cette fête presque tous les habitants des environs, adultes et enfants, riches et pauvres, paysans et artisans. Cyprien me fit malicieusement remarquer que ma mère semblait avoir quelques soupirants s’empressant auprès d’elle, idée que mon cœur refusait d’accepter. Ceci étant, il était vrai que de temps à autres on l’invitait pour une danse ; mais après tout, une danse un jour de fête n’est rien d’autre que le moyen de se réjouir avec d’autres plutôt que seul dans son coin. D’ailleurs le comte lui-même dansait avec ses gens de maison sans plus de façons. Ma mère gardait presque constamment un œil sur nous, se méfiant sans doute de ce que nous pourrions bien inventer. Mais elle avait grand tort de s’inquiéter ainsi. La musique, les lumières et les danses en plein air étaient pour nous des distractions assez rares pour que nous ne nous en lassions pas au point de chercher une autre source d’amusement. Un grand feu de joie brûlait, par-dessus lequel les jeunes gens sautaient, rivalisant d’audace. Nous aurions évidemment beaucoup aimé tenter nous aussi l’aventure, mais bien entendu ma mère nous avait formellement interdit d’approcher du brasier. Nous nous courrions après autour des tonneaux sur lesquels étaient juchés les sonneurs, puis tout autour des cercles formés par les danseurs. Il y avait bien sûr également quantité d’autres enfants, dont certains que nous ne connaissions pas. Un garçon rouquin d’à peine notre âge s’amusait à soulever des gamins plus jeunes sur son dos, une petite fille brune et bouclée qui devait avoir dans les cinq ou six ans tirait sur les cheveux de tous ceux qui passaient à sa portée, deux autres guère plus âgées tentaient de se glisser à quatre pattes entre les jambes des adultes. Ma mère, même lorsqu’elle dansait, nous surveillait du coin de l’œil. Soudain nous entendîmes juste à coté de nous un petit cri aigu. Faisant volte face, nous vîmes une fillette de notre âge se frotter le crâne. Elle avait de longs cheveux blonds dorés qui flottaient à partir du cou, s’échappant d’un bonnet blanc noué sous le menton. Elle avait toujours la main droite posée sur le sommet de la tête lorsqu’elle nous prit à témoin : – La sale petite peste, elle m’a arraché une mèche, j’en suis presque sûre. Puis elle se mit à menacer alentour : – Attends un peu que je t’attrape, tu vas voir ce que ça fait… Et elle partit à grandes enjambées vers un cercle de danseurs à travers lequel elle avait sans doute cru apercevoir l’arracheuse de cheveux. * Je crois bien que c’était la première fois de ma vie que je voyais mon père s’amuser. Ou, plus précisément, exercer une activité que je trouvais, moi, amusante. À cette fête organisée au village voisin à l’occasion de la Saint-Jean, il riait, dansait, discutait et chantait tout à la fois. Il se montrait enjoué et attentionné envers chacun. À un moment où il dansait avec Lucie, je pus remarquer qu’à chaque tour, celle-ci jetait un regard en notre direction, avec un froncement de sourcil signifiant à peu près : « Pas de bêtises, vous deux ! Conduisez-vous correctement ! ». Mon père lui adressa alors une petite moue du bout des lèvres et un haussement d’épaules semblant vouloir dire : « laissez-les respirer un peu, ce soir c’est fête ! ». Une telle inversion des comportements ne manqua pas de me laisser perplexe. D’habitude en effet, il était plutôt celui qui insistait sur le nécessaire maintien que je devais observer et sur le sérieux que je devais apporter à tout ce que je faisais. Pour tout dire, la notion de fête était à cent lieues de ce à quoi nous étions accoutumés de sa part. Mais ma courte méditation sur le sujet fut interrompue par un cri de victoire juste derrière moi. – Ah ! Je te tiens. Une fille blonde de peut-être neuf ans tenait fermement par l’avant-bras une petite brunette bien plus jeune qui cherchait visiblement à se défaire de cette étreinte. La petite traînait les pieds tandis que l’autre la tirait à l’écart, et de son minuscule poing serré sortaient quelques fils longs, fins et dorés. Pendant qu’elle continuait à se débattre, la plus grande lui disait triomphalement : – Je t’avais bien dit que je t’attraperais ! Puis approchant sa main libre de la nuque de la petite : – Maintenant tu vas voir ce que ça fait… Alors, malgré le geste de Clément pour me retenir j’attrapai le bras de la fillette blonde en lui criant : – Arrête ! Elle tourna alors son visage vers moi et me regarda comme si jamais encore elle n’avait vu chose plus incongrue. Quelque peu interloqué par ce regard, j’ajoutai pourtant : – Tu ne vas tout de même pas t’en prendre à plus petite que toi ? – Ne te mêle pas de ça, toi ! répliqua-t-elle vivement d’une voix beaucoup plus grave que précédemment, dégageant son bras de ma main d’un geste sec. – Elle attrapa aussitôt la masse de boucles brunes sortant du bonnet de la gamine. La petite se mit alors à crier, par anticipation semble-t-il car la blondinette n’avait pas même encore tiré dessus. – Laisse-la tranquille te dis-je ! Ou bien alors je… – Écoute, coupa-t-elle, je sais parfaitement qui tu es. Tu es Cyprien de Granville, et cela ne m’empêche en rien de te répéter de ne pas te mêler de ça ! ajouta-t-elle en tirant cette fois pour de bon sur les boucles noires. – Aïe, cria de nouveau la fillette aux cheveux bruns. La grande la lâcha alors complètement et j’en profitai pour me glisser entre elles deux, poings serrés, faisant face à la plus âgée, la petite brunette derrière moi. – Tu as bien de la chance d’être une fille, lui dis-je, sans quoi je t’aurais… – Tu m’aurais quoi ? Tu m’aurais frappée ? Oui, tu es plus grand que moi et tu es un garçon, alors tu aurais sûrement eu le dessus. Mais je n’ai quand même peur ni de toi ni de tes poings, et j’apprendrai aussi à me bagarrer si vraiment c’est tout ce qui compte ! Et ce disant elle leva les poings. Peut-être n’était-ce qu’un geste de défi ou peut-être avait-elle réellement l’intention de me frapper, je ne le saurai jamais car à ce moment-là Clément se précipita derrière elle et lui immobilisa les bras en disant : « Ne touche pas à lui ou alors tu auras aussi affaire à moi ! », ce qui ne manquait pas d’un courage certain, attendu qu’elle mesurait une demi-tête de plus que lui. C’est alors que je sentis comme une brûlure à l’arrière du crâne, en même temps que ma tête se trouva brutalement tirée en arrière. La petite peste abritée derrière moi venait de profiter de ce que je lui tournais le dos pour attraper mes cheveux noués en catogan, et avait tiré dessus de toutes ses forces avant d’éclater de rire. Mais son hilarité ne fut rien comparée à celle de la blondinette en face de moi. Elle avait profité de cette diversion pour se défaire de l’étreinte de Clément puis s’éclipsa en me lançant « Ça, c’est bien fait pour toi ! Que cela t’apprenne à te mêler de tes seules affaires ! ». Furibond, je fis alors volte face vers la petite qui du coup cessa de rire et chercha à s’enfuir, mais je pus la saisir par l’épaule et la retenir en serrant les doigts sur ma prise. La sensation de brûlure ne s’était pas dissipée tout de suite et je pouvais encore sentir comme une dizaine d’aiguilles plantées à l’arrière de ma tête. Mes yeux s’embrumaient de larmes de douleur mais je luttai pour ne surtout pas pleurer. Que penseraient-ils donc tous de moi ? Et surtout Clément, que penserait-il de moi ? Je me sentais bouillonner et m’empourprer de colère, tout à la fois à cause des railleries dont je venais de faire l’objet et de l’agression inattendue et incompréhensible dont je venais d’être victime de la part d’une personne que je venais de secourir ; je commençai alors à la secouer vivement en tous sens en lui hurlant : – Non mais… peux-tu me dire ce qui t’a pris ? La petite se mit à pleurer et j’ajoutai : – Figure-toi que ça fait très mal, espèce de petite brute ! Je continuai à la secouer jusqu’à ce que Clément, bras croisés sur la poitrine et sourire moqueur aux lèvres, me lance d’un air narquois : – N’as-tu pas honte de t’en prendre à plus petite que toi ? Interdit, assez peu fier de moi, je m’immobilisai et lâchai prise : sa chemise, un peu trop grande pour elle, glissa légèrement en travers lorsqu’elle se dégagea, laissant apparaître une épaule frêle et osseuse ; des traces rouges y marquaient l’endroit où mes doigts s’y étaient enfoncés. Cette vision, témoignage de mon accès de brutalité, me fut comme une accusation muette mais plus assourdissante que tous les cris qu’elle eût alors pu lancer. Mais elle ne cria pas, n’appela pas, et se contenta de disparaître dans la foule après nous avoir lancé un regard noir. Quand elle se fut enfuie Clément lâcha dans un soupir : – Eh bien dis donc, tu parles d’une paire de pestes ! * La fête s’était déroulée sans incident notable, mis à part que Cyprien et moi avions fini nous aussi par nous faire tirer les cheveux par l’abominable petite peste dont cela semblait être le jeu favori. Nous avions également eu une altercation avec une fillette de notre âge mais heureusement, au milieu du brouhaha ambiant, cela avait semblé échapper à ma mère. Du moins est-ce là ce que nous avons cru pendant le reste de la soirée, mais c’était compter sans sa capacité à voir ce qui se passait dans son dos du moment que cela nous concernait. Ce n’est qu’une fois rentré au manoir, après que le comte se fut retiré dans son cabinet de travail, qu’elle commença à nous interroger sur cet incident qu’elle avait tout de même remarqué. Il fallut lui en conter tous les détails, du début à la fin. Elle commença par en attribuer les torts à Cyprien : – Quel besoin aviez-vous, aussi, de vous mêler de ce qui ne vous regardait pas ? – Mais elle était en train de maltraiter cette petite fille ; je ne pouvais pas laisser faire cela ! expliquai-je. – Maltraiter, comme vous y allez ! Elle s’apprêtait juste à lui tirer un peu les cheveux, et d’ailleurs la petite venait de faire la même chose à de nombreux autres enfants dont vous n’avez apparemment pas jugé utile de prendre la défense face à elle. – Mais elle, c’est une toute petite, les autres étaient plus âgés qu’elle… – Eh bien justement, c’est à eux qu’il incombait de la sermonner, en l’absence de ses parents. Et c’est précisément ce que cette fillette semblait avoir entrepris de faire, maladroitement, je vous l’accorde, lorsque vous vous en êtes mêlé. – Oh, elle cherchait surtout à se venger, rien d’autre, et d’ailleurs la petite était si jeune, elle ne se rendait pas compte que ce qu’elle faisait était mal. – A six ans, on se rend parfaitement compte ! A six ans, on est parfaitement à même de savoir quand on fait quelque chose d’interdit, surtout si cette chose semble faire mal à autrui. Vous me paraissez sous-estimer quelque peu les plus jeunes, et vous montrer aussi peu exigeant envers eux qu’envers vous-même ! D’ailleurs si vraiment vous pensiez qu’elle n’avait pas l’âge d’être responsable de ses actes, peut-on savoir pourquoi vous avez alors jugé utile de vous en prendre si violemment à cette enfant alors qu’elle ne vous avait rien fait de plus que ce qu’elle avait précédemment fait à la plus grande ? – Je… je… je crois que je me suis emporté, bafouillai-je. – Il me semble, en effet, répliqua ma mère, glaciale. – Et… je… n’en suis pas très fier. – Il n’y aurait effectivement pas de quoi l’être, poursuivit-elle sur le même ton. – Mais… mais elle m’avait fait très mal, tentai-je pour me justifier, alors que je venais de la tirer d’un fort mauvais pas ! – De la tirer d’un mauvais pas ? Vraiment ? Et vous pensez réellement l’avoir aidée ? Cyprien resta silencieux, un air de totale incompréhension sur le visage. Quant à moi qui n’avais pas dit un mot depuis le début de cette délicate discussion, je m’en tins à cette prudente – bien qu’assez veule – stratégie. – Savez-vous bien ce que vous avez fait ce soir ? reprit ma mère. Vous lui avez clairement fait comprendre que parce qu’elle plus petite que ses camarades, elle peut impunément s’en prendre à eux. Et qu’eux n’ont face à elle le droit ni de se défendre, ni de la sermonner. Et vous avez fait comprendre à une autre fillette que parce qu’elle n’est pas un garçon, elle peut se permettre de prendre des libertés avec le respect dû à autrui sans avoir à craindre de représailles. Et surtout, vous avez montré à tout le monde que l’on peut impunément s’en prendre aux autres, et ce presque avec votre bénédiction, mais que s’en prendre à vous de la même manière entraîne de sévères représailles. Peut-être est-ce là l’image que vous souhaitez donner de vous-même, bien que j’espère le contraire, toutefois dites-vous bien que puisque c’est à moi qu’incombe en grande partie la tâche de vous éduquer, je ferai tout mon possible pour faire de vous un jeune homme ayant des principes plus conforme à ce que j’estime être l’équité et la dignité. Ma mère avait toujours eu une propension à l’emphase lorsqu’elle était en colère. Il nous était arrivé plus d’une fois d’avoir à subir ses interminables diatribes, attendant patiemment d’en voir le bout. Cette fois je trouvais qu’elle avait tout de même exagéré l’importance et la gravité de l’incident somme toute assez bénin, et je n’avais d’ailleurs pas bien compris le maelström de reproches et d’explications qu’elle venait de nous exposer, car, si je n’avais effectivement pas jugé utile d’intervenir entre les deux fillettes c’était plus par désintérêt pour leur chamaillerie que par souci d’éducation. Je n’étais pas certain d’avoir bien saisi tout ce qu’elle reprochait à Cyprien, mais tout de même pas au point de me demander si oui ou non elle avait raison. Et encore moins au point d’ouvrir la bouche pour demander certains éclaircissements ni même pour prendre la défense de Cyprien. Ma mère semblait avoir oublié que j’étais toujours là, et je savais qu’en présence d’une Lucie Guermeur en colère c’était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. D’autant qu’elle semblait pour l’instant ne pas prêter attention au rôle que j’avais joué dans cette querelle en me rangeant finalement comme toujours aux cotés de Cyprien. Le fait est que pourtant, au début de l’altercation j’étais assez d’accord avec ce que je pus comprendre par la suite des arguments de ma mère : point n’était besoin de nous mêler de cette affaire tout d’abord, et Cyprien avait par la suite eu tort de s’en prendre physiquement de la sorte à la gamine. Mais en tous les cas je ne supportais pas l’idée que l’on menaçât Cyprien et je m’étais donc rallié à lui contre l’arrogante fillette blonde. Lui ne bronchait pas mais je pouvais voir à l’expression de son visage qu’il était au moins aussi perplexe que moi quant aux reproches qui lui étaient adressés par ma mère qui conclut enfin par l’énoncé de sa sentence : – …Voilà pourquoi vous serez consigné demain toute la matinée dans votre chambre. Cela vous laissera tout loisir de réfléchir. * Lorsque Lucie m’eut signifié ma punition, je n’avais pas encore bien compris au juste tout ce qu’elle venait de me reprocher. Ses paroles s’embrouillaient quelque peu en tournant dans ma tête et ne m’avaient pas encore convaincu de mon tort de prendre la défense d’une enfant menacée par plus fort qu’elle lorsque je frappai à la porte du cabinet de travail de mon père pour lui souhaiter la bonne nuit. Ce qu’il me dit alors ne contribua pas à clarifier mes pensées. – Entrez ! Ah, c’est vous. Alors, je vous écoute : quelle punition votre gouvernante a-t-elle estimé que votre attitude de ce soir méritait ? Bigre ! Les nouvelles vont vite, me dis-je alors. Il ignorait encore tout de l’incident lorsque nous arrivâmes au château et qu’il se retira dans son bureau, et il était pourtant à présent au courant de l’affaire ; sans doute Jean-Baptiste lui avait-il relaté les faits en lui montant son chocolat. – Je suis consigné dans ma chambre jusqu’au déjeuner de demain, répondis-je. – Lucie a eu raison, dit-il d’une voix claire. Il marqua une pause. Rendez-vous compte, reprit-il en soupirant, vous en prendre si violemment à plus faible que vous, mais où aviez-vous donc l’esprit ? Je me dis alors que mon esprit était justement à cet instant-là bien près de la racine de mes cheveux, mais me gardai bien de l’exprimer. Le rapport de Jean-Baptiste avait du être fidèle car mon père semblait connaître en détails le déroulement de l’altercation, bien qu’il n’ait pas assisté au récit que Clément et moi en avions fait. – Père, tentai-je timidement, j’ai cru que cette enfant avait besoin d’être protégée face à une plus grande qui la menaçait et … – Bien entendu, elle en avait besoin ! Ce dont en revanche elle aurait pu se passer, c’est que vous vous en preniez physiquement à elle ! Évidemment, elle n’aurait pas dû vous tirer les cheveux, et évidemment elle devait être punie pour cela, mais la manière dont vous avez alors réagi et inqualifiable et me porte à reconsidérer les félicitations que sans cela vous auriez méritées pour avoir pris la défense de plus faible que vous. Lorsque vous serez comte de Tanhouët vous aurez à veiller sur nos terres et sur ceux qui y vivent, et ils devront pouvoir compter sur votre courage mais aussi sur votre sens de la justice. Qui vous fera confiance si ceux qui viennent pleins d’espoir vous exposer leurs doléances repartent avec le sentiment d’avoir été aussi injustement traité par vous que par les autres ? Sur ce point, on en attendra plus de votre part que de l’homme du commun. Voilà pourquoi vous devez être tout aussi exigeant envers vous-même qu’envers autrui. Et sachez également faire preuve de clairvoyance : songez donc que cette petite a à peine six ans, elle ne cherchait probablement qu’à jouer, sans réaliser que ce jeu n’avait rien d’amusant pour les autres. J’ose espérer que vous saisissez maintenant en quoi votre attitude de ce soir est répréhensible. Il marqua une courte pause. – Et décevante, ajouta-t-il tristement. – Oui, père, mentis-je. Et, plus perplexe encore qu’en y entrant, je sortis de la pièce et montai me coucher. Les deux sermons que l’on venait de m’infliger me donnèrent beaucoup à penser, mais plus je réfléchissais, moins je parvenais à avoir une idée claire de mes torts dans cette affaire. Mis à part une chose : le seul point de concordance entre les reproches de Lucie et ceux de mon père était que je n’aurais pas dû m’emporter si violemment contre la petite arracheuse de cheveux. D’ailleurs Clément lui-même m’en avait le premier fait le reproche. Et, sans me l’avouer franchement, je m’en étais senti assez mal à l’aise. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France)
Dernière édition par Hetep-Heres le Lun 1 Juil 2013 - 19:59, édité 2 fois |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Dim 17 Mar 2013 - 14:24 Dim 17 Mar 2013 - 14:24 | |
| IV Le lendemain matin me parut interminable. Cyprien était consigné dans sa chambre, ce qui constituait pour moi aussi une punition. Je tournais en rond dans le château, traînant les pieds d’une pièce à l’autre, avec l’impression que l’heure du déjeuner jamais n’arriverait. Ma mère aurait pu tout aussi bien me consigner également. Au contraire, elle avait bien tenté de m’envoyer jouer dehors, mais comment demeurer seul quand on a toujours été dédoublé ? Il y avait tant de choses à faire, à inventer, à partager dans ce parc lorsqu’on était deux, mais si peu lorsqu’on se retrouvait seul. Tout seul. En désespoir de cause, elle me flanqua d’autorité un livre dans les mains et me traîna jusque sous un grand châtaignier, qui était de tous les arbres du parc celui que Cyprien et moi préférions. Lorsque personne ne nous surveillait, nous avions pour habitude d’y grimper à tour de rôle pour nous suspendre par les genoux, tête en bas, à l’une des plus grosses branches située à hauteur d’homme du sol. Nous prenions alors de l’élan en balançant les bras afin d’osciller d’avant en arrière, pour finalement lâcher prise au bout d’un mouvement "aller", nous redresser au cours de l’envol et atterrir sur les pieds. Ce faisant nous nous écorchions bien sûr l’arrière des genoux, et ma mère ne cessait de récriminer en découvrant de nouveaux accrocs à nos bas et culottes. Mais ce matin-là, nulle acrobatie, nulle cabriole, car Cyprien était là-haut, reclus et seul lui aussi. Je levai les yeux en direction de sa chambre. Il était là, tout près, si proche mais si loin également car je ne pourrais le voir avant l’après-midi. Ma mère, voyant que mon livre était obstinément resté fermé, le prit et le feuilleta rapidement, puis me le remit en mains, ouvert à une page. – Puisque vous ne semblez pas d’humeur à vous amuser ce matin, occupez donc votre temps utilement ; à travailler vos leçons par exemple ! Elle était fille de précepteur, et celui-ci avait veillé, bien qu’elle fût fille, à la qualité de son instruction autant qu’à celle de son éducation. Le préceptorat était souvent le fait d’ecclésiastiques, toutefois certains laïcs en faisaient profession. Son père était de ceux-là. Il avait d’ailleurs vu d’un assez mauvais œil son mariage avec mon père, considérant ceci comme une mésalliance. Mais elle avait tenu bon et obtenu son consentement. Il faut dire qu’il avait presque abandonné l’espoir qu’elle se mariât un jour et avait déjà repoussé trois prétendants lorsqu’elle annonça à ses parents son intention d’épouser mon père. Un simple compagnon-charpentier, sans aucun espoir d’un jour devenir maître-charpentier ! Apparemment ils n’avaient pas semblé ravis de le prendre pour gendre mais se résolurent à l’accepter. Ils avaient certainement rêvé mieux pour leur fille qu’un charpentier aux mains calleuses. Elle avait reçu une éducation soignée qui lui aurait peut-être même ouvert les salons si seulement elle s’était mieux mariée. Mais au final, elle était passée de nourrice à gouvernante dans une noble maisonnée ; si son mariage l’avait quelque peu desservie, son veuvage n’avait pas si mal fait les choses… Toujours était-il que depuis qu’elle s’était mariée elle n’avait que très peu fréquenté mes grands-parents, que je n’ai pas connus. Mon grand-père était mort d’une mauvaise grippe avant ma naissance, et sa femme ne lui avait pas survécu un an avant de s’éteindre à son tour. Le frère et les deux sœurs de ma mère habitaient au loin, trop loin pour que nous leur rendions visite. Du moins était-ce la raison qu’elle avançait. Mais je crois qu’ils ne s’écrivaient pas non plus. Un jour, pourtant, je vis pour la première fois de ma vie ma mère pleurer. Elle venait de tomber sur une note manuscrite de sa sœur dans la marge de l’un des vieux livres qu’elle tenait de ses parents. Je découvris ainsi que l’on pouvait continuer à aimer les gens que l’on ne voyait plus jamais. Et je souhaitai de tout mon cœur que jamais n’arrivât un jour où je me brouillerais définitivement avec ma mère, ou avec Cyprien. Pour l’heure, en ce qui concernait Cyprien, je brûlais d’impatience qu’il sortît enfin de sa chambre. Je savais pourtant que nous ne pourrions de suite jouer ensemble, qu’il y aurait d’abord le dîner, puis les leçons en début d’après-midi. C’était jusqu’ici ma mère qui s’était chargée de notre instruction, mais à compter de notre prochain anniversaire, un précepteur viendrait tout exprès pour nous, le comte estimant que Cyprien aurait désormais besoin d’un enseignement plus avancé. Enfin arriva la mi-journée et l’heure de la délivrance : nous pûmes nous retrouver tous deux réunis et ce simple fait suffit à nous faire paraître le temps moins long jusqu’à la fin de nos leçons. Puis nous sortîmes enfin profiter du beau temps qui nous sembla certainement plus radieux encore qu’il devait être réellement. * Je ne me souviens plus bien comment la dispute avait commencé. Clément et moi nous trouvions dehors, non loin des fenêtres du salon, et le ton montait, montait, sans qu’aucun de nous deux ne prenne soin de calmer le jeu. – Je t’avais fait signe de ne pas t’en mêler, me dit-il, mais bien sûr mon avis compte pour quantité négligeable à côté du tien. Beau résultat en vérité : une demi journée de retenue pour toi, et du coup presque la même chose pour moi, à tourner en rond tout seul toute la matinée. – Toi ? Tu n’as pas été consigné que je sache ! Bel exemple que le tien : tu es resté bras croisés et tu aurais laissé cette fille en brutaliser une plus jeune sans intervenir. Et tu n’as même pas été réprimandé pour cela, rien ! Ce n’est tout de mêm– – Sans intervenir ? me coupa Clément. Ah, vraiment, sans intervenir ? Et qui l’as ceinturée au moment où elle s’apprêtait à te frapper ? – La belle affaire ! J’aurais été de taille à… – Et ta punition aurait été bien pire pour t’être bagarré, au milieu de tout ce monde, et de surcroît pour avoir porté la main sur une fille. – Je n’allais tout de même pas me laisser faire ! me défendis-je alors. – Donc tu vois, j’ai bien fait de l’empêcher de se jeter sur toi ! – Se jeter sur moi ? On ne sait même pas si elle l’aurait fait ! Et puis, tu as une bien étrange façon de choisir à qui porter assistance : je suis plus grand et plus fort que toi, j’aurais fort bien pu me passer de ton aide, alors que tu n’as pas levé le petit doigt pour te porter à la rescousse d’une enfant de cinq ans. – Parlons-en de la petite : sais-tu au moins qui elle est ? Maman m’a dit qu’il s’agissait justement de la sœur de la grande, qui avait entrepris de lui faire la leçon lorsque tu es intervenu dans leurs affaires de famille. – Tu appelles cela « faire la leçon » ? Le fait qu’elle soit sa sœur aînée ne lui donne pas le droit de la brutaliser ! – Je suis d’accord, me répondit Clément, mais peut-on vraiment appeler cela des brutalités ? – Oui, on peut vraiment qualifier ceci de brutalités. – Comme tu y vas, argumenta Clément, c’est à peine si elle lui a tiré les cheveux ! – Et sous prétexte que cela se passe en famille, continuai-je sans l’écouter, doit-on laisser faire ? – Je ne pense pas que tu apprécierais qu’un étranger vienne mettre son nez dans nos affaires en ce moment par exemple. – Cela n’a rien à voir. Nous sommes parfaitement capables de nous quereller sans en venir aux mains, la preuve ! – Ravi de te l’entendre dire ! Dommage que tu n’aies pas fait preuve d’autant de sang-froid lorsque la petite sœur t’a tiré les cheveux. – J’aurais aimé t’y voir ! – Mais, pour ton information, elle me l’a fait subir à moi aussi. Et je n’en ai pas fait toute une affaire, je lui ai juste dit de décamper. – Oh, je vois, tu es vraiment parfait alors ! Tu laisses juste le plus grand s’en prendre au plus petit, pour ne surtout pas te retrouver pris dans la bataille. – Et quel bien cela t’as-t-il fait à toi ? Tu n’as réussi qu’à te les mettre toutes les deux à dos ! – Si tu avais deux sous de courage, lui répondis-je un peu trop vivement, tu te soucierais moins des ennuis que cela pourrait te valoir et tu te porterais au secours de celui qui en a besoin. – S’il le mérite ! répliqua un Clément visiblement piqué au vif. – Eh bien accuse moi franchement d’être injuste maintenant ! lançai-je furieux. Je n’écoutai pas ce que Clément me répliqua car depuis quelque temps déjà j’avais remarqué Lucie dans l’encadrement de la fenêtre du salon, attirée sans doute par le vacarme de notre querelle. Immobile, les bras croisés et les sourcils froncés, elle nous observait sans dire un mot. Mon père, arraché à son tour à ses chères lectures, venait de la rejoindre à la fenêtre. Étonné de mon soudain mutisme, Clément se tut à son tour. Mais son regard, sans être franchement hostile, était suffisamment éloquent pour m’exprimer tout son ressentiment. Pour ma part, j’éprouvais trop de colère contre son refus de me comprendre pour rompre le lourd silence qui venait de s’installer entre nous. La scène de la veille, l’impression d’avoir été abandonné par Clément, les reproches de Lucie, le sermon de mon père, la matinée consigné dans ma chambre, cette querelle entre nous, et maintenant son silence… Surtout son silence. La veille au soir, tandis que Lucie me réprimandait, pas une seule fois il n’avait ouvert la bouche, pas un mot n’en était sorti pour prendre ma défense. Nous avions pourtant toujours eu l’habitude de faire front ensemble, parfois même de chacun s’attribuer les torts de l’autre. En ce moment même où j’observais un Clément immobile et silencieux, je savais bien que si nos rôles avaient été inversés j’aurais tout tenté pour le défendre, sans doute jusqu’à m’accuser à sa place. Cela était déjà arrivé par le passé, et j’étais abasourdi par son mutisme. Pour la première fois de ma vie, sans vraiment me l’avouer, je me sentais abandonné par Clément sur qui j’avais jusque là toujours pu compter. Et sans qu’alors j’en fusse conscient, plus que le sentiment d’injustice ou de colère, c’était celui de cet abandon qui me faisait le plus mal en ce moment précis où nous nous regardions en chien de faïence, sous les yeux de mon père et de sa mère. Ils étaient tous les deux suffisamment loin de nous pour que nous ne les entendions pas murmurer, mais Jean-Baptiste nous rapporta par la suite ce qu’ils étaient en train de se dire. * – Ils sont à peine réunis que déjà ils se querellent, s’étonnait le comte. Cependant et d’après vos dires, votre fils était ce matin comme une âme en peine, se languissant de retrouver son camarade. – En effet, répondit tranquillement ma mère, et ce que le votre a le plus mal supporté de sa punition fut certainement la séparation momentanée d’avec Clément. – Et presque sitôt ensemble, ils se disputent ! s’exclama le comte. Décidément je crains ne jamais rien comprendre à ces enfants, soupira-t-il. Ma mère ne répondit rien, mais Jean-Baptiste crut voir un sourire furtif et légèrement énigmatique passer sur son visage. – À franchement vous parler, reprit le comte, je me demande parfois comment vous faites… Autre petit sourire. Puis elle fronça légèrement les sourcils et porta de nouveau son regard sur nous. – Pas toujours comme je le voudrais, vous le savez fort bien, répliqua-t-elle gravement. – Et vous, vous savez fort bien que je réprouve ces méthodes. Je vous accorde toute latitude avec l’éducation de mon fils, à ce détail près. Il est vrai que je vous ai entièrement abandonné le soin de l’élever, et à ce titre vous voulez avoir entièrement les mains libres. Je reconnais que ce ne serait que justice, mais je ne puis me résoudre à ce dernier point. Pour le reste je trouve que je suis très souple avec vous et je n’ai d’ailleurs qu’à me féliciter des résultats que vous obtenez. Mais je veux également croire que la petite restriction que j’apporte à vos méthodes n’est pas étrangère à ces bons résultats. – Il est à craindre qu’un jour vos désirs d’innovation et de modernité ne vous apportent des ennuis, s’inquiéta ma mère. – Eh bien en attendant ce jour, je ne reviens pas sur ma décision, répliqua-t-il fermement. Je déteste le recours aux châtiments corporels dans l’application de la justice du roi, ce n’est pas pour l’accepter sous mon propre toit envers mes enfants. Elle ne répondit rien. Quand le comte avait pris une décision, il ne servait à rien d’essayer de le faire changer d’avis, et il était vrai qu’il la laissait par ailleurs faire comme bon lui semblait. Peut-être aussi était-elle émue d’entendre le comte dire “mes” enfants, m’englobant dans son affection aux côtés de Cyprien. Elle fixait son regard sur nous, sans bouger. Tout aussi immobiles qu’elle, nous nous étions tus mais nous défiions du regard. La scène semblait figée. Murmurant, si bien que Jean-Baptiste eut du mal à entendre, le comte demanda : – Et maintenant ? – Maintenant nous attendons, répondit ma mère d’une voix posée. – Attendre, c’est tout ce que vous proposez ? Vous ne devriez pas plutôt intervenir pour faire cesser cette dispute ? – Non, répliqua-t-elle tranquillement. Ils y parviendront bien par eux-mêmes. D’ailleurs ils ont cessé de crier, vous allez pouvoir reprendre tranquillement votre lecture. Il choisit d’ignorer à la fois le conseil et le sarcasme. Il avait tendance à lui laisser prendre des libertés envers lui qu’il n’aurait tolérées de nul autre. Peut-être en souvenir de la façon dont était mort son mari. Sans doute aussi pensait-il que c’était là le prix à payer pour n’avoir pas à s’occuper de trouver une autre personne de confiance et aux compétences assurées à laquelle confier l’éducation de Cyprien. – Et qu’attendons-nous ? demanda le comte après un silence. – Que l’un des deux se décide à faire le premier pas vers l’autre – Et vous n’avez pas peur qu’ils recommencent plutôt à se chamailler ? Encore une fois elle ne répondit pas et sourit légèrement. Lui avait l’air plutôt désemparé. – Qu’attendez-vous au juste ? demanda-t-il encore. – J’attends de voir lequel des deux aura le premier le courage de présenter ses excuses à l’autre. Nous étions toujours face à face et silencieux. Nous n’avions rien entendu de tout ce que nos parents se disaient à voix basse, et je luttais contre une furieuse envie de me réconcilier avec Cyprien. Mais son entêtement m’exaspérait tout autant que les éclairs dans son regard réfrénaient mon élan. Puis peu à peu je vis l’ombre d’un flottement passer dans ses yeux, pendant que de mon coté je sentais fondre ma colère. Elle laissa place à un sentiment confus de léger malaise mêlé de honte et, tout de même, de ressentiment. Je restai là, n’osant bouger ni parler, mais refusant de baisser les yeux malgré l’envie grandissante de le faire. En face de moi, le visage jusque là contracté de Cyprien semblait se relâcher peu à peu. C’est au milieu de cette brume confuse qui semblait nous envahir tous deux que nous entendîmes soudain nous parvenir la voix de ma mère, s’adressant apparemment à Jean-Baptiste : – Eh bien, mon ami, vous en mettez un temps à ramasser ce sucrier ! Je ne pense pas qu’il y reste encore un seul grain de sucre sur ce tapis, rassurez-vous. Vous pouvez sans crainte ramener ce plateau à l’office. En quittant la pièce, Jean-Baptiste entendit encore ma mère dire au comte : – Ne vous inquiétez pas, leurs brouilles ne durent jamais très longtemps. * Tandis que mon père et Lucie devisaient de la sorte, j’étais resté immobile, tête baissée, n’osant lever les yeux vers Clément tant j’étais à la fois triste, confus et mécontent de l’échange que nous venions d’avoir. Je me tenais à l’orée d’un bosquet de quelques arbres, à coté d’un marronnier dont les racines affleuraient sous mes semelles. Le regard fixé par terre, je raclais distraitement le sol du bout de mon pied droit. Je mourrais d’envie que Clément rompît le pesant silence qui s’était brusquement installé entre nous, au beau milieu de notre querelle. Qu’il parle, qu’il cherche la réconciliation ou qu’il m’invective, je ne savais, pourvu qu’il dît quelque chose ! Mais il ne semblait pas plus que moi se décider à ouvrir la bouche. Je me sentais de plus en plus mal à l’aise et osais de moins en moins lever la tête. D’ailleurs celle-ci me semblait lourde, très lourde, comme si une charge invisible appuyait sur l’arrière de mon crâne, forçant ma nuque à ployer sous son poids. Je fixais le sol sans le voir et ma chaussure droite labourait la terre de plus belle. Il me semblait que même si je l’avais voulu, je n’aurais pas pu relever la tête, tandis que je sentais également tout ce poids me descendre sur le cœur. Et soudain, quelque chose frappa mon œil, une sorte d’éclair doré : un rayon de soleil venait de tomber sur quelque chose à mes pieds qui l’avait reflété. Intrigué, je m’accroupis pour gratter la terre de mes mains tout en appelant Clément : – Descends voir, j’ai trouvé quelque chose ! En une fraction de seconde j’avais complètement oublié que nous étions brouillés, et il faut croire que lui aussi car il me rejoignit en demandant : – Quoi donc ? – Je ne sais pas, mais ça brille. Et c’est ensemble que nous déterrâmes l’objet en question. – Un trésor ! Nous avons trouvé un trésor, m’exclamai-je tout excité. C’était un bijou. Un anneau doré en forme de serpent enroulé sur lui-même, et dont le regard consistait en deux minuscules perles blanches. – Une idée de ce que ça fait là ? m’interrogea Clément. – Pas la moindre, lui répondis-je. Qu’est-ce qui te fais croire que je le saurais ? – Eh bien… c’est chez toi ici… – Chez toi aussi, lui répliquai-je. Clément eut alors un sourire fugace et quelque peu désabusé. – Ce n’est pas tout à fait la même chose, se crut-il obligé de préciser. Et tu le sais bien, ajouta-t-il. Plus pour éviter l’installation d’un silence gênant que par réel intérêt pour l’objet, je contemplai la bague et demandai : – Qu’allons-nous en faire ? C’est un bijou de femme, ce n’est pas pour nous. Comme il ne répondait pas, je levai alors les yeux vers lui et vis son regard songeur fixé sur le bijou. Puis enfin il parla : – Tu sais, ce n’est pas idiot, après tout… Je veux dire… C’est une très ancienne demeure… Sans doute ne connaissons-nous pas toute son histoire… toutes ses histoires… même toi… même ton père. Peut-être a-t-elle servi de cachette ? – Tu veux dire… qu’il y a peut-être un trésor enterré dans le parc ? Un trésor caché depuis des années et des années, peut-être des siècles ! – Imagine un peu si nous le trouvions ! – En attendant, je sais ce que nous pourrions faire de cette bague : nous allons l’offrir à ta mère. Après tout, c’est un bijou de femme, cela devrait lui faire plaisir. Et, le cœur réjoui de pouvoir enfin offrir à Lucie un présent digne de notre amour pour elle, nous nous dirigeâmes vers la grande porte d’entrée. * – Et où dites-vous l’avoir trouvée ? Certaine de notre réconciliation, elle avait quitté son poste d’observation à la fenêtre du salon et n’avait pas assisté à la découverte du serpent d’or. – Au pied d’un arbre, là au dehors. – Et dans l’enceinte du parc ? Pourquoi donc fallait-il qu’elle se le fît répéter ? – Oui, confirma Cyprien légèrement agacé. Entre les racines, sous une couche de terre que je venais de racler. Il semblait aussi décontenancé que moi. La réaction de ma mère n’était pas tout à fait celle que nous avions escomptée. Ni émerveillement, ni exclamation, ni remerciements chaleureux, elle n’avait même pas passé l’anneau à son doigt. L’étonnement, lui par contre, était bien là. Mais elle restait immobile, l’anneau au creux de sa main, les sourcils froncés. On eut dit une statue. Puis elle lâcha comme pour elle-même : – Ce qui m’étonne, c’est la couche de terre sous laquelle elle était enfouie… Était-elle épaisse ? demanda-t-elle à Cyprien après une courte pause. – Assez épaisse. C'est-à-dire… l’anneau était totalement enfoui, mais à la réflexion, si quelqu’un avait voulu l’enterrer, il aurait creusé plus profond. C’est en tout cas ce que j’aurais fait. – Voilà qui montre que vous savez à peu près penser. Mais réfléchissez un peu plus, pourquoi donc quelqu’un voudrait-il enterrer ses bijoux dans un parc ? Cela n’a aucun sens ! – Mais pour les cacher ! répondis-je immédiatement. Si jamais il s’agit d’un trésor dérobé, ils ont pu les enterrer là en attendant de rev– – Encore vos histoires de pirates ou de bandits ! C’était charmant jusqu’il y a deux ans, mais vous commencez à présent à être un peu grands pour ce genre de contes, ne croyez-vous pas ? Il est une explication tellement plus simple à ceci : il y a quelques temps, une dame en visite au château l’aura perdu dans le parc, et il aura été recouvert de terre. – Il y avait vraiment beaucoup de terre par-dessus, répliqua Cyprien, et d’ailleurs nous ne recevons que rarement des dames. Cet argument sembla frapper ma mère. Elle sembla réfléchir à la question un instant, puis jeta vers Cyprien un regard dans lequel je crus déceler un peu de gêne. Elle se racla la gorge puis déclara : – Je vais aller porter cette bague à votre père. – Il ne saura pas plus que nous d’où provient ce bijou! Elle ne répondit rien et se dirigea vers la porte, l’anneau serré au creux de sa main. Nous lui emboîtâmes le pas mais elle se retourna vers nous et nous précisa qu’elle irait, mais seule. – Pourquoi ne veut-elle pas que nous l’accompagnions auprès de ton père ? Après tout, c’est nous qui l’avons trouvée, cette bague ! – Elle ne pense tout de même pas que nous l’ayons volée ? Elle n’a pas eu l’air de croire à la couche de terre qui le recouvrait… Soudain, je le pris par la manche et le tirai à ma suite dans les couloirs. – Viens, lui dis-je, nous allons en avoir le cœur net. Les escaliers quatre à quatre, couloir de gauche, deuxième porte à droite : nous collâmes à tour de rôle l’un un œil à la serrure, l’autre une oreille juste en dessous pour tâcher d’assister discrètement à ce qui se passait dans le bureau du comte. * – Hum ? émit distraitement mon père, les yeux rivés sur sa feuille, la plume à la main. Il n’est pas certain qu’il ait prêté grande attention à ce qu’elle venait de lui dire. – … et… euh… enfin… je me suis dit que vous en connaissiez peut-être la propriétaire… – Plaît-il ? – Ou peut-être pas, rectifia-t-elle précipitamment. En effet, nous ne recevons pas souvent de visiteuses, et l’objet en question a pu être été égaré de longue date. Il est assez petit pour que personne ne l’ait remarqué à l’époque, et votre fils dit qu’il était recouvert d’une couche de terre assez conséquente. – Vous ne m’avez toujours pas dit ce qu’est précisément l’accessoire en question. – Oh, pardonnez ma distraction. Il s’agit de ceci. Elle contourna le bureau et présenta sa paume ouverte à mon père. Son intérêt semblait cette fois complètement éveillé, et à la vue de la bague il écarquilla un instant les yeux en s’appuyant au dossier de son fauteuil. Quelques secondes de réflexion, puis s’avançant à nouveau il ramassa vivement l’anneau d’or resté au creux de la main tendue de Lucie. – Vous avez bien fait de me l’apporter immédiatement, dit-il en l’enfouissant dans l’un des tiroirs de son bureau. Je vais m’occuper de sa restitution, ajouta-t-il en se replongeant dans ses dossiers. S’il m’avait paru un instant intéressé, voire troublé par notre découverte, ce ne fut qu’une impression très fugace car il avait à nouveau les yeux rivés sur sa feuille. Entendant Lucie prendre congé et la voyant se tourner vers la porte derrière laquelle nous nous trouvions, nous décidâmes tacitement qu’il était grand temps pour nous de nous éclipser. Juste après l’angle du couloir Clément heurta Jean-Baptiste de plein fouet. Je crois qu’il venait de nous voir écouter à la porte, mais il n’en dit mot à personne, ce dont nous lui fûmes reconnaissants. Nous étions déjà assez déçus de l’accueil que Lucie avait fait à notre cadeau, nous n’étions pas d’humeur à subir en plus ses remontrances pour avoir espionné nos parents. Dire qu’elle n’avait pas gardé notre bague ! Elle ne l’avait pas même enfilée une seule fois… Huit mois plus tard, une pneumonie nous enlevait notre chère Lucie à tout jamais. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Mer 20 Mar 2013 - 13:43 Mer 20 Mar 2013 - 13:43 | |
| V Enfant, il m’arrivait rarement de penser à mon défunt père. Quant à ma mère, elle n’en parlait guère. Des quelques fois où je l’ai interrogée sur lui, j’avais appris qu’il avait les yeux verts. Ce devait être le détail qui l’avait marquée le plus, car c’était ce qui revenait en premier lorsque je lui demandais de le décrire. Un homme grand, au regard clair, de belle carrure, à la blondeur contrastant avec le teint hâlé de ceux qui travaillent souvent en plein air. Un homme qui, si l’on exceptait ses mains de charpentier et sa peau tannée, devait plaire aux femmes. Je crois que ma mère avait été particulièrement fière, au jour de son mariage, d’être celle qu’il avait choisie. De cette beauté solide, je n’avais rien hérité ; j’étais trop maigre, bien plus petit que les autres enfants de mon âge, et loin d’avoir la chevelure dorée de mon père, j’étais d’un châtain qui me désespérait par sa banalité, bien que j’admirasse sans réserves cette couleur de cheveux sur ma mère. Ma constitution chétive, séquelle d’après elle des semaines de grande faiblesse que j’avais traversées juste après ma venue au monde, accentuait mon impression d’insignifiance au milieu des garçons de mon âge. Par chance, en un sens, Cyprien et moi étions rarement au contact d’autres enfants, et j’avais très tôt renoncé à me comparer à lui. Ma mère était grande elle aussi, et je ne parvenais donc à blâmer personne pour ma petite taille. On imagine combien, lors de mes jeunes années, j’ai pu en vouloir à la nature, ou au hasard, ou tout de même à mes parents de m’avoir doté d’une charpente aussi frêle. Ironique lorsqu’on songe au métier de feu mon père… Le seul détail de mon apparence que j’aimais était la couleur de mes yeux. D’un bleu assez foncé, très différent paraît-t-il du vert de ceux de mon père, ils ne rappelaient non plus en rien les grands yeux noirs de ma mère, ce regard ténébreux qu’elle savait rendre tour à tour si doux ou si sévère. A sa mort, je perdis toute possibilité de me référer à une quelconque filiation, n’ayant pour ainsi dire eu de père qu’officiellement, et plus non plus de grands-parents que je n’avais de toute façon pas connus. Mais jamais, même à cet instant-là et pour si horrible qu’il fût, je n’ai vraiment ressenti l’impression d’avoir perdu le dernier membre de ma famille, grâce à la place inclassable mais inébranlable que depuis toujours j’avais eue auprès de Cyprien ainsi qu’au sein de la “famille” que nous formions avec nos deux parents survivants. Mais surtout, à sa mort je compris à quel point il était difficile, voire douloureux, d’évoquer une personne aimée trop tôt disparue. Et je compris alors pourquoi elle m’avait si peu parlé de feu mon père, son mari, que par ailleurs je n’avais pas connu et qui n’avait donc eu à mes yeux d’existence qu’abstraite ; ce n’est que dans le froid de ce deuil que je réalisai qu’il avait, pour elle, été présence, visage, expressions, paroles, voix, avant même de n’être plus que “mon père”. Et à la lumière de ceci, je compris également pourquoi le comte ne parlait jamais de la mère de Cyprien, sa seconde épouse qui, elle aussi, lui avait été arrachée. Si je n’avais que rarement évoqué mon père avec Cyprien, lui-même n’avait jamais parlé de sa mère, sans doute parce que d’elle, il ne connaissait rien d’autre qu’un nom, une généalogie, une date de naissance et une autre de décès. Nous n’avions même aucune idée de son visage, et les quelques fois où l’on évoquait la défunte en présence du comte, son visage s’assombrissait, ses yeux semblaient s’obscurcir. Dans ces moments-là, il se répandait sur lui comme une immense tristesse, comme une douleur étouffée mais pas encore éteinte, comme l’éternel regret d’une insouciance à jamais perdue. Devant ce sentiment de malaise assez contagieux, nous avions jugé plus délicat de faire en sorte de ne jamais aborder le sujet. D’ailleurs Cyprien lui-même n’éprouvait pour l’inconnue qu’une curiosité modérée, tant ma propre mère était impliquée dans son éducation, tant elle lui avait tout naturellement témoigné l’affection que l’on porte à un enfant qu’on élève. Je crois bien, avec le recul, qu’il s’était presque autant que moi senti orphelin à sa disparition. Comme pour la première fois. Pas orphelin d’un père ou d’une mère que nous n’avions jamais connu, mais orphelin d’un parent qui, des années durant avait été là, auprès de nous, nous avait élevés, nous avait réprimandés, nous avait choyés, nous avait appris la majeure partie de ce que nous savions. Nous avait aimés. * La mort de Lucie plongea la maisonnée dans une nuit sourde et glaciale. C’était l’hiver et aucun rayon de soleil ne venait réchauffer d’une douce caresse nos cœurs gelés, presque arrêtés. Dans les branches nues des arbres du parc, nulle feuille pour bruisser. Il n’y avait d’ailleurs ni vent pour nous siffler aux oreilles ou faire bouger portes ou fenêtres, ni pluie pour marteler les vitres ou faire pleurer les carreaux. Nous même ne pleurions pas. Rien que ce froid et cette inertie qui ralentissait la vie de toute la maison. Jusqu’à Jean-Baptiste qui ne nous rapportait plus ce qui s’y passait, sans doute parce que justement il ne s’y passait plus rien. Jusqu’à mon père qui, n’étant déjà pas souvent gai, nous semblait plus morne encore qu’à l’accoutumée. Du moins était-ce ainsi que notre humeur triste nous le faisait paraître. Et c’est à ce moment que je commençai à comprendre le caractère solitaire et fermé de mon père ; il avait perdu beaucoup de proches au cours de sa vie : son frère, ses parents, sa première épouse, puis ma mère. Le décès de Lucie devait lui rappeler cette omniprésence de la mort autour de lui et il devait craindre pour moi, son fils, le dernier membre de sa famille encore vivant. Puis, coïncidence ou non, c’est avec l’arrivée du printemps que la maison commença à revivre et l’atmosphère à s’y réchauffer. La torpeur qui l’avait prise à la mort de Lucie se dissipa peu à peu. Mon père avait écrit à sa belle-mère, la baronne de Trevinou, pour la convier à s’installer chez nous. Un arrangement qui convenait aux deux partis : ma grand-mère étant veuve depuis peu, elle s’habituait mal à sa solitude nouvelle, et de son côté mon père pouvait ainsi me confier aux soins d’une personne de confiance. En toute logique, aurais-je vu le jour une vingtaine d’années plus tôt, je serais alors probablement allé étudier au collège jésuite de Rennes. Encore que mon père, lors de l’affrontement entre le Parlement de Bretagne plutôt favorable aux jansénistes d’une part, et le duc d’Aiguillon, gouverneur de Bretagne soutenu par les jésuites d’autre part, s’était rangé à l’avis du Procureur Général contre les tentatives de coup de force du pouvoir absolu. Et mon père étant homme à vivre ses principes autant qu’à les inculquer, il n’aurait sans doute pas poussé le souci de mon éducation jusqu’à la confier à la Compagnie à laquelle par ailleurs il s’opposait. Fût-ce aux dépens de mon instruction. Mais la question ne se posait plus en 1777 : le roi avait finalement chassé les jésuites du royaume quelques années auparavant, en 1764, et mon père n’envisageait plus de m’envoyer au collège mais fit venir un précepteur pour me dispenser un enseignement dont Clément put lui aussi bénéficier. Je veux croire que c’est Lucie qui de son vivant influença le choix de cette option, afin d’assurer à son fils une instruction qu’il n’aurait pas eue si j’avais été envoyé en pension. Nous fûmes donc confiés aux bons soins de ma grand-mère Anne Louise Catherine de Carnoët, baronne de Trevinou, et de notre précepteur Yann-Fañch Kloareg (ou Jean-François Cloarec en ville). Ma grand-mère n’avait que quelques années de plus que mon père, mais nous pensions plus à la comparer à Lucie qu’à lui, et elle nous paraissait donc être une vieille femme. Et puis, on pardonne tellement plus facilement son âge à un homme qu’à une femme… La proposition que mon père lui fit de s’installer chez nous l’arrangeait à plus d’un titre. Les Trevinou étaient une famille qui, pour être noble depuis des temps immémoriaux, n’en était pas moins pauvre. Le maigre revenu de leurs terres leur permettait tout juste d’entretenir leurs gens et leur pigeonnier. Avec la mort du baron qui, en plus de gérer ses terres avait plus d’une fois déposé son épée à l’entrée d’un champ pour aller lui-même y travailler, ma grand-mère craignit de devoir s’endetter ou se séparer d’une partie de ses gens. Mon père promit de prendre en charge l’entretien de leur manoir et la gestion de leurs terres. Des six enfants de cette famille, ma mère et son jeune frère étaient les seuls qui avaient survécu à la scarlatine qui avait frappé la famille alors qu’ils étaient encore petits. Mon oncle avait choisi de tenter sa chance sur les mers en s’enrôlant dans la Royale (de quoi nous faire rêver, Clément et moi) mais la frégate à bord de laquelle il servait avait coulé en mer des Caraïbes en 1772. * La baronne de Trevinou, grand-mère de Cyprien, ne me parut pas de prime abord d’un naturel très gai, mais elle était tout velours et tout gentillesse. Elle avait bien des raisons pour avoir au fond du regard cette mélancolie que nous lui connûmes assez rapidement. Elle avait vu mourir l’un après l’autre tous ses enfants, puis enfin son mari pour finalement se retrouver seule avec pour toute famille son unique petit-fils. Elle voyait déjà sa vie finie alors qu’elle n’avait pas encore l’âge d’entrer dans la tombe. La seule lueur de son existence serait désormais d’élever Cyprien. Elle se prit vite d’affection pour moi, l’orphelin sans naissance. Je crois qu’elle accepta vite le lien indescriptible qui m’attachait à cette maison et à Cyprien, sans pour autant totalement comprendre le rapport quasi fusionnel qui s’était tissé au fil des ans entre lui et moi. Je crois également qu’elle non plus n’oubliait pas que si je n’avais pas eu de père, c’était parce que celui-ci était mort en tâchant de défendre sa fille. Et elle me dit aussi plus d’une fois que, par mon gabarit et mon regard, je lui rappelais quelque peu son défunt fils, celui-là même qui avait péri en mer. En Cyprien, elle retrouvait la blondeur des cheveux de sa fille. Pour toutes ces raisons, nous trouvâmes place en son cœur ; c’était pour elle un peu comme si elle avait deux petits-fils au lieu d’un. Quelques années plus tard, en y repensant, je ne pourrais m’empêcher de trouver que le comte et la baronne avaient deux manières bien différentes de vivre leurs deuils respectifs. Là où lui s’était enseveli dans le travail et réfugié dans une certaine distance pouvant passer parfois pour de la froideur, elle avait choisi d’être une fontaine de tendresse en restant au milieu des vivants, comme pour se rassurer en étant au plus près de ceux qui lui restaient. Et là où le comte était plutôt renfermé et taciturne, elle était devenue avec le temps un véritable moulin à paroles, allant jusqu’à supplanter Jean-Baptiste qui pourtant était un bavard impénitent. * Un jour de printemps, peu après l’arrivée de ma grand-mère me semble-t-il, Clément et moi étions en train de nous exercer à l’épée près du mur d’enceinte du parc lorsqu’un rayon de soleil faisant étinceler le pommeau de la mienne produisit un éclat de lumière qui ne fut pas sans nous rappeler un certain serpent d’or trouvé l’été précédent, enterré au pied d’un arbre. C’était avant, du temps où Lucie était encore avec nous, avant cet hiver si froid, si nu et si vide, avant que… Avant. – Sais-tu ce qu’a fait ton père de cette bague ? demanda Clément. – Aucune idée, répondis-je, et je n’ai guère envie de l’interroger à ce sujet, notre trouvaille n’a pas eu l’air de l’enchanter… Non, je sais ce que tu vas penser, mais tu te trompes : elle n’appartient pas à une dame dont Père voudrait taire les visites. – Je n’ai rien insinué de la sorte. – Oh, tu as la délicatesse de ne pas le formuler, relevai-je alors, mais je sais que c’est une idée qui a un instant traversé l’esprit de ta mère lorsqu’elle est allée la lui porter. A l’évocation de Lucie nous nous tûmes tous deux, tandis que je sentis une affreuse et désormais familière douleur me descendre la gorge. Luttant de toutes mes forces pour ne pas laisser déborder les larmes que dans le même temps je sentais monter à mes yeux, je fixai le sol en attendant que le malaise physique passât. Lorsque ce fut chose faite, je ne savais plus comment dissiper le silence qui venait de s’inviter au milieu de notre conversation jusque là plutôt anodine. Je tentai une diversion : – Dans le fond, je crois que tu avais raison, il est possible qu’il y ait ici un trésor enterré depuis des décennies, peut-être même des siècles. Imagine un peu si nous le trouvions… – Mais cette fois, enchaina Clément, nous garderions nos trouvailles pour nous-même, me répondit-il d’un ton décidé. Je n’aurais pas envie qu’elles disparaissent sous notre nez comme cet anneau d’or et de nacre. – Je ne saurais par où commencer à chercher, dis-je désemparé par la taille de l’immense parc à fouiller. – Sans doute par les environs de là où se trouvait la bague. Quoique… C’est étrange, poursuivit-il, car si je devais enterrer un trésor, je n’irais pas le faire là où je pourrais être vu depuis les fenêtres de la maison. – Tiens, oui, répondis-je, je n’avais pas pensé à cela… sauf si celui qui l’enterre a des raisons de croire les lieux déserts. – Moi, je pense soudain à autre chose, lança Clément après un froncement de sourcil caractéristique chez lui d’une intense réflexion. Ceux qui l’ont enterré l’ont certainement fait avec l’intention de revenir le chercher. Il fit une pause. Énoncé ainsi, cela sonnait l’évidence même. Nouveau froncement de sourcil, puis il reprit: – Alors pourquoi ne sont-ils pas venus le récupérer ? Je ne me posais pas tant de questions, ou ne voulais pas m’en poser. L’hypothèse d’une maîtresse clandestine aurait ainsi été plus vraisemblable, mais je me refusais catégoriquement à l’envisager. Alors non, il devait en être autrement. Il devait absolument y avoir un trésor enfoui dans le sol du parc. – Suis-moi, lui lançai-je brusquement en me mettant en marche, direction la remise du jardinier, nous allons nous munir de pelles. – Quoi, tout de suite ? demanda-t-il, surpris, en trottinant quelques pas derrière moi. * Les outils étaient rangés dans une annexe de la remise où étaient abrités les attelages. Tout comme l’écurie, elle était l’œuvre de mon père, du moins pour la partie charpente que le comte avait fait rénover l’année précédant ma naissance. Il avait apparemment été satisfait du travail effectué car il avait à nouveau fait appel à lui pour réparer cette fois les écuries, tâche à laquelle il travaillait, malgré l’heure tardive, le soir où il fut tué. Maman disait qu’il était un artisan très apprécié dans les environs pour la qualité et le sérieux de son travail. Elle le disait acharné à la tâche, au point qu’il restait souvent travailler jusque tard dans la soirée, jusqu’aux heures de la tombée de la nuit : à croire, d’après elle, qu’il n’y avait que l’obscurité qui pouvait l’arracher à sa tâche. Bien entendu, si elle choisissait de me parler de cela malgré notre habituel et mutuel mutisme concernant mon père, ce n’était pas anodin. Elle espérait ainsi me pousser à témoigner plus tard du même acharnement à la tâche que celui dont il avait fait preuve. Elle avait tendance à trouver que je n’étais pas assez assidu à l’étude. D’ailleurs je crois bien que personne ne l’aurait été suffisamment à son goût, elle était si exigeante sur ce point ! Encore un trait de son caractère qui convenait parfaitement au comte. Si mon père était resté en vie, j’aurai certainement fait mien son métier. Je dois dire que cela ne m’aurait pas déplu, je crois. J’étais plutôt habile de mes mains et assez sensible au charme de ces planches et poutres se chevauchant ou s’entrecroisant. Plus tard, je me suis demandé pourquoi, mon père et le maître-artisan qui l’employait ayant tant de succès et de commandes, nous nous étions retrouvés ma mère et moi avec si peu d’argent après sa mort. Il est vrai que la rétribution d’un compagnon-charpentier devait être plutôt maigre. Heureusement que le comte nous avait recueillis, car je ne sais de quoi nous aurions vécu. Avec le récent trépas de ma mère, j’avais pris connaissance de ce en quoi consistait mon héritage : à part un coffre sculpté venant de mes grands-parents, un lit et une table fabriqués par mon père lui-même, ne restait de lui qu’un pécule bien maigre qui à lui seul ne m’aurait pas permis de vivre bien longtemps, et une masure délabrée inhabitée depuis presque dix ans et que ma mère aurait dû vendre bien des années auparavant. Toutefois, le reste des gages qu’elle avait gagnés au service du comte venaient grossir mon pécule et éclaircir le tableau. Restaient aussi les quelques vêtements de ma mère dont le mieux que je pus faire fut de les confier au recteur de la paroisse afin qu’il les distribuât aux nécessiteux. Mais plus que jamais, j’étais dépendant des Tanhouët, et plus que jamais je leur fus reconnaissant. Je fus arraché à mes réflexions par Cyprien qui me flanquait d’autorité une pelle dans les mains. – Prends celle-ci, me dit-il, et suis-moi. Et nous reprîmes notre procession à travers le parc, lui ouvrant la marche et moi le suivant de peu. Nous nous mîmes à creuser un peu au hasard, de ci de là, dans l’espoir de mettre au jour je ne sais quel coffre rempli de bijoux, je ne sais quel sac gonflé d’or. Lorsque le trou était suffisamment profond selon nos estimations – ou selon notre degré de fatigue – nous l’abandonnions pour aller creuser ailleurs. Inutile de préciser que nous ne trouvâmes rien de plus intéressant que deux fers à cheval et le squelette de ce qui semblait avoir été un rat. Nous attaquions le huitième trou lorsque Soazig, la cuisinière qui faisait également office de lavandière, nous aperçut en se rendant au potager, un panier vide à la main. Elle se mit à pousser de hauts cris. – … couverts de terre que vous êtes ! Mais regardez-vous donc tous les deux ! Monsieur Cyprien, une si belle chemise ! Et comment que je vais faire, moi, pour la ravoir blanche, maintenant ! Et d’un pas alerte, elle s’en alla moucharder auprès de la baronne au cri de : – Madame ! Madame ! Vous n’allez pas croire ce qu’ils ont encore inventé. Madame ! Soazig était certes en cuisine une artiste hors pair, mais en dehors de l’office manquait cruellement de la plus élémentaire fantaisie, me dis-je alors. La réaction de la baronne fut à peu près similaire : – Mes enfants ! Mes enfants ! Mais enfin, qu’êtes-vous donc en train de faire ? – Nous creusons, chère Grand-Mère ! Nous sommes à la recherche d’un trésor… – Madame, l’année dernière nous avons déterré un bijou au pied d’un arbre. Il y en a sûrement d’autres ; sinon, quel intérêt y aurait-il à enterrer une bague ? Je veux dire, à n’enterrer que cela ? – Que me chantez-vous là tous les deux ? Et qu’est-ce donc que cette histoire de bijoux ? À ma connaissance, l’or ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval, ajouta-t-elle, contente de sa plaisanterie, en jetant un œil à notre maigre butin. * Mon père arriva bientôt, attiré par les exclamations de ma grand-mère et de la cuisinière. Lorsqu’il découvrit le spectacle qui s’offrait à ses yeux, il se figea et blêmit. Il est vrai que nos habits étaient souillés, mais c’était sur le sol autour de nous que son regard était fixé. Certes les petits cratères que nous avions creusés et les mottes de terre que nous avions disséminées alentours rendaient une impression de dévastation, mais enfin c’était très localisé et serait vite arrangé, ce que je lui assurai aussitôt. – Non, n’y touchez plus ! rugit-il. Vous en avez déjà assez fait tous deux. Allez donc vous nettoyer et vous changer. – Je vais aller dire à Youenn de venir réparer ce désastre, dit ma grand-mère. Youenn était le vieux gardien qui faisait également office de jardinier. Il habitait dans une petite maison adossée au mur d’enceinte. – Non, laissez cela, je vais m’en occuper moi-même. Reconduisez plutôt les enfants à l’intérieur. – Mais enfin vous n’allez tout de même pas faire des travaux de ce genre ! Vous… – Laissez, vous dis-je, et occupez-vous des enfants ! coupa-t-il abruptement. S’il vous plaît, ajouta-t-il d’un ton radouci. Nous fûmes donc ramenés, savonnés et changés, alors que par la fenêtre je voyais au loin mon père s’acharner à reboucher les trous que nous avions creusés. Après quoi il vint nous voir pour nous adjurer d’abandonner enfin cette marotte que nous avions depuis des années sur les histoires de trésors cachés, de forbans et de boucaniers. On aurait cru entendre Lucie. Il termina en nous interdisant à l’avenir de chercher d’hypothétiques trésors en général, et de creuser le moindre trou dans le parc en particulier. Sur le moment, mon désappointement fut grand devant son manque patent d’imagination, mais je m’en consolai bien vite en devinant qu’il nous estimait un peu âgés maintenant pour ce genre de contes, et trouvait qu’il était plus que temps pour nous de cesser les enfantillages pour enfin mûrir un peu. Ce devait être aussi cela, grandir. Laisser derrière soi une part de ce qui avait rempli les années passées. Une part de naïveté, aussi. Et de fantaisie. Sans pour autant les abandonner, non ; les ranger dans une case, plutôt. Dans un tiroir où l’on saurait aller les rechercher de temps à autres, lorsque le besoin s’en ferait sentir où quand le moment s’y prêterait. Une sorte de boîte à malices aux tréfonds de soi-même. Afin de ne pas chagriner mon père qui m’avait semblé plus touché par cette affaire que j’aurais pu le croire, je décidai dès ce jour de commencer à ranger dans cette boîte à malices ce qui appartenait trop au monde de l’enfance ; ce monde, Clément et moi avions d’ailleurs déjà commencé à le laisser derrière nous avec la mort de Lucie. En vérité, je crois que c’est ce choc brutal qui marqua la fin de cette époque et sonna prématurément le glas de notre enfance. Nous tentions bien encore vainement de nous y raccrocher de temps à autres, comme ce jour-là en faisant revivre nos vieux passe-temps et amusements, mais le cœur y était-il encore vraiment ou bien n’étions-nous qu’en train de nous jouer une comédie à laquelle nous voulions tant encore croire ? Car après tout, c’était surtout pour distraire Clément de sa tristesse à l’évocation de sa mère que je lui avais proposé cette idée puérile de chasse au trésor, et lui avais presque forcé la main pour la réaliser. Et je me sentis alors tiraillé entre l’envie de sortir mon ami des vagues de douleur qui menaçaient de remonter en lui d’une part, et celle de ne pas décevoir mon père et ses espoir de me voir grandir et me comporter en un jeune homme raisonnable et accompli d’autre part. Tiraillé entre les deux personnes qui comptaient le plus au monde. Tiraillé entre mon devoir d’ami et mon devoir de fils. Entre fantaisie et raison. Entre enfance et âge adulte. Entre l’amour envers un frère et l’amour envers un père. Et lorsque que comme ici ces deux voies partaient dans des directions différentes, lorsque le chemin semblait diverger, je regrettais de ne pouvoir me dédoubler afin d’être en mesure de suivre les deux à la fois. Je ne voulais pas me retrouver dans l’inconfortable situation de devoir faire un choix. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Jeu 2 Mai 2013 - 21:12 Jeu 2 Mai 2013 - 21:12 | |
| Commentaire sur la fic:iciChapitre VI : Promenons-nous dans les bois Notre nouvelle vie, sans ma mère mais avec la grand-mère de Cyprien, s’organisa peu à peu. La baronne s’impliquait un peu moins que maman dans notre éducation, mais il faut aussi reconnaître que nous n’étions plus vraiment des enfants. Du moins ne nous considérions nous plus comme tels. A dire vrai, il n’aurait pas fallu beaucoup nous pousser pour nous faire prétendre être tout près maintenant de l’âge adulte. D’autre part, madame de Trevinou n’avait plus depuis longtemps l’âge qu’avait ma mère et ne s’imaginait donc plus chargée d’élever des enfants. Enfin, elle s’en serait peut-être voulu de prendre la place et le rôle qu’aurait dû tenir sa fille dont le souvenir venait d’être ravivé en elle par sa nouvelle situation. En effet, elle venait de s’installer sous un toit dont sa chère enfant avait jadis été la maîtresse. Pour peu de temps, certes, trop peu pour que celle-ci y laissât sa marque ou même un souvenir notable, mais elle avait tout de même été ici chez elle. Ce devait être un fort cruel dilemme, ou bien un délicat numéro d’équilibriste, que d’avoir à trouver sa place sur les traces mêmes de sa fille sans pour autant usurper le rôle que celle-ci aurait dû tenir. Pour ces différentes raisons, madame de Trevinou choisit donc de s’en tenir au rôle de grand-mère, se chargeant plus de veiller sur nous que de nous élever. Ce dont nous lui fûmes d’ailleurs infiniment reconnaissants : nous étions parvenus à un âge auquel nous pensions déjà être suffisamment grands pour ne plus avoir besoin d’être éduqués comme le sont les enfants, et de plus nous n’aurions pas accepté que quiconque crût pouvoir remplacer ma mère auprès de nous. Il n’existait qu’une seule Lucie Guermeur et nous venions de la perdre. C’était désormais sans elle qu’il nous faudrait poursuivre notre route, et vivre. Ceci étant dit, la baronne était pour nous débordante d’affection et d’attentions. D’indulgence, aussi. Elle était d’ailleurs envers nous bien moins exigeante que ma mère. En revanche, lorsqu’un problème se présentait elle allait plus souvent en référer au comte, fidèle à son choix, en tant que grand-mère de ne pas empiéter sur le rôle des parents. * Au cours de l’hiver suivant, aux alentours du 14 février, date du décès de Lucie, le ciel sembla lui aussi se souvenir de cette disparition : il se tapissa de nuages gris et bas, le temps devint pluvieux, le sol détrempé, les vitres ruisselantes, les branches dégoulinantes. Il me semblait que les alentours pleuraient notre chagrin avec une année de retard. Afin d’écarter Clément de la mélancolie qui le guettait en cette période anniversaire, je profitai d’une après-midi d’accalmie, et même d’ensoleillement, pour lui proposer une promenade à cheval dans la campagne. Clément montait très bien, mieux que moi. Il me semblait même qu’avec sa monture il formait une seule et même créature, un centaure dont lui était la tête, et le cheval les jambes. Celui-ci n’ayant du reste que très peu de poids à supporter lorsque Clément le montait, il fatiguait moins vite et pouvait galoper à vive allure. Une chevauchée sur nos terres était donc souvent un bon moyen d’éclaircir son humeur. J’avais un superbe pur-sang que mon père m’avait offert à l’occasion de mon dixième anniversaire. Il était plutôt rapide – mais pas encore suffisamment pour me permettre de souvent battre Clément à la course – et de caractère assez doux mais se montrait parfois têtu, si bien qu’aux débuts j’eus quelques peines à me faire obéir de lui. Je l’avais baptisé Morvarc’h. Clément, lui, montait généralement Hanternoz, une jument assez calme elle aussi, que mon père avait fait ramener trois ans plus tôt de la foire de Landivisiau. Nous fîmes d’abord le tour des environs à travers champs et prairies ; bref, les alentours immédiats de Tanhouët. La forêt qui s’était plusieurs siècles auparavant étendue jusque là avait depuis longtemps dû céder la place aux cultures qui permettaient de nourrir mais aussi de vêtir l’homme, ainsi que de pourvoir à ses autres besoins. Nous faisions par exemple cultiver du chanvre que mon père vendait aux arsenaux pour la fabrication des cordages, ainsi que du lin pour celle des voiles. Les arbres, dont la coupe était un des privilèges de mon père, fournissaient du bois qui était lui aussi vendu aux arsenaux et aux chantiers navals. C’est dire à quel point, même chez les paysans, hommes de la terre, s’invitait le monde de la mer et des marins. D’ailleurs il se trouvait même certains fils de nos métayers qui choisissaient de partir travailler à Brest comme ouvriers à l’Arsenal. Il faut dire que depuis plusieurs années, la construction navale s’était intensifiée : la dernière guerre s’était soldée par un fiasco et tous rêvaient de prendre une revanche sur l’Anglais qui nous avait tant maltraités à l’issue du conflit : aux dommages subis par la flotte était venue s’ajouter la perte de nombreux territoires. Depuis, un effort particulier avait été fait en faveur de la Royale, car jusqu’alors la flotte anglaise représentait à elle seule la moitié des navires de guerre en Europe. Plus traditionnellement poussaient également sur nos terres du froment, du seigle, du blé noir, de l’avoine. Leurs pâturages accueillaient quelques troupeaux de vache, et les basses-cours fournissaient aux fermiers poulets, œufs, oies et coqs. * Tout en faisant aller nos montures au pas, nous discutions de choses et d’autres. Nous avions pris de Jean-Baptiste la fort mauvaise mais très instructive manie d’écouter discrètement ce qui se disait dans la maison. Ma mère détestait ce genre de manières et avait toujours témoigné envers lui d’une froideur plutôt inhabituelle de sa part. Elle était naturellement souriante et bienveillante envers autrui, en particulier le reste du personnel de la maisonnée. Elle n’oubliait pas d’où elle venait de part son mariage et, malgré la situation privilégiée à laquelle elle avait accédé, se sentait proche d’eux. Mais l’attitude de Jean-Baptiste l’indisposait ; elle s’était bien vite rendu compte de sa trop grande curiosité et la trouvait malsaine. Elle détestait se sentir espionnée. Elle en avait plusieurs fois glissé un mot au comte, mais celui-ci paraissait n’attacher qu’une importance minime au petit défaut de son valet et semblait trop attaché à lui pour s’en séparer. D’ailleurs, les bavardages de Jean-Baptiste ne portaient jamais trop à conséquence, tant sa curiosité s’attachait à des broutilles. De son côté, le valet ne la portait pas particulièrement dans son cœur en retour, bien qu’il ne se soit jamais ouvertement ouvert de cela à nous. Je pense qu’il lui reprochait de se vouloir au dessus de sa condition, du fait de son niveau d’instruction, et sans doute jalousait-il aussi un peu la confiance qu’elle avait au fil des ans acquise auprès du comte dont il avait en un sens été jusque là – et de part ses fonctions – le domestique le plus proche. En revanche, Jean-Baptiste nous avait toujours bien aimés. Je crois que comme tout le monde il était heureux de voir des enfants dans cette maison, même si cela lui donnait bien plus de travail. Il nous faisait souvent part de ses confidences, et par là même – étant donné sa mauvaise manie – de celles des autres… la frontière entre les deux paraissant manifestement assez floue à ses yeux. Informés de presque tout ce qui passait dans la maison, grâce à la complicité de Jean-Baptiste d’une part et à nos talents d’espions d’autre part, nous profitions souvent de moments de solitude hors de portée des oreilles indiscrètes – dont nous avions appris à nous méfier – pour échanger des commentaires sur ces sujets. * En devisant ainsi de choses et d’autres, nous arrivâmes en lisière de forêt. A dire vrai, il s’agissait plus d’un grand bois, mais Clément et moi avions toujours eu une certaine tendance à l’exagération, afin de transformer en grandes aventures ce qui n’était somme doute que de banals faits divers. Lorsque nous étions enfants, Lucie nous avait toujours interdit de pénétrer seuls dans les bois. Mais à présent Lucie était morte, et nous n’étions désormais plus des enfants. Nous n’avions d’ailleurs pas attendu cela pour lui désobéir, et ce à plusieurs reprises. Jamais rien ne nous y était arrivé de fâcheux. C’était bien pour cela d’ailleurs que personne n’en avait jamais rien su. Sauf peut-être Jean-Baptiste, s’il avait laissé traîner ses oreilles près de ma chambre. Nous laissâmes nos montures entrer au pas dans le bois et, peu à peu, s’y enfoncer. Nous n’y avions encore jamais avancé bien loin, l’exploration de la lisière nous suffisant à braver l’interdit. Mais voici que nous étions arrivés à un point où, quelle que soit la direction dans laquelle nous portions le regard, nous ne voyions rien d’autre que des arbres derrières lesquels se dressaient d’autres arbres. Il n’y avait plus moyen d’apercevoir un champ ou un pré au travers de cet entrelacs touffu de troncs et de branches pourtant nues. Préférant éviter de nous enfoncer trop profondément dans la forêt afin de n’avoir pas une trop grande distance à parcourir pour en ressortir, je bifurquai sur un sentier de traverse. Il partait perpendiculairement au chemin communément emprunté par les attelages sur lequel nous étions restés jusque là, et était bien plus étroit. C’était un petit chemin creux aux parois moussues enfoncé une demi toise en contrebas du pied des troncs. Le sol, couvert de feuilles mortes en décomposition, était détrempé ; chacun des pas de nos chevaux produisait un bruit de succion lorsqu’ils soulevaient un sabot. D’ailleurs il nous semblait que la terre ici ne devait jamais être complètement sèche, tant il paraissait que le soleil peinerait à pénétrer l’enchevêtrement de branches feuillues aux beaux jours ; seul le soleil d’hiver pourrait peut-être caresser cette terre humide, mais cela faisait plusieurs jours qu’il n’avait pas percé la couche épaisse de nuages gris qu’aucun vent n’était venu balayer. Nous étions parvenus à une portion très sombre du bois, où les arbres étaient si rapprochés que leurs brindilles nous cinglaient le visage de part et d’autre. Les troncs montaient très haut, et le jour déjà peu lumineux avait commencé à décliner. Un frisson me parcourut l’échine, et je me rendis compte que cela faisait bien deux ou trois minutes que ni l’un ni l’autre n’avions dit mot. Je me retournai en direction de Clément et vis que lui aussi semblait sensible à l’atmosphère lugubre de ces lieux. * Au fur et à mesure que nous nous étions enfoncés dans le bois, nous avions parlé de moins en moins fort. De moins en moins tout court, d’ailleurs. Il nous fallait bien sûr prêter attention aux branches qui encombraient le passage à notre hauteur, ainsi qu’à nos chevaux qui avaient de plus en plus d’obstacles à éviter, mais ce n’était pas la seule raison de notre silence. Il se répandait au milieu de ces arbres nus et désolés une atmosphère sombre et sinistre, accentuée par la relative obscurité qui y régnait. Le sentier remonta une légère pente et tandis que les bas-côtés semblaient fondre au fur et à mesure de notre progression, nous nous retrouvâmes au même niveau que le reste de la forêt. Plus de chemin creux. Plus de chemin du tout, d’ailleurs. J’arrêtai Hanternoz, la jument que je montais, et fixai devant moi le dos de Cyprien. Je le vis s’arrêter puis me lancer un regard par-dessus son épaule droite. Il paraissait tendu. Quelque part au dessus de nos têtes retentit un grincement sec : rien que le cri d’un corbeau, mais je sentis un nouveau frisson me remonter le long du dos. Un battement d’ailes tout près de moi me fit brusquement lever les yeux : une tache noire traversa à vive allure le plafond de branchages. Ce n’était pourtant rien d’autre qu’une corneille prenant son envol, mais décidément, cet endroit me mettait mal à l’aise. Cyprien se retourna et fit, difficilement, faire un quart de tour à Morvarc’h. L’étroitesse de ce qu’il restait de sentier ne facilitait pas la manœuvre. Des branches griffèrent la croupe du cheval qui pourtant ne broncha pas. Cyprien s’immobilisa de nouveau, à l’affût du moindre mouvement, du moindre bruit. — Tu as entendu ? me demanda-t-il à voix basse. — Entendu quoi ? chuchotai-je. — Il m’a semblé… Je ne sais… Mais toi, n’as-tu rien entendu ? — Tu veux dire, à part ton cheval piétiner et les branches bouger ? — J’avais cru… Non, je ne suis pas certain, à dire vrai. Non… non, il n’y a pas eu d’autre bruit. Le sentier devient difficilement praticable, je ne voudrais pas que nous blessions les chevaux. Demi-tour et rentrons, il se fait tard et nous avons promis de rentrer avant la tombée de la nuit. Ne pas blesser les chevaux… Bien sûr ! Aucun rapport, évidemment, avec l’atmosphère inquiétante régnant en ces lieux. Et rentrer avant la nuit ! Comme si pareille recommandation nous avait jamais auparavant retenus de prolonger nos escapades… Mais pour cette fois, j’étais plutôt heureux de cette proposition, et surtout très soulagé que ce fût Cyprien qui l’eût formulée. Je ne parvenais à me départir du sentiment de malaise qui m’avait envahi depuis que nous avions pénétré dans cette forêt, mais pour rien au monde je n’aurais voulu être le premier à en faire montre en demandant à rebrousser chemin. Après un demi-tour quelque peu laborieux je me trouvai cette fois en tête, ouvrant la marche sur l’étroit sentier encombré de branchages. Il faisait de plus en plus sombre et tout, autour de nous, semblait avoir viré au gris foncé. Des craquements secs accompagnaient notre progression et nous ne pipions mot. On aurait dit un cortège funèbre traversant les bois. Puis peu à peu, le sentier s’élargit et j’aperçus non sans soulagement à quelques pas devant moi l’intersection avec le chemin principal traversant la forêt. C’est alors qu’au moment même où je m’apprêtais à signaler la route à Cyprien, quatre hommes surgirent juste devant moi, en travers de la voie. Et chacun d’eux pointait une paire de pistolets en notre direction. De stupeur, je restai figé et sans voix. Deux d’entre eux étaient à cheval et avaient émergé du talus, les autres, simplement à pieds, avaient surgi de derrière les énormes troncs d’arbre qui bordaient le chemin. Retrouvant l’usage de mes muscles, à défaut de celui de la parole, je me retournai vers Cyprien : il y avait encore deux hommes armés derrière lui pour nous couper la retraite ainsi qu’un autre à notre gauche et encore un à notre droite. Huit en tout. Silencieux comme la mort. Et dire que tous avaient réussi à se dissimuler à nos yeux alors que nous étions à quelques pas d’eux ! Je sentis mes bras, mes joues, mon dos se glacer et s’alourdir, et mon ventre… mon ventre… mon Dieu, comment exprimer et décrire cette sensation de glace et de plomb qui simultanément s’en empara ! Paniqué, perdu et éperdu, mais retrouvant enfin l’usage de mes membres et du reste de mon corps, je me retournai vers l’avant et l’un des deux cavaliers, pointant toujours ses armes vers moi, esquissa un salut plus qu’ironique. — Messeigneurs ! Vous ne devriez pas vous aventurer seuls en ces bois à la nuit tombante. On les dit fort mal fréquentés ! Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Mer 12 Juin 2013 - 21:19 Mer 12 Juin 2013 - 21:19 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre VII : L’embuscade Huit hommes nous entouraient, chacun armé d’au moins un pistolet. Devant moi, Clément faisait face aux canons de huit armes, ainsi qu’à quatre regards mauvais. Pourquoi donc était-ce lui qui avait ouvert la marche au retour ? Que n’avais-je pris la tête de notre petit cortège ! Mais après tout, ma situation n’était guère plus enviable : de chaque côté, un brigand me menaçait d’un pistolet tandis que son autre main visait Clément. Et dans mon dos, je sentais les pointes de deux lames d’acier à travers mes vêtements. Ma respiration devint de plus en plus saccadée et j’avalai difficilement une boule de salive. J’eus l’impression que mon cœur m’était descendu dans l’estomac et y battait deux fois plus vite qu’à la normale. Puis je sentis les muscles de mon visage s’engourdir et la chaleur quitter mes joues, tandis qu’en revanche mes entrailles chauffaient inhabituellement. Je fixai le dos de Clément : il ne bougeait pas plus que moi. Il me semblait que j’étais au beau milieu d’un cauchemar, à ceci près que mes rêves effrayants me paraissaient toujours très réels pendant que je les faisais, tandis que cette fois je ne parvenais pas tout à fait à admettre la réalité de ce que nous étions en train de vivre. Puis, lentement, cette panique qui avait paralysé mon esprit autant que mon corps me quitta pour laisser place à une peur intense. Véritable et tout à fait raisonnée. Je sentais mon estomac se vriller dans mon ventre et je voyais mes mains trembler, mais ma respiration commençait à ralentir et je retrouvais mes sens, du moins suffisamment pour observer nos assaillants. Deux d’entre eux étaient à cheval : le premier portait un vieux chapeau beige à larges bords agrémenté de deux plumes, et le second un tricorne noir. Tous deux avaient dissimulé leur nez et le bas de leur visage derrière un morceau d’étoffe noué à l’arrière de la nuque. Celui du cavalier au tricorne semblait être un petit foulard de femme, aux motifs fleuris et ourlé de fine dentelle noire. L’autre avait un simple mouchoir rouge-brun. De leurs visages, on ne voyait que leurs yeux : un regard noir aux sourcils broussailleux, un regard bleu acier aux sourcils froncés. Je jetai un œil aux six autres hommes : tous avaient le visage dissimulé, le plus souvent par une grande écharpe de toile grossière ou par un mouchoir crasseux. Tous portaient chapeau de feutre ou tricorne. L’homme à ma gauche avait une cravate de fine dentelle blanche sous une veste de gros drap usé craquée aux coutures. Et tous avaient le regard effrayant de ceux qui sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins. ~ o ~ o~ o ~ C’était donc cela, les fameuses bandes de brigands qui sévissaient dans les bois et attaquaient les infortunés voyageurs qui les traversaient… Mais Cyprien et moi n’étions pas même de ces voyageurs, juste deux jeunes écervelés assez imprudents pour ne pas tenir compte des conseils avisés d’autrui et s’aventurer seuls et sans armes dans les bois. Je pensai alors à ma mère qui, de là-haut, devait se désoler que ses leçons n’eussent pas porté leurs fruits. En silence, je la priai d’intercéder en notre faveur afin qu’On nous sortît de ce mauvais pas. Nous nous étions imprudemment jetés dans une embuscade et nous trouvions maintenant à la merci d’un groupe de bandits, sans possibilité de retraite, et sans personne pour nous défendre. Tout au long de notre enfance nous avions rêvé de ces bandes de brigands, de voleurs ou de flibustiers auxquels, dans l’enthousiasme de notre jeune imagination, nous tenions bien évidemment héroïquement tête, et dont nous nous jouions par la ruse. À présent nous y étions. Et cette fois-ci tout était vrai, réel. Mais la réalité, venions-nous de nous en rendre compte, était bien plus sordide : une bande de coupe-jarrets prêts au pire. Nous étions en ce moment même leurs jouets, nous nous trouvions à la merci de leurs caprices. Habituellement, ils détroussaient les voyageurs de leurs valeurs. Mais cette fois-ci, il n’y avait rien à voler, nous n’avions rien sur nous. Ils étaient très mal tombés. Je respirai en me disant que nous avions été bien inspirés de n’avoir pas emporté le moindre sou pour la promenade. A moins que ce ne soit pire ainsi, ma susurra alors une petite voix au tréfonds de moi-même. Qui sait ce que le dépit de ne trouver nul butin pousserait ces hommes à faire… Nous pourrions nous estimer heureux s’ils se contentaient de prendre nos chevaux et de nous laisser rentrer à pieds… J’en étais à ce point dans mes réflexions lorsque le cavalier au grand chapeau, celui-là même qui avait déjà parlé, reprit la parole. — Vous plairait-il, mes beaux Messieurs, que nous vous fassions un bout d’escorte ? Les parages ne sont pas très sûrs, vous pourriez faire de mauvaises rencontres… A ces mots, ils se mirent tous à ricaner, mais leurs yeux ne nous quittèrent pas un seul instant. — Bien entendu, ajouta l’autre cavalier, nos services ne sont pas gratuits. Il vous en coûtera… disons… tout ce que vous avez sur vous. Allons, jeunes gens, un beau geste… A voir votre monture, dit-il à Cyprien, vos parents doivent être suffisamment aisés pour se permettre de contribuer au mieux-être d’autrui ! Ils ricanèrent tous et l’homme à ma gauche se rapprocha de moi. Il appuya le canon de son arme sur mes côtes. — Pour être encore en chemin à une heure si tardive, vous revenez d’assez loin… Non, ne me dites rien, laissez-moi deviner… Vous êtes allés faire une commission pour vos parents. Pour affaires, peut-être ? Vous avez revêtu vos plus beaux atours, vous aurez certainement fait tinter une bourse bien remplie. Allons, jeunes gens, cédez-la nous, et vous repartirez sans dommages. — Nous n’avons pas un sou vaillant sur nous, répondit Cyprien d’une voix tremblotante malgré ses efforts pour l’affermir. — Laissez-nous passer Messieurs, car il n’y a rien à gagner avec nous, lançai-je sans trop d’espoir. — Voilà qui serait fort fâcheux pour vous si cela s’avérait, grinça le cavalier au tricorne à travers son foulard fleuri. Le chef s’adressa alors au bandit à ma gauche : — Fais descendre ce jeune homme de sa monture, il nous parlera peut-être de moins haut. Et fouille-le, s’il a menti nous lui ferons passer l’envie de recommencer. Si en revanche il a dit vrai, nous lui ferons passer l’envie des promenades en forêt au crépuscule. ~ o ~ o~ o ~ L’un des brigands tira Clément par la cheville et le fit tomber de sa jument. Il poussa un cri en heurtant le sol et se recroquevilla à terre en tenant son épaule gauche. Une grimace de douleur déformait son visage. — Tu aurais pu faire attention à ne pas l’abîmer, dit l’homme au tricorne. Celui-ci n’est tout de même qu’un enfant. C’est le plus grand qui nous intéresse. Clément s’était toujours montré susceptible en ce qui concernait sa taille. C’était un sujet sur lequel il ne fallait pas insister en sa présence, au risque de le vexer. La douleur ressentie à l’épaule avait dû commencer à le distraire de sa peur, et cette remarque acheva de le mettre suffisamment en colère pour que l’espace d’un instant il oubliât sa frayeur et son habituelle prudence. Toujours à terre, il redressa le buste et lança un regard sombre au cavalier. — Je ne suis pas un enfant ! J’ai douze ans ! L’homme éclata de rire. — Douze ans ! Que voilà un homme ! Éclat de rire général parmi les brigands. Puis leur chef s’adressa à l’homme au tricorne. — Assez ri ! Toi, fouille l’autre, en attendant. L’homme mit pied à terre et s’approcha de mon cheval. Il me parut alors beaucoup moins grand que sur sa monture, mais ses armes étaient restées tout aussi menaçantes. On me tira à terre un peu plus doucement que Clément, on me palpa, on retourna les poches de ma veste et celles de mon gilet, on examina ma selle. Pendant ce temps, on devait faire de même à Clément que j’entendais pousser des gémissements étouffés quand on effleurait son bras ou son épaule. J’entendis celui qui me fouillait murmurer entre ses dents. — Douze ans ! Non, vraiment, on ne l’aurait pas juré… — D’où venez-vous, au fait ? demanda le chef. Nous ne répondîmes ni l’un ni l’autre. — Pas de bijoux, pas de bourse, rien sur eux ni sur leurs chevaux ! Pas d’arme, non plus. — Si j’avais eu une arme, répliquai-je, je n’aurais pas attendu que vous me fouilliez pour vous le faire savoir ! — Oh, dit le tricorne, un idiot courageux ! Méfie-toi, mon garçon, c’est un assortiment très dangereux. Pour l’heure, on t’a posé une question : d’où viens-tu ? Je serrai les dents et ne répondis pas. — Ils ne sont pas très bien élevés, on dirait, grogna l’un des hommes. Allons, répondez ! Ils jouaient donc avec nous à présent. Mais puisqu’ils nous tenaient déjà entre leurs mains, aucun de nous deux ne voulait leur faire en plus le plaisir d’obéir. — Peut-être bien que l’autre sera plus loquace. Le cavalier au chapeau beige se tourna vers Clément. — D’où viens-tu, petit ? Pas de réponse. L’un des hommes lui donna une bourrade dans le dos qui lui arracha un gémissement de douleur tandis qu’il portait la main droite à son épaule gauche. — Laissez-le ! criai-je presque malgré moi. Le chef tourna son regard dans ma direction, fronça ses sourcils broussailleux et prit une grande inspiration. — Intéressant, murmura-t-il doucement. Ainsi, il faut s’en prendre à l’un pour que l’autre réagisse… Décidément, cette voix me faisait de plus en plus penser à une armoire grinçante, ou à une vieille porte mal huilée. Il sortit alors un poignard de sa ceinture et s’avança vers moi. — Nous allons jouer un peu, couina-t-il. Je vis la lame s’approcher de mon visage. Il me la mit sous le menton. Je pouvais sentir le froid du métal au contact de la peau de mon cou. J’étais pétrifié. ~ o ~ o~ o ~ Je ne respirais presque plus. Le chef des brigands menaçait de trancher la gorge de Cyprien. Jusqu’ici, j’avais essayé de me persuader que leurs gestes et leurs paroles n’étaient destinés qu’à nous intimider afin de s’amuser de notre peur et de nous convaincre de lâcher plus facilement notre argent si nous en avions eu. Mais je n’en étais plus si sûr à présent, et je voyais la même crainte dans le regard que Cyprien lançait en ma direction. En tous les cas, je n’étais pas prêt à jouer sa vie sur ce pari. Le chef tourna la tête vers moi. — Alors, d’où viens-tu ? Il n’était plus temps de poursuivre cette partie de bras de fer en s’entêtant dans le mutisme. Il fallait répondre. — De Tanhouët, dis-je dans un souffle. Je vis le cavalier au tricorne tourner brusquement la tête en ma direction. — On dirait qu’il a retrouvé sa langue, notre homme de douze ans, lança un des voleurs à travers son foulard bleu. Et c’est joli, Tanhouët ? L’homme au tricorne, qui semblait être le premier lieutenant du chef de bande, me dévisagea sans même songer à s’en cacher. Puis je vis son regard scrutateur descendre lentement jusqu’à mes pieds et remonter ensuite, toujours aussi lentement, jusqu’à la racine de mes cheveux. Les autres continuaient à parler. — Peut-être devrait-on aller y faire un tour… Paralysé par l’angoisse, je n’avais pas réfléchi assez vite ; j’aurais dû leur donner le nom d’un autre lieu, une fausse adresse. Trop tard, le mal était fait. Je songeais avec terreur à tous ceux de la maisonnée que je venais si imprudemment de mettre en danger : Youenn, Soazig, le comte, Jean-Baptiste, la grand-mère de Cyprien… Bref, tous les miens. Qu’allait-il donc advenir d’eux si je venais sans le vouloir d’attirer ces canailles jusque chez nous ? Le tricorne avait reculé de deux pas et me regardait d’un air songeur. Puis finalement, au milieu des railleries et des réflexions de ses camarades, il me demanda : — Tu es le fils du comte et de la comtesse de Tanhouët ? De nous deux, c’était donc moi qu’il prenait pour un gentilhomme ? Le premier instant de stupeur passée, je me mis à réfléchir à toute vitesse. S’ils savaient qui était Cyprien, ils voudraient se servir de lui comme otage contre une rançon. S’ils croyaient que c’était moi, ils me garderaient sans doute à sa place, mais que feraient-ils de lui ? Le renverraient-ils porter le message à Tanhouët ou bien au contraire supprimeraient-ils un otage encombrant ? A peine m’étais-je posé cette question que j’entendis la voix de Cyprien retentir bravement de derrière l’homme au tricorne. — Non, c’est moi. Que me voulez-vous ? Les bandits se retournèrent vers lui comme un seul homme. Le tricorne, encore lui, s’adressa alors à Cyprien. — Ce serait donc toi ? dit-il en le regardant des pieds à la tête. Pour le coup, tu me parais un peu grand pour douze ans… — A la fin, messieurs, dites-moi ce que vous me voulez ou laissez-nous partir. — Ce que nous voulons n’est pas difficile à deviner, répondit l’homme au mouchoir bleu. On ne tombe pas tous les jours sur un jeune seigneur assez stupide pour s’aller fourrer entre nos pattes. — Ce n’est pas parce qu’on est seigneur qu’on a les moyens de payer une belle rançon, intervins-je pour tenter de défendre Cyprien. — C’est bien dommage pour ton ami, dans ce cas… ~ o ~ o~ o ~ Campé sur ses pieds, Clément se tenait l’épaule gauche en grimaçant de temps à autres. Il essayait parfois de la masser, mais au vu de l’expression que prenait alors son visage cela sembler aviver sa douleur au lieu de la soulager. De leur côté, les bandits ne semblaient pas tout à fait certains de ce qu’ils allaient faire de nous. Leur chef, qui était remonté à cheval, s’approcha de moi. — Allons, dit-il d’un ton doucereux, tu ne me feras pas croire que deux jeunes messieurs si bien mis ne peuvent se tirer d’un mauvais pas en allongeant un peu d’argent. — Le comte de Tanhouët perçoit des droits sur des terres très rentables, dit l’un des bandits à ses compagnons. Je connais. Il est l’un des seigneurs les plus riches des paroisses environnantes. Tout le monde par ici vous le dira. — Voyez-vous cela, dit le chef en fixant son regard sur moi. Voici qui ouvre une perspective intéressante… — Si je peux me permettre, intervint alors son lieutenant, les enlèvements ne sont pas notre commerce habituel ; cela demande de la préparation et une infrastructure : supposons que cela dure un peu, le temps des négociations, où mettrions-nous ces garçons ? Par qui passer pour communiquer avec le père ? Et comment être sûrs de ne pas se faire pincer au moment de toucher la rançon ? Non, vraiment, c’est un véritable métier, ça ne s’improvise pas au gré des occasions… — Occasion pourtant bien belle, si tu veux mon avis, dit le foulard bleu. — Et bien dangereuse, aussi, reprit le cavalier au tricorne en se retournant vers son chef. Et puis, il ne servirait à rien de se mettre le comte de Tanhouët à dos. — C’est déjà le cas, si nous travaillons près de ses terres, et surtout maintenant que nous avons son fils. Crois-tu que le petit ne va pas aller se plaindre à son père ? — Tout dépend de ce dont il aurait à se plaindre… Réfléchis. Le gamin lui est rendu moyennant finances : il n’aura de cesse de nous poursuivre jusqu’à nous mettre la main dessus. Le gamin ne lui est pas rendu : ce sera la boucherie et il n’y aura pas un coin dans tout le royaume où nous serions en sécurité : j’ai moi aussi entendu parler de Granville de Tanhouët : ce n’est pas qu’un simple propriétaire terrien. Cet homme a certaines relations… Il est membre du Parlement, à Rennes. De plus, il a des raisons personnelles de ne pas aimer notre… corporation. Je le sais. Par contre, si le gamin a la frayeur de sa vie mais revient sain et sauf en précisant bien que nous l’avons gentiment laissé partir sans lui faire de mal, le père ne sera certes pas ravi mais nous nous ferons oublier quelques temps en partant exercer ailleurs et il ne mettra pas la contrée en révolution pour nous retrouver. — Je te trouve bien timoré, lui répondit le chef. Et tu réfléchis trop. Ce n’est pas la première fois que je te le dis. Ce n’est pas de la politique que nous faisons, nous. — Oui, c’est bien vrai pardi, intervint un autre. On attaque, on vole, parfois on pille. On n’est pas là pour faire des discours ou passer des accords. — Pourtant jusqu’ici vous n’avez pas eu à vous plaindre de suivre mes conseils, souvenez-vous… Ça nous a bien servi face aux troupes du prévôt, ou bien face aux autres bandes… Faites-moi confiance une fois de plus. — Hmm, c’est vrai que tu as un certain sens tactique, concéda leur chef. Tandis qu’ils discutaient ainsi de notre sort comme s’il s’était agi de parler du cours du bétail ou de commenter le choix d’un musicien pour une noce, j’attendais, la gorge nouée, de savoir si nous allions rester, partir ou mourir. Au fil de leurs paroles, je sentais un grand froid me glacer le ventre, mes entrailles s’entortiller, une vive douleur m’envahir la gorge ou au contraire mon cœur palpiter d’espoir. — Et puis après tout, convint finalement le chef, cela fait déjà quelques temps que nous sommes dans les environs. Il serait peut-être temps d’aller exercer un peu plus loin. Quel dommage, tout de même, une si belle occasion… Ils auraient pu au moins prendre un peu d’argent avec eux… — On pourrait au moins garder les chevaux, suggéra quelqu’un. Déjà qu’on est bien gentils de les laisser rentrer, ils vont pas se plaindre d’avoir à le faire à pieds. — C’est vrai que le pur-sang est magnifique, dit l’homme au tricorne en caressant mon cheval. Et la jument est très bien aussi, ajouta-t-il en saisissant les rênes de nos deux chevaux. Il les confia à un de ses compagnons puis, tandis que ses complices s’éloignaient sur le chemin, il retourna vers sa propre monture et en l’enfourchant, il me glissa en chuchotant : — Je vous ai sauvé la mise à tous deux, ce soir. Il n’y aura pas toujours quelqu’un pour le faire, alors désormais soyez plus prudents lorsque vous voyagez… ayez toujours par exemple quelqu’argent sur vous… Et n’oubliez pas de préciser au comte que nous vous avons laissé la vie sauve et ne vous avons fait aucun mal, lança-t-il à voix haute en s’éloignant. — Vous savez, lança brusquement Clément, il n’aurait pas même besoin de savoir que nous avons fait une quelconque rencontre dans ces bois, si seulement nous n’avions pas à expliquer la disparition de nos chevaux. Il resterait juste à inventer quelqu’excuse qui justifierait notre retard… — Bien essayé, petit, ricana l’homme, mais mes compagnons risqueraient de rester un peu trop sur leur faim s’ils n’avaient au moins vos chevaux pour se consoler de la perte d’une si belle occasion. Je te trouve bien gourmand, mon garçon, t’en tirer à si bon compte ne te suffit-il donc pas ? Mais quelque chose d’autre me dit que vous auriez bien aimé tous deux ne pas avoir à avouer à qui que ce soit que vous êtes venus jusque dans ces bois, je me trompe ? Et il partit dans un éclat de rire tonitruant. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Sam 15 Juin 2013 - 17:17 Sam 15 Juin 2013 - 17:17 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre VIII : La queue entre les jambes Le retour au manoir fut long et éprouvant. Nous étions encore secoués de ce qui venait de nous arriver, et mes genoux tremblaient quelque peu en marchant. Je sentais pourtant mon cœur et ma respiration revenir peu à peu à un rythme normal. Mais j’étais dans une sorte de brouillard, accentué par l’obscurité maintenant quasi-totale en cette heure tardive, sans même une lanterne pour nous envelopper d’un halo rassurant. Des idées embrumées flottaient dans ma tête sans qu’aucune se fixât en mon esprit. J’errais dans un monde flou, n’ayant conscience de moi-même que par une douleur lancinante à ma gauche. Chaque pas que je faisais résonnait jusqu’à mon épaule, me faisant à chaque fois comme si on y enfonçait une lame chauffée à blanc. Cyprien insistait pour me soutenir, mais cela n’aurait en rien facilité notre marche. J’avais beau lui répéter que ce n’était pas à la jambe que j’étais blessé, il s’était mis en tête de m’aider à marcher. Il avait passé mon bras valide derrière sa nuque et me soutenait la taille de son bras gauche. Nous avançâmes ainsi durant presque cinq minutes. Mais voyant que cela ralentissait plus notre progression que ce ne me soulageait, nous reprîmes notre marche côte à côte. Bientôt, je sentis une douleur continuelle à l’épaule, même lorsque je demeurais immobile : j’avais l’impression qu’à l’intérieur même de l’articulation, mes os étaient en feu. Je grimaçai et tentai de trouver pour mon bras une position qui, à défaut de me soulager, me ferait le moins mal possible. A mes côtés, Cyprien ne disait mot. Une fois encore, nous partagions à deux la responsabilité de ce qui s’était passé. Impossible de se souvenir lequel des deux avait le premier lancé l’idée de pénétrer dans la forêt, ni lequel avait finalement décidé de le faire. C’était, une fois encore, une décision conjointe. Je devinai Cyprien très triste de la perte de Morvarc’h. Il était très attaché à son magnifique cheval, et l’avait toujours monté avec une grande fierté. De plus, il appréhendait certainement la réaction qu’aurait son père à l’annonce de ce qu’il en était advenu. Sa grand-mère, elle, serait catastrophée d’apprendre ce qui nous était arrivé dans la forêt. Mais alors que peu à peu s’atténuait l’angoisse ressentie aux mains de brigands, nous appréhendions de plus en plus le moment de leur avouer à tous deux que nous avions désobéi et nous étions rendus en forêt. ~ o ~ o~ o ~ A mes côtés, Clément avançait lentement, grimaçant de douleur à chaque pas. Pendant que nous marchions repassaient par bribes dans ma tête les scènes que nous venions de vivre. La frayeur ressentie, les frissons le long de l’échine et jusqu’à la naissance des cheveux, les palpitations du cœur, les entrailles se tordant d’angoisse, le souffle coupé à l’aperçu d’un rayon d’espoir, et même la vue trouble, toutes ces sensations me revenaient tour à tour, comme un mélange informe des émotions ressenties, un condensé de ce que je venais d’éprouver. Il faisait maintenant presque noir et je me sentais glacé jusqu’à l’os, plus encore à cause du malaise qui m’habitait que du froid des nuits hivernales. Nous commencions à avoir quelques difficultés à suivre le chemin que nous distinguions mal dans cette quasi-obscurité, et il me fallut rassembler mes esprits pour me concentrer sur la route à suivre pour rentrer au manoir. Cela me permit de reprendre mes sens et de moins me laisser aller au vertige désagréable et flou dans lequel nous avait plongés notre mésaventure. Tout en marchant, je commençai à ordonner mes idées et réalisai que nous nous apprêtions à devoir conter par le menu ce qui nous était arrivé. Et donc avouer avoir désobéi. Et annoncer la perte de deux magnifiques chevaux. Toutefois, le bilan aurait pu être bien plus lourd ; il ne nous faudrait surtout pas oublier de faire valoir cet argument pour tenter d’enrayer le courroux de mon père. Encore qu’il était malheureusement bien placé pour connaître le terrible prix que peut valoir un face à face avec un bandit de grands chemins. J’appréhendais aussi la réaction de ma grand-mère. Elle risquait fort de sortir de sa bienveillance habituelle à notre égard pour nous faire subir le flot de ses récriminations envers notre inconscience. Une frayeur rétrospective la rendait toujours intarissable. Il me semblait déjà entendre les exclamations aiguës et alarmées qu’elle ne manquerait pas de nous asséner de longues minutes durant. Puis je me mis à penser aux chevaux. J’aimais tant mon jeune pur-sang Morvarc’h… Il était si docile avec moi, obéissant au moindre de mes gestes. Il était si beau avec sa ligne élégante et sa chaude couleur alezane… Je m’étais attaché à lui au fil des promenades que nous avions faites dans les campagnes environnantes. Il me fallait maintenant admettre que j’avais à tout jamais perdu ce compagnon que j’avais toujours été si fier de monter. ~ o ~ o~ o ~ N’en menant pas large, nous nous tenions debout devant le comte et la baronne qui, ne nous voyant pas revenir, avaient envoyé Jean-Baptiste, Youenn et le garçon d’écurie à notre recherche. C’était finalement le vieux jardinier qui nous avait croisés non loin de la maison et nous avait raccompagnés. Sa lanterne fut la bienvenue, tant il faisait noir. En cette heure tardive, et l’esprit errant encore dans le brouillard incertain qui m’embrumait la conscience, je ne rêvais plus que du calme de ma chambre et de la chaleur de mes couvertures. Pourtant, une douleur aiguë me transperçait l’épaule et je savais qu’elle m’empêcherait de trouver le sommeil tant espéré qui m’aurait coupé quelques heures durant de la souffrance physique et des tourments si désagréables qui bouleversaient mon esprit. Lorsque je bougeais mon bras, cela m’était comme si l’un de nos agresseurs m’avait planté un poignard dans l’épaule qui y serait resté fiché ; lorsque je le maintenais immobile, il me semblait que des braises me chauffaient l’intérieur même de l’articulation. A chaque mouvement que je faisais, je ne retenais qu’à grand peine des larmes que je m’obstinais à ne pas laisser jaillir. De loin, de très loin tout d’abord me parvenaient des voix, dont je pouvais tout de même distinguer les paroles. — Mais où aviez-vous donc l’esprit, tous deux, pour vous aventurer seuls au cœur de ces bois ? aboyait le père de Cyprien. Et inutile de me faire accroire que vous aviez oublié que cela vous était formellement défendu. Ce n’est pas parce que Lucie nous a quittés que les règles qu’elle avait établies ont été abrogées ! — Mais, père, tenta timidement Cyprien, elle les avait édictées alors que nous n’étions encore que des enfants… Et désormais nous– — Il n’y a aucun "désormais" qui vaille. Que croyiez-vous ? Que parce qu’une année avait passé depuis que… depuis, vous étiez désormais de taille face à pareils dangers ? Eh bien maintenant que vous en avez fait la fort instructive expérience, quel est, dites-moi je vous prie, votre avis objectif sur la question ? Comme nous l’avions prévu, il était hors de lui. Je voyais sur sa tempe une veine palpiter d’effroi depuis le récit de la mauvaise rencontre que nous avions faite. Il était devenu livide, plus encore de peur que de colère, mais cette frayeur rétrospective n’atténuait en rien son courroux ; bien au contraire elle semblait l’amplifier. — Eussiez-vous été plus jeunes, j’aurais pu comprendre votre inconscience, mais à l’âge que vous avez atteint, je pensais que vous sauriez reconnaître les risques que certains gestes vous feraient courir. Manifestement il n’en est rien. Vous êtes restés tout aussi irréfléchis que lorsque vous aviez huit ans. Et bien entendu, pas un seul de vous deux n’a eu la sagesse de retenir l’autre ! Chacun d’entre vous savait pourtant fort bien que vous n’aviez pas l’autorisation de vous aventurer dans ce bois, ni dans aucun autre, d’ailleurs. J’aurais pourtant pensé que vous, Clément, étiez plus prudent et plus avisé que mon écervelé de fils. Je vous aurais pensé plus enclin à suivre les instructions de feu votre mère, cette sainte femme qui a consacré à votre éducation à tous deux dix années de sa vie ! Une bien étrange façon de l’en remercier ou de vous en montrer dignes ! Le flot de ses reproches semblait ne jamais devoir se tarir. La frayeur qu’il avait ressentie à notre récit des évènements semblait l’avoir rendu plus virulent encore, exactement comme au lendemain de notre escapade nocturne en bord de mer quatre ans auparavant. — Vous semblez ne pas bien vous rendre compte de ce qu’il aurait pu advenir, poursuivit le Comte. Vous avez eu une chance incroyable de vous en sortir indemnes. Indemne, c’était vite dit. Mon épaule me faisait terriblement souffrir et cette douleur semblait ne pas vouloir s’atténuer. Je ne pus retenir une grimace. — Je vais faire mander le docteur Prigent pour cette blessure, me dit-il d’un ton radouci. Tranquillisez-vous, c’est un homme capable de faire de miracles. Nous étions bien placés pour le savoir, c’était lui qui nous avait mis au monde, Cyprien et moi. Pourtant ma confiance en lui était quelque peu émoussée depuis qu’il n’était parvenu à sauver ma mère. ~ o ~ o~ o ~ Mon père envoya Jean-Baptiste – qui n’était jamais bien loin – chercher le médecin puis se tourna à nouveau vers nous. — Puisque vous semblez tant priser les promenades nocturnes en forêt, j’ai une bonne nouvelle pour vous : monsieur Mahé m’a informé que quelques loups rôdaient dans le Bois du Feu à quelques lieues d’ici. Samedi soir nous organisons une battue à la tombée du jour. Je pense que vous serez donc ravis d’y participer. Séparément, bien entendu. Vous, Cyprien, avec Monsieur Mahé. Et vous, Clément, avec Jean-Baptiste. Rassurez-vous, il a une très bonne oreille, il entendra venir les bêtes de loin. — Mais, père, objectai-je d’une voix légèrement tremblante, vous venez de dire que n’avions pas le droit de nous rendre en forêt de nuit. — Ce soir-là il ne s’agira pas d’un droit mais d’une punition. De plus, cela vous permettra peut-être de prendre un peu plus conscience de la réalité des dangers qui vous entourent. L’idée de me retrouver de nuit dans un bois abritant des loups errant ne me disait rien qui vaille. Même accompagné de l’intendant, en qui j’avais pourtant toute confiance, cette perspective ne me semblait pas des plus attrayantes. Surtout sans Clément à mes côtés. Puis mon père posa son regard sur les vêtements maculés de boue de Clément, et son expression se métamorphosa instantanément. — Vous devez être morts de froid et de faim, dit-il d’un ton bienveillant. Passons à table dès maintenant, après quoi vous prendrez un bon bain chaud. Je vais dire à Soazig de mettre dès à présent de l’eau à chauffer. Elle va bougonner que c’est une honte d’avoir laissé un si bon repas refroidir, mais elle aussi est très rassurée de vous savoir enfin rentrés. Il se dirigea vers la porte puis au moment de la franchir, il se retourna vers nous. — Vous n’avez pas idée de l’inquiétude que vous nous avez causée. Comme d’habitude, vous n’avez pensé qu’à vous deux. Imaginez donc un peu l’état dans lequel devait se trouver votre grand-mère en ne vous voyant pas revenir… Une femme de son âge, n’avez-vous pas honte ? — Mais, Père, elle n’est pas beaucoup plus âgée que vous… Je me rendis compte trop tard que ce n’était pas vraiment le moment de glisser pareille remarque dans la discussion. Heureusement, mon père avait bien eu autre chose en tête durant ces dernières heures que le nombre de ses années, et il releva à peine. — …moui… bon, à table, maintenant, bredouilla-t-il. ~ o ~ o~ o ~ Le médecin ne put faire grand chose pour mon épaule. Il l’examina et me recommanda l’immobilité jusqu’à ce que je ne souffre plus. Comme si avec la douleur que je ressentais à chaque mouvement j’avais eu la moindre envie de faire des moulinets du bras gauche… Décidément, le bon docteur avait perdu beaucoup de son aura à mes yeux. Cela avait commencé l’année précédente, lorsqu’on le fit venir pour soigner la maladie de ma mère. Nous venions de nous coucher et étions alors sortis du lit à son arrivée pour venir épier ce qu’il dirait. Je me souviens encore que n’étant qu’en chemise, nous nous étions serrés l’un contre l’autre et enroulés dans une couverture. Lorsqu’en sortant le la chambre de ma mère il nous aperçut, il nous confondit et prit Cyprien pour moi. Il est vrai qu’il était maintenant bien vieux et que nous ne l’avions pas vu depuis de nombreuses années, depuis notre toute petite enfance, pour ainsi dire. Je trouvai pourtant cela décevant de la part du médecin qui nous avait mis au monde. En d’autres termes, il devait commencer décliner. Ce fut le comte qui le détrompa rapidement en rendant à chacun de nous deux son nom. De ce moment, le docteur Prigent baissa beaucoup dans mon estime ; puis ma mère mourut malgré ses soins et ma confiance en le corps médical s’en trouva encore diminuée. Le comte eut beau m’expliquer qu’une pneumonie était très difficile à combattre, je me tournai de plus en plus vers les remèdes ancestraux prônés par Soazig qui, à défaut d’avoir une efficacité prouvée ne m’avaient du moins pas encore déçu. Cyprien et son père trouvaient désolant ce recours à de vieilles méthodes qu’ils appelaient des remèdes de grand-mère et le qualifiaient d’obscurantisme, comme tout ce qui n’était pas moderne. Comme ma mère, ils disaient aimer ce qui était moderne, même si tous trois n’appréciaient d’ailleurs pas forcément les mêmes choses dans tout ce qui paraissait relever de cette modernité. Ils avaient en tous cas en commun de ne pas vouloir croire en mes remèdes de grand-mère, contrairement à la baronne. Malheureusement, ni moi ni Soazig n’en connaissions un qui pût guérir une épaule blessée. La baronne me proposa une tisane pour au moins m’aider à dormir, mais il faut croire qu’elle n’y mit pas les bonnes herbes car je ne parvins pas à trouver le sommeil ce soir-là. Ce fut même une des pires nuits qu’il me soit arrivé de passer : quelle que fût la position dans laquelle je me calais, j’étais toujours en appui sur mon épaule. Je tentai alors de dormir en chien de fusil sur le côté droit, mais alors mon épaule gauche s’affaissait sous son propre poids comme si quelque chose appuyait légèrement dessus. Je compris alors que je ne pourrais que tenter de trouver la position la moins inconfortable possible pour attendre le lever du jour. Je passai la nuit à bouger et me retourner dans mon lit, sentant parfois une douleur fulgurante me foudroyer, et le reste du temps un mal plus supportable me tourmenter. Cette nuit me parut interminable. Alors qu’il faisait encore complètement nuit en ce matin d’hiver, je fus certainement le premier levé de toute la maisonnée ; n’ayant pas fermé l’œil, mon esprit engourdi par le manque de sommeil perçait difficilement la brume épaisse qui m’enveloppait le cerveau. Je ne parvins pas même à m’habiller ni à me coiffer seul, je décidai donc d’attendre que Soazig se réveillât et descendît à l’office. Je pris un livre et tâchai de m’intéresser à son contenu, mais les scènes vécues la veille dans les bois me trottaient dans l’esprit, et les émotions ressenties revenaient à la charge. Tout d’abord ce silence inquiétant. L’obscurité régnant dans le chemin creux. Le contact des pistolets. Le souffle du brigand qui m’avait fouillé. La voix grinçante du chef de la bande. Le regard clair et glaçant de son lieutenant. Son plaidoyer qui nous avait permis de partir. Et surtout cette épaule toujours douloureuse. Il faudrait y faire quelque chose. Il était hors de question de rester avec cette douleur, attendant juste qu’elle daignât passer toute seule. J’entendis craquer l’escalier de service. J’attrapai des vêtements propres et descendis en chemise l’escalier glacial jusqu’à l’office où je trouvai Soazig qui m’aida à me coiffer et à m’habiller. A force de grimaces je réussis à enfiler mon gilet et ma veste. — Il va falloir faire quelque chose pour cette vilaine épaule, me dit-elle quand je fus présentable. — Je sais bien, mais le médecin a dit hier qu’il n’y avait rien d’autre à faire que de la laisser au repos. — Les médecins, c’est très bien, reconnut-elle tout en bougonnant, mais des fois ça ne peut rien faire. À qui le dis-tu, pensai-je alors. — Mais, reprit-elle, j’ai entendu parler de quelqu’un qui peut soigner ce que tu as. Yvon Le Manchec, tu sais, celui qu’est garçon d’écurie chez Monsieur de Pléro ? — Oui, je vois. Eh bien, il sait guérir ? — Non, lui non. Mais l’année dernière, il s’est pris un coup de sabot en plein dans les reins. Elle fit une pause et je fronçai les sourcils à l’idée des dégâts que pouvait occasionner pareil accident. Je regardai Soazig, attendant une suite à cette histoire, mais elle se contentait de me fixer sans rien dire. Faudrait-il donc lui arracher les mots un à un pour savoir où elle voulait en venir ? — J’en suis absolument navré pour lui, dis-je, mais je ne vois pas bien en quoi il peut me guérir. — Je t’ai déjà dis qu’il pouvait pas. Mais j’ai su ça parce que c’est un cousin du coté de ma mère, qu’est la cousine germaine de son père qui travaillait comme bourrelier avant à Kertanhouët. Enfin, je te dis ça, ça commence à dater, parce que le père, je l’ai même pas connu, tellement ça fait longtemps qu’il est mort. Tombé d’un ravin, qu’il est. Tu sais, le coté nord de la colline de Tréffel. Ça pardonne pas, tellement que c’est raide comme pente. Et puis c’est haut, dame ! pour ça oui. Je soupirai, prenant mon mal en patience. J’allais tout connaître des cousins de la mère de Soazig avant de savoir ce qu’ils pourraient faire pour soulager mon épaule. — Soazig, tentai-je pour la ramener sur le sujet initial, ton cousin et son coup de sabot ? — Ah, oui. Eh bien un peu avant, son maître avait eu le pied tordu en dansant à la fête de l’aire neuve de Fañchig Moal, un paysan qui a sa ferme pas loin de chez lui. Et voilà que cela recommençait, me dis-je alors. Nous en étions maintenant à l’aire neuve d’un fermier dont je n’avais jamais ouï parler. — Soazig, le rapport avec mon épaule ? — Bon, bon, bougonna-t-elle. J’y viens… Yvon avait entendu parler par son maître d’une femme qui remet sur pied les estropiés – attention, hein, seulement ceux qui sont juste un peu estropiés : elle va pas te guérir un pied bot ou quelque chose comme ça… — Soazig, ce n’est pas au pied que j’ai mal. — Yvon non plus, c’était pas au pied, c’était au dos. Eh bien il est allé la voir, et en une semaine, il était debout ! — Il l’aurait peut-être été de toute façon. — On croirait entendre ta mère. Je veux pas dire du mal des morts, dit-elle en se signant, mais elle croyait peut-être qu’elle serait devenue un peu plus une dame si elle voulais pas croire à nos astuces de paysan, parce que ça faisait pas assez moderne ! — SOAZIG ! — Excuse-moi. N’empêche que madame la baronne, elle, elle les méprise pas. Parle-lui de la rebouteuse que je t’ai dit, c’est à peut-être cinq lieues d’ici. Elle habite pas loin du sommet de la colline de Tréffel, celle-là même… — Où le père de ton cousin est mort, je sais. Tu crois vraiment qu’elle peut me guérir ? — Qu’est-ce que ça risque à essayer ? — Ce n’est pas tout près. La colline de Tréffel, il faut y aller à cheval, et puis cinq lieues à cheval, je ne sais pas si je tiendrai avec mon épaule… — Si tu préfères rester comme t’es…, répondit Soazig d’un air bougon. Nous nous séparâmes assez mécontents l’un de l’autre. Je n’arrivais pas à lui pardonner ce qu’elle avait dit de ma mère, et puis c’était trop facile de l’attaquer maintenant qu’elle n’était plus là pour se défendre. Jamais Soazig n’aurait osé lui dire cela en face. J’étais très triste au fond de moi-même en quittant la cuisine. Je savais que Jean-Baptiste ne s’était jamais très bien entendu avec maman. Je découvrais maintenant que, malgré sa gentillesse, elle n’était pas non plus appréciée par certains autres membres de la maisonnée. Sans doute ne lui pardonnaient-ils pas le statut privilégié dont elle avait bénéficié ici, malgré un passé presque aussi modeste que les leurs. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France)
Dernière édition par Hetep-Heres le Dim 11 Aoû 2013 - 16:01, édité 1 fois |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Mer 19 Juin 2013 - 23:20 Mer 19 Juin 2013 - 23:20 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre IX : La colline de Tréffel Quand je me levai au lendemain de notre mésaventure en forêt, je trouvai Clément de fort méchante humeur. Il s’était levé tôt et me dit n’avoir pas fermé l’œil de toute la nuit. Pour tout dire, j’avais assez peu dormi moi aussi. Les évènements de la veille m’avaient hanté presque toute la nuit, occupant mes pensées quand je cherchais le sommeil, et habitant mes cauchemars lorsque que l’eus enfin trouvé : des branches d’arbre tordues s’animaient pour nous barrer la route, tandis que d’autres s’enroulaient autour de mon cou ou me frappaient dans le dos ou au visage. Et je revoyais sans cesse les yeux clairs et perçants du cavalier au regard d’acier. En guise d’explication Clément bougonna quelque chose à propos de son épaule, puis il s’enquit de ma grand-mère. Je lui répondis que je ne l’avais pas encore vue. Je m’étais levé plus tôt qu’à l’accoutumée, et elle devait être encore au lit. Pourquoi donc étais-je ce jour-là si matinal, je l’ignore. Peut-être avais-je senti par quelqu’instinct surnaturel ou signe imperceptible à autrui que Clément était réveillé. Sitôt que ma grand-mère fut descendue, il lui laissa à peine le temps de prendre son café matinal et l’assaillit de questions. — Madame, avez-vous déjà entendu parler d’une rebouteuse qui habiterait la colline de Tréffel ? Que dit-on d’elle ? Et qu’en pensez-vous ? — Holà mon garçon, un peu de calme, je vous prie. Vous voilà bien agité, dès le matin ! Bon, je conçois volontiers que vos fâcheuses aventures d’hier vous aient retourné les sangs, moi-même, j’ai eu peine à en trouver le sommeil. Imaginez-vous donc un peu ? Seuls, face à une meute de coupe-jarret. Quelle histoire, mes enfants, quelle histoire ! Rien que d’y repenser… Et elle se reversa une autre tasse de café. Quant à Clément, il semblait avoir une idée en tête et ne pas vouloir s’en écarter. — La rebouteuse, Madame, la connaissez-vous ? — Eh bien, si je me souviens bien Soazig m’a parlé d’une femme des environs de Tréffel qui, parait-il, peut soulager la goutte, et aussi certaines blessures. À ce qu’il semblerait le Vicomte de Pléro se serait foulé la cheville en chutant de cheval et elle y aurait fait merveille. — Ah, j’avais pour ma part entendu dire que c’était en dansant, précisa Clément, mais après tout qu’importe... — Un de ses valets s’était aussi fait un tour de rein en tombant dans l’escalier, continua ma grand-mère, et en deux jours, il reprenait son service. Enfin, c’est ce qu’on dit. — Je connais cette histoire également, à ceci près que cette fois il s’agissait pour le coup d’un cheval… mais bref, ainsi que je vous le disais, c’est sans importance. Arrivé à ce point de leur conversation, je ne comprenais plus rien et, si Clément semblait connaître lui aussi cette histoire de tour de rein, ce n’était absolument pas mon cas. — Je ne saisis pas bien, intervins-je alors, le cheval de Monsieur de Pléro s’est fait un tour de rein en tombant dans l’escalier ? Le vicomte a de la chance de s’en être sorti avec une simple foulure. Ils se tournèrent alors tous les deux vers moi avec sur le visage une expression d’incrédulité et d’effarement, me donnant la désagréable impression d’être pris pour le dernier des imbéciles. Je sentis alors l'agacement me gagner, ainsi que le besoin irrépressible de me défendre. — Mais, je n’entends rien à vos histoires de guérisseuses, et de cheval, et d’escaliers, et de danse ! — Cette femme, continua ma grand-mère comme si elle ne m’avait pas entendu, habite dit-on une sorte de masure à demi abandonnée vers le sommet de la colline ; par ses pratiques, elle gagne assez bien sa vie et aurait un pécule suffisant pour la rénover ou même aller habiter ailleurs, mais elle ne fait rien en ce sens et j’ignore ce qu’elle fait de son argent. On dit qu’elle préfère demeurer là, à demi sauvage. Il faut dire que je ne connais pas grand monde qui en voudrait pour voisine, les gens ont plutôt peur d’elle et la disent un peu sorcière, ce qui ne les empêche pourtant pas d’aller la trouver lorsqu’ils ont besoin de ses services. — Croyez-vous qu’elle pourrait guérir mon épaule ? Je ne saurais rester ainsi, à attendre que cela s’améliore tout seul ! Je ne peux faire aucun mouvement qui ne risque de m’arracher un cri. Pour le coup, je trouvai Clément bien douillet. Mais enfin, il avait toujours moins bien que moi supporté la douleur. Pourtant ce qu’il demanda à ma grand-mère ne m’étonna pas. Ils étaient tous deux très versés dans la croyance aux vertus quasi magiques des rebouteux, thaumaturges et plus généralement de tous ceux que Lucie et mon père qualifiaient de charlatans. ~ o ~ o~ o ~ Cyprien chevauchait à mes côtés, ne disant mot. Je le savais très sceptique quant aux aptitudes curatives des guérisseurs. Sur ce point il se montrait le digne élève de ma mère, qui avait toujours détesté m’entendre évoquer les bienfaits de telle fontaine, ou les pouvoirs surnaturels de telle statue de saint guérisseur. D’après elle, toucher la pierre de ces statues pour soulager une rage de dents frisait l’hérésie. Ayant perdu nos montures habituelles, nous avions dû en emprunter d’autres aux écuries, nous gardant bien de préciser où nous voulions aller. Le comte aurait certainement désapprouvé notre expédition, mais, soulagé de nous savoir saufs, il était retombé dans sa routine habituelle, nous laissant vaquer à nos occupations sous le contrôle de la baronne. Et il ne fallait pas compter sur elle pour nous dissuader d’aller voir cette guérisseuse de la colline de Tréffel. Bien au contraire, ce qu’elle m’en avait dit acheva de me convaincre de lui rendre visite. Le comte avec bien précisé à Cyprien qu’au vu de ce qui était arrivé, il ne devrait plus escompter posséder son propre cheval à l’avenir et qu’il lui faudrait désormais se contenter d’emprunter l’un de ceux qui seraient disponibles aux écuries. Cyprien s’était senti fortement brimé par cette mesure, mais il était bien conscient qu’il n’y avait pas à discuter, étant donné la façon dont il venait de perdre son pur-sang. Le trajet fut long et laborieux car je devais faire aller mon cheval tout doucement en raison de la douleur que chaque heurt causait à mon épaule. Il fallut s’arrêter plusieurs fois, rebrousser chemin parfois, demander sa route et enfin gravir la colline pour finalement aboutir à une sorte de cabane en pierre, bâtie au milieu d’une lande de bruyère et d’ajoncs balayée par le vent. Ce devait être un lieu très coloré dès le printemps, avec des tâches roses et or au milieu d’un dégradé de verts, sous un ciel bleu clair répondant à celui plus foncé de l’ardoise apparaissant çà et là à travers la végétation. Mais en ce jour de février, il faisait aussi sombre que la veille, et une lourde chape grisâtre écrasait le ciel sur le sommet de la colline, donnant à la végétation un air plus sauvage encore, rendant l’atmosphère bien plus inquiétante qu’en une belle journée de juin. Et comme pour ajouter à ce tableau peu rassurant, la brume matinale ne s’était pas encore totalement dissipée et laissait comme un voile cendré immatériel flottant à quelques pouces au dessus du sol. Les sabots des chevaux y plongeaient, et si chacun de leurs chocs contre le sol n’avait éveillé un nouvel élancement dans mon épaule, j’aurais pu croire que nous aussi flottions lentement et silencieusement dans les airs. Une fois sur le seuil de la maison – mais pouvait-on décemment nommer cela une maison ? – je pris une grande inspiration et frappai d’un poing tremblotant à l’huis. J’attendis. Rien. Je recommençai. Toujours rien. Cyprien s’approcha de moi et me suggéra d’écouter à la porte afin de déceler un quelconque signe de vie. Pour une fois un glacial vent de nord soufflait ce jour-là, mais par chance la porte donnait plein sud, sur le côté le plus plat du terrain ; nous étions donc à l’abri des bourrasques et de leur vacarme. Dans cette ambiance pesante et presque silencieuse, la voix de Cyprien avait quelque chose d’incongru. Un peu comme si j’avais redouté un danger inconnu, quelque chose de latent que le moindre bruit inhabituel pouvait réveiller. Il avait parlé à voix haute, sans même chuchoter, et cela me fit sursauter. Il m’arracha ainsi à l’espèce d’engourdissement dans lequel l’atmosphère sombre et brumeuse des lieux m’avait plongé. Je collai mon oreille droite au bois de châtaignier. Tout d’abord je ne perçus rien, puis en faisant abstraction de tout ce qui m’entourait je distinguai une sorte de bourdonnement très sourd, tel un bruit de fond ininterrompu. Il semblait parvenir de très loin, de bien plus loin que l’autre côté de la porte, et en me concentrant je remarquai comme des fluctuations dans cette rumeur. Une mélopée. C’était une sorte de mélopée monotone marmonnée à voix basse. Fasciné, j’écoutai, l’oreille collée à cette porte sans serrure. Il me semblait que ce son était comme un fil invisible qui me tirait vers sa source, et que jamais je ne pourrais décoller mon oreille de cette porte. Et du reste, pourquoi l’en décoller ? En ce moment même, j’avais presque oublié mon épaule, et d’ailleurs mon corps tout entier semblait ne plus exister que très vaguement. Je restai ainsi longtemps, longtemps. Ou pas ? Je ne sais, j’avais perdu toute notion du temps qui d’ailleurs n’avait plus aucune importance. Tout ce qui importait, c’était de continuer à être bercé de ce son magique et bienfaiteur. Tout à coup le silence se fit à l’intérieur de la maison et quelques secondes après, le bois contre lequel j’appuyais mon oreille se déroba et je trébuchai légèrement vers l’avant : la porte s’était ouverte brusquement et sur le seuil une jeune femme me fixait de ses yeux d’un noir profond. Je n’aurais su dire ce qu’exprimait son regard, mais il ne s’y trouvait nulle surprise, ni colère, ni bienveillance. Elle me regardait fixement sans bouger un seul cil, sans contracter un seul muscle de son visage, et j’avais l’impression qu’elle examinait l’intérieur même de mon être. Je me sentis glacé jusqu’à la moelle. ~ o ~ o~ o ~ Après quelque attente une jeune femme nous ouvrit la porte de la cabane. Nous pensions pourtant que personne n’avait entendu le coup frappé contre le bois de la porte à notre arrivée. Nous entendîmes une sorte de chant bourdonner depuis l’intérieur et je répétai à Clément de frapper, mais il semblait ne pas m’entendre. Il était comme figé. Une autre femme se trouvait au milieu de l’unique pièce de cette maison. Elle était plus âgée, se tenait assise à même le sol, de profil par rapport à l’entrée, et avait les yeux fermés. Sans même nous prêter attention, elle reprit la mélopée que nous avions déjà entendue, mais cette fois avec plus d’intensité. En face d’elle, assis par terre également, un homme la regardait fixement, comme fasciné. Il se tenait raide, le dos bien droit, et avait sur le visage un air légèrement inquiet. La jeune femme nous fit signe de nous asseoir dans un coin et de ne pas faire de bruit. Elle avait le même profil que la femme assise, le même nez retroussé, le même front bombé, les lèvres peut-être un peu plus charnues. Sans nul doute il y avait entre elles un air de famille, peut-être étaient-elles mère et fille. En tout cas, l’aînée ne semblait pas encore suffisamment âgée pour être la grand-mère de celle qui nous avait ouvert la porte. La rebouteuse poursuivait sa mélopée, l’intensifiant par moments, la murmurant l’instant d’après, accélérant parfois le rythme. Puis tout en continuant à chanter elle se leva, tourna lentement autour de l’homme assis sans jamais lui tourner le dos, et s’installa de l’autre coté, un doigt pointé devant elle. — Passe-la moi, dit-elle, s’adressant probablement à la jeune femme. Celle-ci alla prendre sur une étagère un bol contenant un liquide marron qui me fit penser à une boue très liquide. La rebouteuse le saisit, le posa devant elle et y trempa ses deux mains. Puis elle les appliqua sur le cou du patient tout en marmonnant, et ses pouces se mirent à décrire des cercles sur la nuque de l’homme toujours immobile. Elle retira ensuite ses mains et, sans le toucher, elle fit mine à plusieurs reprises d’enserrer de ses bras le cou de son patient. Enfin, toujours à distance, elle fit descendre et remonter sa main gauche, paume ouverte, le long de la colonne vertébrale de l’homme. Elle se redressa alors et lui dit de se relever. — Bien. Maintenant, regarde vers le nord. L’homme tourna la tête vers la gauche. — Vers le sud. Il la fit pivoter en notre direction. — Le ciel. Il regarda au plafond. — La terre. Et il baissa la tête. On aurait dit une marionnette dont elle faisait tout ce qu’elle voulait. J’avais d’ailleurs la nette impression que c’était exactement ce qui se passait et que si elle lui avait affirmé qu’il lui fallait pour guérir faire le tour de la pièce à cloche-pied en se pinçant la narine gauche avec la main droite il se serait exécuté, et nous aurions alors eu droit à un spectacle des plus divertissants. Je souris à cette idée et me demandai de plus en plus ce que nous étions venus faire ici, mais les deux femmes, elles, gardaient leur sérieux, ainsi que Clément qui semblait très impressionné par la simple vue d’un homme debout hochant la tête. Le patient, lui, semblait ravi de se faire délester de plusieurs pièces par la jeune femme et s’apprêtait à quitter les lieux lorsque la plus âgée l’interpella. — N’oublie pas, dors avec la tête à l’est ! En te réveillant avec le soleil, tu éviteras les torticolis. Quelle comédie ! J’avais une envie folle de traîner Clément hors d’ici, mais lui semblait au contraire subjugué par les lieux. Il regardait avec une sorte de crainte mêlée de respect les étagères garnies d’ustensiles fêlés et cabossés. Certains semblaient des plus étranges. Il y avait là des bassines en cuivre déformées, des cuillers en bois, des bols en terre cuite, des sachets de tissu, probablement du lin, des bocaux en verre contenant des liquides aux couleurs plus curieuses les unes que les autres dont je soupçonnais qu’ils n’étaient là que pour ajouter à l’ambiance étrange voulue et crée par les deux femmes. Je songeai à Lucie et me demandai ce qu’elle devait penser de la présence de son fils en ces lieux. Elle devait surtout être déçue que je ne l’aie pas dissuadé du voyage. Mais après tout, je me sentais un peu responsable de sa blessure et surtout de n’avoir pas su l’éviter. Son épaule semblait vraiment le faire souffrir ; au moins cette sortie le distrayait-elle de son mal, et nous permettait d’échapper à l’ambiance pesante qui régnait à la maison depuis la veille au soir ainsi qu’aux regards de reproche de ma grand-mère. ~ o ~ o~ o ~ En quelques minutes, la rebouteuse venait de guérir un homme qui, lorsque nous étions entrés, avait encore la nuque complètement bloquée. Maintenant il faisait aller sa tête d’avant en arrière, de haut en bas, de droite à gauche, suivant les directions que lui avait indiquées la guérisseuse. Cette femme semblait vraiment pouvoir réussir des miracles, elle avait le don d’utiliser les forces cachées de la nature et du monde qui nous entourait. Elle semblait ne pas remarquer notre présence. Pas une seule fois depuis que nous étions entrés elle n’avait jeté un regard vers nous. C’était pour elle comme si nous n’étions pas là. Maintenant que l’homme qu’elle venait de guérir était parti, elle restait assise là, essuyant ses mains, liant un bouquet d’herbes sèches, nettoyant les bords du bol qu’elle venait d’utiliser. Puis, du bout de son index gauche, elle se mit à tracer des formes imaginaires sur le sol de terre battue. — Vous êtes venus à moi. De loin, je pense. Je ne vous ai encore jamais administré mes soins, ni à l’un, ni à l’autre. Je ne savais que répondre. Ce fut Cyprien qui en prit l’initiative. — Madame, si nous nous sommes permis de venir en votre demeure, c’est que votre réputation dépasse les alentours immédiats de la colline de Tréffel. Malgré la politesse dont il usait, je le sentais assez goguenard et en fus consterné. Si la guérisseuse percevait elle aussi l’état d’esprit de Cyprien envers ses pratiques, elle risquait tout bonnement de nous mettre à la porte, voire pire… — Je ne recherche pas la renommée, dit-elle. Je ne recherche rien, d’ailleurs. Mais vous, vous cherchez quelque chose, sans quoi vous n’auriez pas parcouru un si long chemin jusqu’ici… Surtout toi, qui es blessé, ajouta-t-elle en me regardant. La route a dû te paraître bien longue… — Madame, répondis, je suis venu jusqu’à vous dans l’espérance que vous me fassiez profiter de votre science, dont on m’a dit le plus grand bien. Vos bienfaits ont soulagé nombre de personnes qui se sont empressées de rendre hommage à vos talents. Ainsi donc, Madame, je sollicite de vous une consultation dans l’espoir que vous me guérissiez d’une épaule qui depuis hier me fait bien souffrir. — Tu n’as pas passé une bonne nuit, n’est-ce pas ? dit-elle en levant un sourcil. Et lui, poursuivit-elle, que fait-il ici ? Elle désigna Cyprien d’un mouvement de la tête puis se tourna vers lui. — Souffres-tu de quelque chose, toi aussi ? Oui…, énonça-t-elle après l’avoir scruté quelques instants, oui, mais c’est autre ch– — Il est venu ici afin de m’accompagner, m’empressai-je de préciser. — Tu avais donc si peur de perdre ton chemin ? me dit-elle goguenarde. — Du tout, Madame, répliquai-je en me sentant rougir jusqu’à la racine des cheveux. Il se trouve simplement que nous faisons toujours tout ensemble. — Pourtant, lui ne semble pas s’être blessé. Toi, mon garçon, dit-elle à Cyprien, ce dont tu souffres se trouve à l’intérieur de toi-même. — Je vais très bien, vous faites erreur. C’est mon ami qui a besoin de vos soins. Il est tombé de cheval et… — Comment il s’est fait cela ne m’intéresse pas. J’ai juste besoin qu’il me décrive ce qu’il ressent. Et je me lançai dans l’exposé de mes douleurs. J’avais soudain l’impression de ressembler à Youenn, qui se complaisait tant à nous infliger le récit de ses rhumatismes, sa goutte et autres maux de l’âge. — Je vois. Tu sortiras d’ici presque guéri. Et elle commença une sorte de gestuelle étrange tout autour de moi. Elle me fit ensuite asseoir par terre et se mit à tourner autour de moi dans un sens puis dans l’autre, en marmonnant imperceptiblement. Puis, à un moment, elle me prit la main gauche, bloqua mon épaule de sa main libre, et tira sur mon bras d’un coup bref mais avec une force inouïe, ce qui m’arracha un hurlement. — Mais que faîtes vous ? demanda Cyprien en venant à mon secours. Avez-vous perdu l’esprit ? Mais immédiatement après, elle posa ses deux mains en douceur sur mon épaule et je sentis s’y répandre une chaleur apaisante, comme si un liquide chaud et anesthésiant s’écoulait le long de mon bras. Elle me fit alors retirer ma veste et mon gilet, ainsi que dénouer ma cravate et ouvrir le haut de ma chemise, ce qu’étonnamment je parvins à faire sans grimacer. Toutefois je sentais encore la douleur, et la jeune guérisseuse apporta alors un petit fagot de feuilles séchées reliées par une ficelle qu’elle se mit aussitôt à frotter sur ma peau. — Combien de fois te l’ai-je dit ? l’interrompit l’autre. Il faut les piler pour qu’elles soient encore plus efficaces ! Ce qu’elle s’empressa de faire. Elle ajouta ensuite quelques gouttes d’eau pour en faire une pâte qu’elle m’appliqua en cataplasme. La tête commençait à me tourner et me paraissait de plus en plus lourde tandis que la plus âgée des deux femmes faisait brûler un autre fagot d’herbes à mes pieds. Elle posa sa paume sur ma tête puis se tourna vers Cyprien, qui, me sembla-t-il, n’avait pas l’air rassuré. — Que lui faites-vous ? demanda-t-il. Mais elle ne répondit pas et fronça les sourcils en le fixant. Puis ma tête devint si lourde que mon menton heurta ma poitrine, et je ne fis aucun effort pour la redresser. Et surtout, pour la première fois depuis plus de douze heures je ne ressentais presque aucune douleur et voulais à tout prix savourer cette paix. ~ o ~ o~ o ~ Clément semblait être dans une sorte de torpeur. Je ne sais ce que ces femmes lui avaient fait respirer, mais je n’étais guère rassuré par leurs pratiques étranges. La rebouteuse me regardait étrangement, puis ses yeux revinrent à Clément dont la tête demeura baissée. — Approche, me chuchota-t-elle. Je ne voulais pas lui obéir et pourtant je m’exécutai. Elle tendit son bras libre vers moi et resta ainsi un moment, en silence, les yeux clos. Puis elle posa sa paume sur ma tête, fronça les sourcils et retira brusquement ses deux mains, comme si elle venait de se brûler. L’espace d’une seconde, elle écarquilla les yeux, puis se recula et m’ordonna de retirer ma chemise. — Comme Clément vous l’a dit, je ne suis pas blessé, je suis juste venu pour veiller sur lui. — Eh bien, si tu veux que ton frère guérisse, tu dois me laisser t’appliquer le même traitement qu’à lui. — Vous faites erreur, ce n’est pas mon frère. J’entendis un coq chanter au dehors. J’en fus d’autant plus étonné que je n’avais vu aucune basse-cour en arrivant. — Tu as raison, vous êtes plus que frères. Ce qui vous relie est tel que pour que ton ami guérisse, tu dois toi aussi suivre le traitement, car ce qui l’atteint t’affecte, et réciproquement. La partie de toi qui est en lui doit guérir également, de même que celle de lui en toi. Sinon, pourquoi serais-tu venu toi aussi en ma demeure ? — Vous… vous n’êtes qu’un charlatan… je vous paie ce que nous vous devons pour cette consultation et j’emmène mon ami avec moi. Je m’approchais de Clément et le secouai par l’épaule droite. — Viens, c’est terminé, nous partons. Il releva la tête et se leva lentement en émettant un grognement ensommeillé. — Vous avez tort de vous en aller, mais je vous reverrai un jour car vous aurez besoin de réponses à des questions que vous ne vous posez pas encore. Toi parce que tu méprises certaines questions et crois avoir toutes les réponses, me précisa-t-elle. Et toi parce que tu crois ce qu’en disent les autres sans même t’interroger, dit-elle à Clément. J’étais d’avis de partir de suite, mais Clément, plus sensible que moi aux divagations de ces femmes, ne put s’empêcher de demander des éclaircissements. Il ne fut guère avancé par la réponse qu’elle lui fit : — Je ne sais ni qui vous êtes, ni ce que vous êtes précisément, mais je peux percevoir certaines choses. Et je pressens que, plus encore que la clé de la vérité, le lien qui existe entre vous en est l’aboutissement. N’oublie jamais cela. N’oubliez pas l’essentiel au profit de l’accessoire… Ah, et à cause du refus de ton ami, tu devras toujours éviter les efforts trop intenses du bras gauche. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Lun 24 Juin 2013 - 15:38 Lun 24 Juin 2013 - 15:38 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre X : La battue Le samedi soir suivant, chacun armé d’un bâton, nous nous retrouvâmes en lisière du Bois du Feu pour notre première battue au loup. Je venais de passer une semaine éprouvante. Après les émotions vécues aux mains des brigands de la forêt et la souffrance de ma blessure à l’épaule, j’avais dû faire face à la perspective d’aller traquer nuitamment une meute de loups au cœur des bois. L’aventure ne me tentait guère, et de plus Cyprien ne serait pas à mes côtés. Je me rendis alors compte à quel point je me reposais sur lui, sur sa présence rassurante, si permanente que je n’y prêtais presque plus guère attention. Mais à présent qu’on nous avait séparés, je réalisai que nous étions d’habitude sans cesse ensemble, comme si cela était tout simplement naturel, nous complétant l’un l’autre, et je ressentais l’étrange impression qu’il était la meilleure partie de moi-même. La plus brave, pour être exact. Séparé de lui, je me sentais incomplet. Et à l’idée de ce qui m’attendait peut-être dans l’obscurité de la forêt, je n’en menais pas large. Ce qui n’était en début de semaine qu’un chatouillement désagréable au creux de l’estomac à la simple idée de cette expédition s’était peu à peu amplifié jusqu’à me donner l’impression d’avoir une grosse et douloureuse boule en travers de la gorge. Les battements de mon cœur s’étaient accélérés depuis la veille au soir, et j’avais à peine fermé l’œil au cours de la nuit précédente. Je serrai les doigts autour de mon bâton pour empêcher ma main gauche de trembler. Plus de peur que de froid, d’ailleurs, malgré la température plus que vivifiante qui me saisissait aux joues, au front et aux doigts. Ma main droite, elle, tenait une lanterne dont le faible halo, vacillant au rythme des tremblotements de mon bras, ne suffisait pas à me rassurer. Mes genoux quant à eux menaçaient à chaque instant de flancher et de ne me plus porter. A mes côtés, Jean-Baptiste était armé d’un fusil et me prodiguait nombre de conseils, dont certains me paraissaient parfaitement inutiles. Par exemple il me recommandait de ne pas m’éloigner, de toujours rester près de lui. Comme si en cet instant-même j’avais eu le moindrement envie de m’aventurer seul en pleine nuit dans un bois que je savais fréquenté par des loups et autres bêtes sauvages. Pour rien au monde je ne l’aurais avoué, moins encore à Cyprien qu’à Jean-Baptiste, mais j’étais rempli d’angoisse. Si au moins j’avais eu un pistolet pour faire le coup de feu si jamais je tombais nez à nez avec une de ces bêtes… Mais le comte, en homme avisé, ne nous avait pas fourni d’arme de peur que nous blessions quelqu’un, dans la fébrilité et l’obscurité. Avant de commencer la battue, nous nous retrouvâmes tous au point de rendez-vous, écoutant le comte qui nous donnait les dernières instructions. Même le vieux Youenn était de la partie. À travers les volutes de brume glaciale qui nous piquait les joues je croisai le regard de Cyprien, et immédiatement me sentis un peu apaisé. La panique qui m’avait envahi quelques minutes plus tôt me parut soudain ridicule. Sans être véritablement calmée, mon appréhension retrouvait un niveau raisonnable. Je m’approchai de lui et tentai de plaisanter pour masquer ma tension, mais le cœur n’y était pas. Cyprien me répondit sur le même ton en apparence badin, mais je pouvais sentir que lui non plus n’était guère serein à l’idée de la nuit qui nous attendait. Aux côtés de l’intendant il n’avait pourtant rien à craindre, Monsieur Mahé étant un habile tireur et connaissant bien les bêtes. Nous étions par contre légèrement plus inquiets pour le comte, qui faisait équipe avec le vieux Youenn et refusait obstinément, depuis la mort tragique de sa femme, de toucher un pistolet. Il avait cessé tout entraînement au tir pour lui-même, sans pour autant négliger notre formation en la matière qu’il avait confiée au fils Mahé. Il céda toutefois ce soir-là à la sagesse, et sur l’insistance de sa belle-mère accepta d’emporter le fusil que Youenn le pressait depuis cinq bonnes minutes d’emmener. — Envoyez-le au moins avec vous, monsieur le comte, sans vouloir vous commander. Je suis plus tout jeune, vous savez, et si une de ces bêtes venait à attaquer, ça me rassurerait que vous puissiez nous défendre tous les deux… Au signal, nous nous dispersâmes autour du bois et y entrâmes par groupes de deux par différents chemins. Grelottant de froid, je battais les troncs, les branchages, les fougères et les feuilles mortes pour rabattre les bêtes qui se seraient éventuellement trouvées dans les environs. Le bruit que je faisais était d’ailleurs superflu car tout en avançant, Jean-Baptiste ne cessait de parler, me faisant la gazette de ce qui s’était déroulé dans la maison et dans les environs les jours précédents. Il avait mis son fusil sur son épaule, si bien que si nous étions attaqués il n’aurait pas le temps mettre en joue puis de tirer. Toutefois, mon angoisse ayant disparu grâce à son babillage incessant, je réalisai qu’à moins d’être aux abois, les loups préféreraient attaquer une bête isolée plutôt que deux hommes à la fois. * Transi, glacé jusqu’à l’os par la froide humidité qui transperçait mon vêtement, j’avançais aux côtés de Monsieur Mahé. L’intendant me montrait comment traquer la proie, avait l’œil aux aguets, le fusil à la main. Il me prodiguait des conseils, mais refusait absolument de me passer son arme. — Mais comment pourrais-je apprendre sans pratiquer ? — Pour l’instant, vous observez. Et vous suivez mes conseils. Battez les fourrés avec votre bâton. Voilà, comme cela. — Vous savez, je sais tirer, c’est d’ailleurs votre fils qui m’entraîne. — Je sais, je sais, il dit même que vous vous y entendez fort bien. Mais lors de vos leçons vous ne tirez que de jour, en terrain dégagé. Ce soir il ne s’agit pas d’un entraînement. Ce soir, nous sommes plusieurs groupes d’hommes dispersés dans ce bois, dans l’obscurité, et nous traquons des bêtes qui peuvent être dangereuses, surtout blessées. Alors, chaque chose en son temps. Il s’agit de ne pas brûler les étapes. Ce soir, vous êtes ici en tant qu’observateur. Et d’ailleurs, ajouta-t-il après une courte pause, je me suis laissé dire qu’il s’agissait là d’une punition… Il sourit et se tut. Je me sentis très vexé que la nouvelle de notre mésaventure fût parvenue jusqu’à ses oreilles, mais après tout l’intendant n’est-il pas l’homme le mieux informé de ce qui se passe sur les terres de ses maîtres ? A cette réflexion, une idée me vint. — Dites-moi monsieur, puisque vous semblez si bien au courant de tout ce qui se déroule dans les environs, que savez-vous des troupes de brigands qui infestent les chemins des environs ? — Chercheriez-vous à vous venger de ce qui vous est arrivé ? Je me permets de vous le déconseiller. Vous devriez surtout vous estimer heureux de vous en être sorti à si bon compte. — Je commence à être fatigué d’entendre cela, répondis-je dans un soupir. — C’est pourtant vrai, reprit monsieur Mahé, et si Madame Guermeur était encore de ce monde elle n’aurait de cesse de vous le répéter jusqu’à ce que vous en soyez persuadé. — Mais j’en SUIS persuadé, je vous l’assure ! C’est seulement que le couplet commence à être lassant. — Pour répondre à votre question, ce que je sais d’eux est qu’il vaut mieux les éviter. Croyez-moi, j’ai essayé de me renseigner discrètement après la mort de votre mère. C’est un milieu peu rassurant. Je pensais pourtant que votre père voudrait creuser plus avant ces investigations, mais à dire vrai il était profondément affecté et n’était plus vraiment lui-même au cours des mois qui suivirent. Et comme si cela n’avait pas suffit, il ne s’était pas fait que des amis au cours de l’année précédente. C’était d’ailleurs une des raisons qui l’avaient poussé à conseiller à votre mère de venir se mettre au calme à Tanhouët. — Comment cela, "se mettre au calme" ? — Oh, c’est une affaire politique assez compliquée dans laquelle la plupart des parlementaires se sont opposés au gouvernement. — Ce qu’on a appelé l’Affaire de Bretagne ? — C’est cela. Je vois que vous connaissez. — Oh, je n’en connais que le nom, et je sais aussi qu’elle a conduit mon père comme les autres parlementaires à démissionner, avant d’être réintégré quelques années plus tard. Que pouvez-vous m’en dire d’autre ? — Comme je vous l’ai dit, c’est une affaire politique assez compliquée. — Me croyez-vous donc stupide au point d’être incapable de saisir ? Je suis maintenant en âge de comprendre. — Eh bien, si vous le désirez… Depuis quelque temps déjà, le parlement et l’assemblée des trois ordres de Bretagne s’opposaient au gouvernement de Sa Majesté, représenté ici par l’Intendant de Bretagne et le Commandant en chef, le Duc d’Aiguillon. A cette opposition, plusieurs raisons : la volonté du pouvoir royal d’imposer ici des taxes auxquelles l’Assemblée des États de Bretagne ne consentait pas, une utilisation jugée abusive de la corvée par les services du Duc d’Aiguillon pour construire des grandes routes qui, il faut pourtant bien le reconnaître, faisaient cruellement défaut, et aussi le soutient d’Aiguillon aux Jésuites auxquels le Parlement s’opposait. Bref, les rapports devinrent de plus en plus tendus. — Mais les Jésuites ont fini par être expulsés par ordre du Roi lui-même… — Oui, mais cela n’a pas suffit à apaiser les tensions, et les autres motifs de fâcheries demeurèrent. Il faut revenir plus de deux siècles en arrière : je vous rappelle que lors du traité d’union du Duché de Bretagne au Royaume de France, il était stipulé que le Roi ne pourrait lever ici aucun impôt supplémentaire qui n’ait été consenti par les États de Bretagne, ni exiger des bretons le lever d’une armée pour défendre un territoire autre que celui de Bretagne. Le Parlement a toujours veillé au respect de ces clauses, les rappelant au besoin ponctuellement afin qu’elles restassent en vigueur. — Le Parlement a donc autorité sur le Roi ? — Non, le Parlement délibère et ne peut s’appuyer que sur les lois déjà existantes. Nos lois coutumières, par exemple. Mais si l’issue de ses délibérations débouche sur un désaccord avec le Roi, le parlement peut lui présenter ses conclusions sous forme de remontrances. Lorsque la guerre contre l’Angleterre eût vidé les caisses, l’État devenu insolvable ne put emprunter et décida de lever des impôts supplémentaires. Mais les États de Bretagne réunis début 1765 refusèrent cet impôt, comme le leur permettait le traité de 1532, seulement le gouvernement s’obstina par la voix d’Aiguillon. Par ailleurs celui-ci était toujours en lutte avec le Parlement concernant entre autres le recours trop fréquent à la corvée pour doter la Bretagne de grandes voies de communication. * Jean-Baptiste et moi progressions lentement, tout en discutant. Ou plutôt il parlait et j’écoutais. Dans le même temps, et malgré les froid humide et glacial de cette nuit d’hiver, je savourais le plaisir du confort retrouvé : je pouvais à nouveau bouger mon bras gauche sans souffrir, ou presque. Je sentais juste une légère douleur lorsque j’élevais mon bras à la verticale ou que je portais une charge un peu lourde. Pour le reste, je pouvais presque croire avoir rêvé notre rencontre avec les brigands si ce n’étaient les sentiments d’épouvante et de malaise éprouvés et le souvenir encore bien vif de la douleur intense ressentie de longues heures durant à mon épaule gauche. — … après quoi Madame la Baronne a dit à Monsieur le Comte que si cela se révélait aussi inefficace qu’il le croyait, il n’y avait aucune raison de s’inquiéter car cela ne risquait aucunement de vous faire du mal. Il avait pourtant l’air assez irrité. Vous savez à quel point lui déplaisent les croyances surnaturelles… Il n’aime pas voir sa belle-mère vous encourager dans cette voie. — Le fait est pourtant que j’étais presque guéri dès après ma visite à cette femme de Tréffel. Je n’ai pas bien compris ce qu’elle m’a fait, mais j’en constate le résultat. Oh, bien sûr, Cyprien a insinué qu’il en aurait sans doute été de même si je n’y étais pas allé et que l’atténuation progressive de la douleur n’est qu’une coïncidence, ou bien même que c’est mon esprit qui s’est persuadé que j’avais beaucoup moins mal… des théories dans le genre de celles qu’aurait avancées ma mère. Je sais pourtant bien que ce n’est pas mon esprit qui souffrait de ma chute de cheval… Ou alors seulement dans sa partie amour-propre, reconnus-je dans un sourire. — Vous croyez donc vraiment à ces choses ? Je veux dire… les guérisseurs, les fontaines, les prédictions… — Je ne sais pas si je crois à tout ça à la fois mais… on dit que l’eau de certaines sources ou fontaines a des vertus magiques. Peut-être pas toutes, mais certaines… Pour ce qui est des prédictions, je suis moins sûr… j’entends par là que je n’aime pas beaucoup l’idée que tout est déjà prévu, l’avenir, ce qui va advenir de nous… Là je rejoindrais plutôt Cyprien : à quoi bon notre existence, si nous ne sommes que les acteurs involontaires d’une pièce qui se joue de nous, les exécutants d’une histoire qui existait déjà avant nous ? Ce sont plutôt nos décisions qui font l’avenir, non ? Nos choix plutôt qu’un destin fixé… — Croyez-vous donc que votre père ait choisi de mourir assassiné ? demanda Jean-Baptiste assez crûment. Je me senti blessé autant par la question que par le ton. — Il avait choisi de rester travailler à son chantier malgré l’heure tardive. C’est entre autre cette décision qui a entraîné sa mort. Il avait aussi décidé de porter secours à la comtesse plutôt que de fuir. Encore un choix. Il ne serait pas mort s’il avait fait des choix différents. En tout cas pas de cette manière ni à ce moment. Je me sentais obligé de prendre la défense de mon père dont l’héroïsme m’avait semblé attaqué par la remarque de Jean-Baptiste. — Un jour, on m’a fait une prédiction, me dit tout à coup Jean-Baptiste. C’était lorsque j’étais enfant. Par un jeune homme qui passait pour avoir des dons, des visions. C’est étrange, quand je suis ici, à Tanhouët, je suis tenté d’y croire, mais lorsque je me retrouve en ville, je me dis que ce sont des croyances d’un autre siècle et je n’ai plus envie d’y ajouter foi. — Et que dit-elle, cette prédiction ? Je le vis hésiter, avoir comme un moment de flottement. — Oh, c’était il y a très longtemps, j’étais petit. — Allons, ne me faîtes pas croire que vous avez oublié, sans quoi vous ne l’auriez pas évoquée ! — Elle parlait de trahison, de troubles, de choisir sa voie, son camp… — Vous voyez bien qu’il s’agit d’une affaire de choix et non de destinée ! Je sentais qu’il n’avait pas envie d’en dire davantage. J’avais l’impression de découvrir un autre Jean-Baptiste, moins léger et plus réfléchi que le bavard indiscret à l’affût des derniers commérages que nous connaissions, plus secret également, aussi incroyable que cela puisse paraître. Après cette confidence, je me sentis presque obligé de lui en faire une à mon tour. — Chez cette femme, murmurai-je, la guérisseuse, il s’est passé quelque chose d’assez étrange : à un moment, pendant qu’elle me soignait, elle s’est tournée vers Cyprien et a dit qu’elle ressentait quelque lien étrange entre nous, et qu’il fallait le soigner lui pour que je guérisse. Elle n’a pas précisé, mais je crois qu’elle était déconcertée par tout cela. Elle a eut l’air de penser qu’une partie de lui était moi, et qu’une partie de moi devait être lui. Jean-Baptiste ne dit rien. Étonné de ce silence inhabituel, je tournai les yeux vers lui je vis qu’il me regardait. Il semblait y avoir à la fois de l’attendrissement et de la nostalgie dans ce regard. — Vous grandissez, tous les deux, remarqua-t-il simplement. Puis, brusquement, il redevint le compagnon volubile et insouciant que je connaissais, et entreprit de m’entretenir des soucis que rencontrait le maréchal-ferrant de Kertanhouët avec son bon à rien de fils, celui-ci si maladroit qu’il paraissait avoir deux mains gauches. * J’aimais discuter avec l’intendant, c’était un homme patient avec lequel j’apprenais beaucoup. Bien sûr mon père avait commencé à m’initier à la gestion de terres, et je profitais souvent de la présence de Monsieur Mahé pour approfondir ce que je n’avais pas compris mais n’osais demander à mon père de peur de lui paraître lent d’esprit. Mais cette fois c’était d’un tout autre sujet dont nous discutions, un sujet que je n’aurais jamais osé aborder avec mon père : son passé. — Qu’arriva-t-il alors ? Comment en est-on arrivé au remplacement du Parlement ? — Les parlementaires présentèrent leurs remontrances, tandis que le gouvernement refusait de baisser pavillon. S’en suivirent plusieurs allers-retours de missives entre Rennes et Versailles, plusieurs lettres de remontrance du Parlement auxquelles répondaient comme en écho des injonctions d’enregistrer les impôts supplémentaires. Bref, le Roi et ses ministres tentaient un coup de force pour influer sur les décisions du Parlement et des États de Bretagne en des domaines dans lesquels ceux-ci étaient pourtant constitutionnellement souverains. — Mais enfin, une telle opposition obstinée aux volontés du Roi ne pouvait que leur coûter fort cher, quelles qu’en soient les raisons ! — Et ce fut effectivement le cas. Quelques magistrats étaient partisans de se soumettre, mais dans leur majorité, ils décidèrent de marquer leur désapprobation face à ces tentatives de coup de force en présentant leur démission. Ce fut fait en mai, ils argumentèrent en disant en substance que l’obéissance au Roi ne supplantait pas l’obéissance à la Loi, et qu’ils s’alarmaient de la volonté de substituer la force à cette loi. Suite à cela, les magistrats démissionnaires, dont votre père était, furent consignés à Rennes. Seuls douze parlementaires ne présentèrent pas leur démission. Douze, sur une centaine ! — Ils n’ont pas dû être vus d’un très bon œil ! — Le mot est faible ! Ils étaient presque mis au ban de la ville entière. Sauf bien sûr chez les partisans du duc d’Aiguillon. Il a même paru des caricatures les traitant – sauf votre respect – de jean-foutre, passez-moi l’expression. — D’après ce que vous me dites-là, ce sont surtout les non démissionnaires qui rencontraient l’hostilité. Pourtant, vous veniez de me dire que mon père avait eu des soucis et ne s’était pas fais que des amis à cette époque. — Bien sûr, puisque, si la ville était favorable dans son ensemble aux magistrats qui s’étaient démis, il n’en fut pas de même de la part du pouvoir et de ses représentants. Il y eut bientôt deux partis au sein de la société : le parti du duc d’Aiguillon et celui des parlementaires démis. Et, comme vous devez vous en douter, les intrigues allèrent bon train. Et l’on se mit de chaque côté à espionner les membres réels ou supposés de l’autre camp. Dans ses courriers, votre père me faisait part de son sentiment d’être épié. De plus, il enrageait de ne point pouvoir quitter la ville en cette saison où d’habitude il vivait à Tanhouët. Votre père me faisait également part de son aversion pour l’ambiance qui commençait à régner en ville, avec ses intrigues dans chaque salon ou presque, la suspicion omniprésente. Et c’est sans parler de cette impression d’être continuellement espionné par des partisans ou des hommes du duc d’Aiguillon, sur ordre de celui-ci ou pas, il ne savait. — Mais que pouvaient-ils donc espionner chez mes parents ? J’imagine mal mon père conspirant secrètement contre les ministres… — L’époque était différente, et votre père aussi était différent. Plus jeune… et… enfin, son mariage avec votre mère lui avait apporté un souffle de jeunesse. Il s’est assombri après sa mort, il s’est un peu plus refermé… encore plus qu’après celle de son frère. Mais pour en revenir à la surveillance dont il se sentait l’objet, je vous dirais que, même si elle ne semble pas aujourd’hui justifiée, l’ambiance était alors à la suspicion générale. Les épouses des protagonistes étaient souvent elles aussi au cœur de ce système, comme la femme de l’avocat général, ou celle de l’intendant. Au sein de ces petits groupes, on échafaudait des plans, on discutait dans les salons, et surtout on s’écrivait. On s’écrivait beaucoup. Beaucoup trop, même, et surtout beaucoup trop imprudemment. C’était parfois assez puéril et d’autant plus risqué que le courrier était lui aussi bien évidemment surveillé, souvent intercepté par les services du ministère ou du duc d’Aiguillon, et certaines lettres se seraient même retrouvées sur le bureau du comte de Saint-Florentin, le secrétaire d’état. Votre père a craint que votre mère ne soit tentée par ce monde des intrigues, à la fois pour tromper son dépit de rester en ville et par le désir d’aventure que son jeune âge lui inspirerait peut-être. Pour la soustraire à cet environnement assez malsain, il lui conseilla de rejoindre Tanhouët et lui confia le soin du domaine. Elle revint donc et c’est à elle que je fis mes rapports jusqu’au retour de votre père en fin d’année, lorsqu’il reçut enfin l’autorisation de quitter Rennes. — Vous l’avez bien connue ? Comment était-elle ? — Je crois que les craintes de votre père étaient injustifiées. Elle n’était pas issue d’une famille de Robe. Vieille noblesse d’épée, comme on dit. Je ne suis pas certain que les affaires politiques l’aient passionnée, en cela elle avait peu de choses en commun avec lui. Mais je crois qu’elle faisait des efforts pour s’y intéresser, elle m’informait des développements de ce qui se déroulait à Rennes, de ce qu’elle en apprenait par son mari ou ses amis restés là-bas. Je ne crois pas qu’elle se serait laissée séduire par les intrigues et les complots. Encore que… je ne l’ai pas assez bien connue pour avoir le droit d’émettre un avis sur la question. Elle discutait avec moi de la vente du grain, de la Saint-Michel et de la perception des droits sur les fermes, les moulins et les fours, bref, de tout ce qui concernait la régie de vos biens. Et je dois vous dire qu’elle s’y entendait : on sentait que ses parents l’avaient initiée à la gestion des terres, encore que celles de votre famille soient bien plus importantes et d’un bien meilleur rapport. C’est encore elle qui s’occupa de faire refaire les charpentes des écuries, ou de la remise, je ne sais plus… Les charpentes… Ainsi donc, me dis-je alors, au-delà même des circonstances de sa mort, c’était déjà à ma mère que je devais la présence de Clément dans mon existence… * La battue en elle-même fut assez peu passionnante, du moins pour moi qui ai passé cette nuit-là à battre les fourrés avec mon bâton sans apercevoir la queue d’un seul loup. Ceci étant dit, je fus plutôt soulagé de cette absence de rebondissement, car j’avais eu mon compte d’émotions fortes dans la semaine et n’aurais pas aimé me retrouver nez à nez avec une de ces bêtes, même sachant Jean-Baptiste à mes côtés. Lorsque nous retrouvâmes les autres, ils faisaient cercle autour des cadavres de deux loups, tués chacun d’un coup de fusil, l’un au flanc et l’autre entre les deux yeux. C’était le comte qui avait abattu ce dernier, ce qui du même coup nous rassura sur ses talents de tireur. Je retrouvai enfin un Cyprien frigorifié qui me dit n’avoir lui non plus croisé aucun loup au cours de la battue. Il m’affirma en être dépité, mais je le connaissais suffisamment pour savoir qu’au fond de lui il en avait été plutôt rassuré et que, même s’il ne voulait se l’avouer, il n’aurait pas aimé se retrouver face à face avec la bête en question en pleine nuit au milieu des bois. La sanction imposée pour notre inconséquence n’avait été finalement qu’une corvée à peine ennuyeuse. A moins que la vraie punition imaginée par le comte n’eût été ces jours passés au cours desquels l’angoisse d’entrer de nuit dans un bois fréquenté par des bêtes dangereuses était montée peu à peu jusqu’à m’empêcher presque de fermer l’œil... Je décidai de retenir la leçon. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Lun 1 Juil 2013 - 20:01 Lun 1 Juil 2013 - 20:01 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre XI : Vide-grenier L’année 1780 commençait froidement. Depuis une semaine en ce mois de février, les températures avaient chuté et nous craignions d’avoir à faire face à un hiver bien plus rigoureux qu’à l’accoutumée. Pourtant au nouvel an encore le climat était fidèle à la douceur qui était habituellement la sienne par chez nous, sans pour autant que le froid nous ignorât totalement. Un hiver comme les autres semblait alors s’annoncer. Mais ses rigueurs se durcirent peu après la nouvelle année. Tout en espérant que ce ne serait qu’un épisode passager au milieu d’un hiver sans histoire, nous nous préparions à subir les mois les plus froids que Clément et moi ayons encore jamais connus. Nous allions sur nos treize ans et j’avais encore grandi. J’avais dû me défaire de presque toute ma garde-robe devenue trop petite et dont Clément avait donc hérité. Mais lui-même n’avait encore que très peu poussé, si bien qu’il ne pouvait pas encore mettre ces vêtements qui attendaient donc au fond d’une armoire qu’il grandisse enfin. Je faisais maintenant presque la même taille que mon père et savais bien que cela déplaisait à Clément, mais qu’y pouvais-je ? Je n’avais la possibilité ni de ralentir ma croissance, ni d’accélérer la sienne. Je lui aurais pourtant volontiers donné les quelques pouces qui nous séparaient afin de le mettre plus à l’aise si cela avait été en mon pouvoir. Je crois qu’il s’en rendait d’ailleurs bien compte et faisait l’effort de ne rien montrer de son mécontentement. La chandeleur fut particulièrement froide et, fait très rare dans nos contrées, nous eûmes même plusieurs jours de neige. A ceci s’ajoutait l’anniversaire de la mort de Lucie. Si la douleur qui y était associée s’atténuait, ce souvenir faisait toujours s’abattre sur nous la sensation d’un froid glacial et pénétrant à cette période de l’année. Déjà deux années sans elle. Je voyais Clément s’assombrir jour après jour. Il aurait aimé lui porter un bouquet, ainsi qu’à son père, mais le jardin hibernait et les seules fleurs qui l’égayaient étaient celles des camélias rouges. Mon père avait encouragé Clément à les cueillir pour ses parents, mais c’étaient les seules couleurs vives du jardin et il se refusa à couper ces fleurs délicates pour les porter au cimetière où elles faneraient trop vite. Les mimosas, d’habitude magnifiques, avaient cette fois trop souffert du gel et Youenn parlait même d’en abattre un ou deux. Quel dommage, Lucie les aimait tant… Surtout leur odeur légère qui était comme un avant-goût de printemps. Nous ne mettions presque plus le nez dehors, trop frileux pour braver ces températures auxquelles les hivers précédents ne nous avaient pas habitués. Soazig nous gâtait de chocolat chaud à toute heure de la journée dès que ma grand-mère avait le dos tourné. Nos leçons nous donnaient beaucoup de travail, le rythme s’était intensifié à la demande de mon père qui m’estimait assez vieux pour aborder les études avec plus encore de sérieux qu’auparavant. Par chance, il nous restait tout de même encore bien du temps libre. Après une nouvelle péripétie dans l’opposition parlementaire au pouvoir royal qui avait amené une fois encore les magistrats à démissionner en 1775, ils avaient été rétablis dans leurs charges presque deux ans auparavant et mon père se trouvait donc alors à Rennes. Il nous était arrivé de l’y accompagner dans notre enfance, bien qu’il préférât que je grandisse à Tanhouët, et la vie dans notre hôtel particulier près de la place du Parlement n’avait pas pour un enfant les mêmes attraits que celle que nous menions au manoir. Par-dessus tout nous manquions cruellement d’espace et de liberté. Nous étions trop accoutumés à vagabonder au grand air dans les alentours de Tanhouët pour rester longtemps à l’intérieur d’une maison. Habituellement la ville ne m’attirait pas, mais je commençais cette fois à regretter qu’il ne nous ait pas emmenés avec lui, d’autant qu’à ce qu’on disait il y faisait un peu moins froid que dans nos campagnes. * Glacé, je me tournais et me retournais dans mon lit, enveloppé dans ma couverture, mais rien n’y faisait. Je ne parvenais toujours pas à me rendormir. Quelle heure pouvait-il bien être ? Il faisait encore nuit dehors, mais en février nous n’attendions jamais l’aube tardive pour nous lever. Se lever… C’aurait sans doute été la meilleure chose à faire, mais à la simple idée d’écarter la couverture et de livrer mon corps au froid glacial de la chambre, je fus parcouru d’un frisson d’horreur, et la chose me parut aussi insurmontable et inconcevable que sauter d’une falaise dans la mer déchaînée. J’entendis remuer à l’étage inférieur. Juste en dessous de moi. La chambre de Cyprien. Chez lui aussi le feu de cheminée avait dû s’éteindre depuis longtemps et pourtant il avait trouvé le courage de se lever. Rien que d’entendre ce bruit familier et rassurant, et sans doute un peu honteux aussi de n’avoir pas été le premier à le faire, je trouvai en moi suffisamment de bravoure pour affronter le froid de ce matin hivernal. En deux secondes je fus debout. La brûlure de l’air glacé me fit un choc, et je me sentis transpercé jusqu’aux muscles, jusqu’aux os. Je me précipitai vers mes vêtements, enfilai immédiatement ma culotte de laine, une première paire de bas puis une deuxième, un gilet et une veste bien épaisse. Les habits étaient tout aussi glacés que la pièce mais ils se réchaufferaient vite au contact de mon corps. Je m’approchai du broc en faïence pour me laver le visage et le cou, mais je vis une très légère croûte de glace à la surface de l’eau et décidai de renoncer. J’étais certes courageux, mais pas à ce point. Après un rapide coup de peigne, je me précipitai en cuisine et bénis Soazig d’être déjà debout et d’avoir allumé le fourneau. Il régnait dans la pièce une température qui, après celle de ma chambre, me parut presque estivale. Là je pus faire mes ablutions et vis arriver Cyprien, transi tout autant que je l’étais peu avant, et qui fit un large sourire en pénétrant dans l’office. Il avait lui aussi attendu d’être là pour procéder à sa toilette. — Il faudra dire à Youenn de ramener du bois dans la réserve… lança Soazig en guise de bonjour. Il en a encore fait une fraîche, cette nuit, ajouta-t-elle. Bon, je vais aller dire à Louise de faire vos chambres. Louise était la nouvelle femme de chambre. La précédente, Yvonne, était trop malade pour continuer son service et était partie vivre chez sa fille. Le comte veillait à ce que le médecin passât la voir régulièrement et s’assurait qu’elle ne manquait de rien. Il avait déjà proposé ce genre d’arrangement à Youenn qui se faisait de plus en plus vieux, mais celui-ci ne prétendait pas abandonner son poste et voulait continuer à s’occuper du parc. Heureusement, son fils travaillait à ses côtés et s’occupait de plus en plus du gros de la besogne. En ce jour nous avions quartier libre. Un message était arrivé la veille de l’épouse de notre précepteur disant qu’il était cloué au lit par un refroidissement et ne pourrait venir assurer ses leçons. En temps habituel nous aurions été ravis de ce répit, bien que navrés pour Monsieur Cloarec, mais le temps n’incitait guère à sortir et nous nous penchâmes sur les travaux qu’il nous avait laissés à faire. Même malade, il s’arrangeait pour nous faire étudier. Cela aurait plu à ma mère… * Après le déjeuner, ma grand-mère demanda à Soazig de préparer un café bien chaud. Tout en le dégustant, nous bavardions de tout et de rien. Cela me faisait un bien fou de sentir le liquide brûlant me descendre le long de la gorge jusque dans l’estomac. Je m’étais fait à son amertume ainsi qu’à sa couleur pourtant peu attrayante. Soazig l’avait amené presque bouillant, si bien que je m’étais brûlé la langue à la première gorgée. Mais peu importait. J’étais douillettement installé au coin d’un feu dont les couleurs vives égayaient le salon, et j’écoutais ma grand-mère raconter comment jadis ses enfants inventaient toute sorte d’astuce pour se tenir chaud lorsque le bois venait à manquer. Je n’avais jamais imaginé ma mère enfant. Je ne l’imaginais d’ailleurs jamais, même adulte. — Un jour, elle et un de ses frères étaient allés se promener. C’était aux alentours de la Noël… non, de la Chandeleur… non, c’était à Noël. Ils ont été surpris par une averse, très brève, mais il avait plu des cordes. Leurs vêtements étaient à tordre et ils ont encore été une heure avant de rentrer à la maison. Transis de froid, bien entendu. Ils tremblaient des pieds à la tête. Nous les avons déshabillés et enveloppés dans des couvertures. Par chance, le poêle était resté allumé à l’office et ils s’y installèrent. Lorsque notre cuisinière revint une heure plus tard, elle les trouva endormis, allongés sur le poêle. — A même le poêle ? m’étonnai-je. — Oh, ils avaient tout de même eu la présence d’esprit de l’éteindre pour éviter que leurs couvertures ne s’enflammassent. Ils en avaient étendu une sur le poêle, s’étaient allongé dessus et avaient ramené la seconde couverture sur eux. Et ils s’étaient paisiblement endormis. Il n’y a que des enfants pour avoir des idées pareilles. Seulement, ma cuisinière bougonna qu’elle avait besoin de la place à moins que nous voulions manger froid. Et puis d’ailleurs en une heure de temps, la température avait considérablement chuté dans la pièce. A ce moment-là, Clément regarda en direction de la cuisine, ce qui n’échappa pas à ma grand-mère. — Ne vous avisez pas de faire une chose pareille ! Vous avez passé l’âge de ce genre de bêtises… du moins je l’espère… Et d’ailleurs, ajouta-t-elle en riant, je n’ose imaginer ce que dirait Soazig si elle retrouvait l’un de vous vautré ainsi sur SON fourneau… Je crois que nous n’aurions pas fini de l’entendre ! — En fait, dis-je, par un temps pareil il ne faudrait pas quitter son lit, c’est encore là qu’on est le mieux ! — À la condition d’avoir encore du feu dans la cheminée de sa chambre, précisa Clément en se remémorant sans doute le réveil glacé du matin même. — Vous êtes tous deux trop habitués au confort. Songez donc que tout le monde n’a pas du bois à volonté pour passer l’hiver ! — Je plains ceux qui ne sont pas dans notre cas, Grand-mère ! — Les plaindre ne suffit pas à les réchauffer. Demain matin vous irez à Kertanhouët vous informer si quelqu’un manque de bois de chauffage pour sa maison. La perspective de sortir ne m’apparaissait pas du tout attrayante. — Et pourquoi pas dès maintenant ? demanda Clément qui réalisa avant moi que les matins risquaient d’être plus froids encore que les après-midi. — J’ai d’autres projets pour vous, dans l’immédiat. J’étais assez inquiet, me demandant si elle comptait nous envoyer dehors cet après-midi-là ET le lendemain matin. — Vous allez m’aider à récupérer quelques affaires au grenier. Des vêtements chauds qui ne servent plus et pourront rendre service à d’autres. Ils sont rangés dans des malles, mais je ne sais plus à quel endroit du grenier. Sans compter que depuis mon arrivée ici, le grenier s’est rempli et elles ne sont peut-être plus accessibles… J’ai passé l’âge de porter des caisses et de déplacer des meubles, vous ferez cela pour moi. — Yvonne et Soazig ne pourraient-elles pas le faire ? — Yvonne et Soazig ont suffisamment à faire comme cela, aboya-t-elle, et c’est à vous que je dis de le faire. Que ceci vous suffise. Par moments, elle commençait à prendre des airs de Lucie, me dis-je alors. Il faut bien dire qu’à présent que mon père était le plus souvent à Rennes, le domaine de Tanhouët était sous l’entière responsabilité de ma grand-mère. C’était une lourde charge et elle se montrait donc parfois plus irritable qu’à son arrivée deux ans auparavant. * Le grenier occupait presque entièrement le dernier étage du manoir, juste sous les toits, à côté des chambres de Soazig, d’Yvonne, de celle qu’avait occupée ma mère et de la mienne. Je l’avais toujours connu encombré d’une foule d’objets hétéroclites : des miroirs, des caisses vides, des caisses remplies de chiffons, des matelas usagés, des sabres rouillés, des meubles cassés, des tableaux entassés ou négligemment appuyés au mur, des malles de vêtements anciens, des vieilles couvertures, de la vaisselle ébréchée… Sur tout ceci s’étalait une couche de poussière allant de plusieurs mois à plusieurs années. Cette pièce avait constitué un terrain de jeux merveilleux pour les enfants que nous avions été, d’autant plus attirant que nous n’avions pas le droit d’y aller. Ma mère disait qu’il y avait là trop de choses dangereuses, trop d’empilements instables et trop de saleté pour nous y laisser jouer. Afin de nous en dissuader elle nous avait même dit qu’on y trouvait des rats, mais cette affirmation, jamais vérifiée du reste, n’avait fait qu’attiser notre curiosité. En y pénétrant, nous pûmes de suite sentir que cette pièce était plus froide encore que le reste du château. Plus humide aussi. C’était une humidité glaciale qui vous pénétrait plus profondément encore que le froid ordinaire auquel nous commencions lentement à nous habituer. Elle saisissait le corps jusqu’à la moelle. La baronne sembla n’y prêter aucune attention et se mit à soulever des draps, à se pencher par-dessus des caisses, à déplacer des sacs. — Bougez, vos aurez plus chaud, nous enjoignit-elle. Enfin… vous aurez moins froid, pour être plus juste. — Que devons-nous chercher ? — Deux malles en bois de hêtre, l’une tapissée de toile écrue, l’autre en bois brut. Toutes deux marquées à mon nom. Elles ne sont là que depuis deux ans, elles ne doivent pas être enfoncées trop loin dans ce fouillis… Et je me mis à mon tour à chercher. J’avais les doigts gelés et ne sentais plus mes orteils, mais pour le reste elle avait raison, je commençais à lentement me réchauffer. Tout à coup, je la vis tendre la main et designer du doigt quelque chose. — Là, en voilà une ! Voudriez-vous dégager cette table ? La malle était coincée derrière une table de toilette dont la tablette en marbre était fêlée sur toute sa longueur. Cyprien prit un côté, moi l’autre. C’était passablement lourd. Il réussit à l’écarter suffisamment pour extirper la malle de son logement en la traînant au sol. Pendant que nous effectuions cette manœuvre j’entendis un autre cri de victoire derrière moi. — Et voilà la seconde ! Parfait, quand vous aurez descendue celle-ci dans ma chambre, vous viendrez chercher l’autre. — Pourquoi les descendre ? Pourquoi ne pas plutôt les vider ici ? — Et poser les vêtements dans cette couche de poussière et de saleté ? Non, je vais les trier dans ma chambre. Nous dûmes donc traîner, pousser, soulever cette malle à travers le grenier, puis, pire encore, la descendre d’un étage par les escaliers. Ma vieille douleur à l’épaule se réveilla à l’effort que je fis alors, et lorsque nous fûmes remontés je proposai à Cyprien de faire une pause. — Bonne idée, me répondit-il. D’autant que trier toutes ces vieilleries lui demandera du temps. Ce n’est pas la peine de se précipiter avec la seconde malle. — Je serais de toute façon pour l’instant bien incapable de me précipiter. L’effort fourni m’avait fait transpirer et oublier le froid ambiant. La baronne avait raison, bouger nous avait réchauffés. * Clément s’était assis sur un coffre, ou plutôt il s’y était effondré, massant son épaule gauche de sa main droite. Lorsqu’il faisait un effort prolongé ou très intense, il disait ressentir une petite douleur à l’endroit de la luxation qu’il s’était faite l’année précédente. Je m’assis à côté de lui et tout en reprenant mon souffle, je jouais avec un morceau d’étoffe passablement usé et crasseux. Il s’adossa à une poutre en regardant autour de lui. — Je crois bien que cela faisait plusieurs années que je n’étais pas venu ici ! lâcha-t-il. — Rappelle-toi, nous nous étions aménagé une cabane avec quelques vieux draps troués tendus entre les meubles ou les caisses… — Jusqu’à ce que ma mère vienne nous débusquer… Je ne compte plus le nombre de fois où elle est venue nous déloger du grenier ! — Ce que j’aimais par dessus tout, c’était fouiller parmi les vêtements anciens pour trouver de quoi me déguiser. — Oh, regarde l’intersection des poutres là-haut ! Tu te souviens ? Je me souvenais très bien. Nous nous entraînions à atteindre cette cible avec un projectile quelconque, généralement l’un de nos souliers. C’était à celui qui visait le mieux. Lui, généralement. Je le vis se lever, ôter sa chaussure gauche, viser et tirer. Un peu trop haut. Le soulier heurta la poutre verticale et retomba avec un bruit sourd. C’était mon tour. J’attrapai une vieille botte qui se trouvait à ma portée et la lançai de toutes mes forces. Beaucoup trop bas. Le projectile passa droit sous les poutres et continua sa course jusqu’à frapper une pile d’objets qui s’effondra avec fracas, soulevant un nuage de poussière. — Aïe, j’espère que je n’ai rien cassé ! Regardant entre les pieds de chaises empilées posées sur une longue caisse, je jetai un œil aux dégâts que je venais d’occasionner. Gisaient au sol quatre vieux livres aux couvertures arrachées, un miroir – demeuré par chance intact malgré la chute – deux sacoches, des étriers, un vase réduit en miettes et un petit tableau représentant une nature morte. Pour aller ramasser tout cela, nous dûmes nous frayer un passage et déplacer une vieille armoire, heureusement vide. Derrière l’armoire se trouvaient deux grands tableaux encadrés Le premier était retourné face contre le mur, ou plutôt contre l’autre tableau. L’un des deux était apparemment une large représentation de Saint Michel terrassant le Dragon. L’autre, une fois retourné, nous révéla le portrait en buste d’une jeune femme. La pile d’objet, elle, avait dissimulé un troisième tableau : l’immense portrait en pied d’un jeune homme en uniforme. En regardant cet homme je fus frappé par quelque chose, sans pouvoir définir précisément ce que c’était. Ce fut Clément qui m’apporta la réponse. — Certainement quelqu’un de ta famille, pour qu’il soit là. — Si tel était le cas, il ne serait pas mis au rebut dans le grenier, tu ne crois pas ? — Va savoir, il a peut-être été déçu par le travail du peintre et n’aura pas voulu accrocher le tableau. En tout cas, je lui trouve un petit quelque chose de familier, sans savoir vraiment quoi. Le front, peut-être. Il me rappelle celui de ton père. — Je le trouve pourtant très réussi, ce portrait ! — Comment peux-tu dire s’il est réussi ? Tu n’en sais rien, tu ne connais pas le modèle ! Clément était parfois d’une logique désarmante. Un trait de caractère que Lucie était parvenue à lui transmettre. — En tous cas, tu as raison, il s’agit forcément de quelqu’un de notre branche, il se dégage de l’ensemble de sa personne quelque chose qui me la rend familière… qui me donne l’impression de déjà le connaître. Pas tant dans les traits du visage… Quelque chose de plus général… Mon regard se posa sur les deux autres tableaux. Un Saint Michel plein de fougue et de vigueur triomphait d’un dragon semblant plus vrai que nature. Mais la toile paraissait abîmée en plusieurs endroits. Sans doute la raison pour laquelle on l’avait remisée. A moins que ce ne soit le séjour prolongé dans ce grenier qui l’ait altérée de la sorte. Le style était ancien, les couleurs semblaient ternies et le cadre était piqué par les vers. Le dernier tableau semblait en bien meilleur état de conservation. D’ailleurs, à en juger par l’habillement de la jeune femme, il était bien moins ancien que le Saint Michel. Une vingtaine à une trentaine d’années peut-être. Difficile de dater plus précisément : dans nos campagnes, les capricieux mouvements de la mode n’étaient pas suivis avec autant d’assiduité qu’à Paris ou Rennes, même par les jeunes femmes. Mon père s’était plu à nous rapporter qu’à Rennes l’année passée, les élégantes avaient mis un point d’honneur à surmonter leurs perruques d’une réplique miniature de la frégate "La Belle Poule" depuis qu’au mois de Juin précédent ce navire était sorti victorieux d’un combat contre la frégate anglaise "l’Aréthuse" au large des côtes bretonnes. La femme de ce portrait était vêtue avec soin mais sans ostentation. Je remarquai aussitôt ses yeux aussi bleus que l’océan un jour de grand beau temps. Elle semblait petite, menue, presque frêle, et ne portait pas de perruque. Ses cheveux naturels, relevés en arrière, descendaient en volutes blondes jusqu’à la naissance de ses épaules. Elle semblait infiniment sereine et avait sur les lèvres un très léger sourire empreint de douceur et de fraîcheur. Elle était vêtue de jaune clair et portait des boucles d’oreilles formant un ruban d’or vrillé terminé de petites perles. A son poignet étincelait également un bracelet d’or rehaussé de perles, et à sa main, une bague assortie. * Contempler ce portrait avait quelque chose d’apaisant. Il en émanait un sentiment de bien-être et de délicatesse. Cyprien, toujours moins sensible que moi à la magie des atmosphères, m’arracha au charme de cet instant en formulant à haute voix la question qui s’était insinuée en moi à la découverte de ce portrait. — Mais que fait donc ce tableau ici, au grenier ? Il serait bien mieux mis en valeur accroché dans une pièce en bas ! — Tu sais donc qui y est représenté ? lui demandai-je d’un air surpris. — Pas la moindre idée, mais qu’importe ? J’aime beaucoup ce portrait, je le trouve… — Plein de jeunesse ? — Plein de fraîcheur, voulais-je plutôt dire. Mais, de jeunesse aussi, ajouta-t-il, tu as raison. Une idée de l’identité du modèle ? — Si toi-même l’ignores, je ne vois pas comment moi je le saurais. Encore quelqu’un de ta famille, je présume, quoique là, je ne remarque aucune ressemblance. Peut-être une cousine ? — Peut-être une fiancée potentielle éconduite, suggéra-t-il en plaisantant. Ce qui expliquerait pourquoi elle aussi se trouve au rebut. — Ton oncle, le frère aîné de ton père, n’était-il pas marié ou fiancé avant de mourir ? — Je n’ai jamais entendu pareille chose, non. — Alors peut-être ne l’était-il justement pas, ce qui est une excellente raison de cacher ce portrait… répliquai-je en souriant. — Sans doute, répondit Cyprien en riant, mais tu te fais des idées. Mon oncle est mort il y a plus de trente ans, ce qui, à mon avis, est antérieur à ce tableau. — Peut-être un portrait de la première épouse de ton père, que ta mère aurait fait retirer des murs à son arrivée ici ? — Plausible, encore qu’elle soit morte peu de temps après mon oncle. Je crois que mon père avait à peine vingt-cinq ans lorsqu’il est devenu veuf pour la première fois. Son père, son frère, puis sa femme… cela n’avait pas dû être une période heureuse pour le comte… — Par contre… reprit Cyprien, je me demande… — Oui ? — Eh bien… Je réalise maintenant que je n’ai jamais vu de portrait de ma mère… Il n’y en a pas un seul dans le château… Étrange, maintenant que j’y pense. — Sans doute ton père craignait-il de raviver sa douleur… Ou de faire naître chez toi des regrets. Je ne sais pas… Par exemple, ma mère ne me parlait que rarement de mon père… Je me tus. Comme presque à chaque fois que j’évoquais maman, ma voix se brisa et je sentis à nouveau cette boule familière grossir au creux de ma gorge. Dieu que cela faisait mal, encore deux ans après ! Je comprenais parfaitement la volonté du comte d’éviter ce qui pouvait raviver le souvenir de sa défunte épouse. — Dis-moi… d’après toi, serait-il possible qu’il s’agisse d’elle ? demanda Cyprien, perplexe. L’habillement paraît pour le coup un peu vieillot… — La famille de Trevinou n’avait apparemment pas vraiment les moyens de suivre les caprices de la mode, tu sais… et ne devait pas non plus être tellement du genre à s’en préoccuper. — Tout de même, il n’y a pas grande ressemblance… — Ah pardon, tu as les mêmes cheveux blonds et souples que la femme de ce portrait ! — Mais pour le reste… Regarde comme même seule elle paraît petite ! Je le vis se mordre les lèvres pendant que je lui jetais un regard assassin. Je détestais qu’on insistât sur sa grande taille tandis que je culminais toujours à celle d’un enfant. A l’époque de notre adolescence, la moindre allusion, même involontaire, à ma petite taille ou à ma constitution chétive suffisait à m’assombrir pour plusieurs heures. Renfrogné, je finis de ramasser le tas d’objets que nous avions renversés et rappelai à Cyprien que sa grand-mère nous attendait. Nous laissâmes là l’inconnue au bracelet d’or et de perles, et descendîmes en ahanant la seconde malle chez la baronne. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Sam 6 Juil 2013 - 22:05 Sam 6 Juil 2013 - 22:05 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre XII : Les rigueurs de l’hiver Le lendemain, emmitouflés comme nous le pouvions dans des manteaux, des capes et des écharpes, nous avions affronté le froid pour nous rendre jusqu’au village de Kertanhouët. Les chevaux que nous avions empruntés aux écuries pataugeaient dans la neige fondante et semblaient goûter aussi peu que nous les hivers rigoureux. Arrivant sur la place, je me mis en quête d’un abri pour nos montures tandis que Cyprien frappait à la porte du presbytère. Ce fut le recteur Hélias lui-même qui nous ouvrit. — Entrez donc, mes enfants, venez vite vous mettre au chaud. En fait de chaleur, l’intérieur du presbytère était traversé de courants d’air, malgré les chiffons qui tentaient de calfeutrer les entrées autour des fenêtres et des portes. Pourtant, venant de l’extérieur, nous ressentîmes un bien-être immédiat en pénétrant dans la pièce. Un faible feu rougeoyait dans l’âtre, suffisant pour que sa vue nous réchauffât l’âme, mais pas pour que sa chaleur réchauffât nos corps. — Bonjour mon père, dit Cyprien tandis que nous ôtions nos tricornes. — Bonjour mon père, dis-je en écho. — Bonjour mes enfants. Mettez-vous à votre aise, je vais prendre vos manteaux. Comme vous le voyez, Jeanne-Marie n’est pas là, je l’ai envoyée chez les Guillerm. Elle s’occupera des petits le temps que la mère se rétablisse du coup de froid qui l’oblige à garder le lit. Jeanne-Marie était la vieille servante du père Hélias. Elle prenait grand soin de son maître et trouvait sans cesse qu’il se fatiguait trop. Pourtant le père Hélias, sans être encore un jeune homme, était dans la force de l’âge et semblait solide comme un roc. Il était plus jeune que mon père, mais était déjà le curé de Kertanhouët avant notre venue au monde. C’était d’ailleurs lui qui nous avait baptisés, Cyprien et moi, et c’était encore lui qui avait enterré mon père et sa mère quelques jours plus tard. Il avait les épaules carrées, la mâchoire carrée, le visage carré aux traits comme taillés à la serpe, buriné par le grand air ; et cet homme à l’allure extérieure tout en aspérités n’avait pourtant intérieurement pas son pareil pour arrondir les angles entre ses ouailles. — Comme vous voici emmitouflés, s’écria-t-il en nous voyant retirer une à une nos couches de vêtement. Quelle température vivifiante, ne trouvez-vous pas ? s’exclama-t-il, les yeux pétillant de malice. Sur son invitation, nous nous installâmes auprès de la cheminée, au plus près, même, tant étaient faibles les flammes de ce très modeste foyer. — Alors, que me vaut l’honneur d’une visite de notre jeune seigneur par un temps si peu favorable à la promenade ? — Mon père, déclara Cyprien, je viens à la demande de ma grand-mère m’informer des besoins des habitants de Kertanhouët pour faire face aux rigueurs de cet hiver. Elle m’a chargé de vêtements chauds à remettre aux plus nécessiteux, et je me suis dit que nul ici n’était mieux au fait que vous de la situation de vos paroissiens. — Madame la baronne est bien bonne, et vous me voyez ravi de cette proposition. Mais, dame ! je me dois de vous informer, jeune Monsieur, que nos paroissiens ne manquent pas seulement de vêtements. Le bois aussi fait cruellement défaut à certains foyers, et puisque que les arbres des talus et des chemins appartiennent à Monsieur le comte, je me permets de suggérer qu’une contribution aux besoins de certaines familles en la matière – ou alors la simple autorisation pour elles d’aller ramasser du petit bois de chauffage – permettrait à Monsieur le comte de s’acquitter du soin que prennent ces personnes à entretenir lesdits talus et chemins par leur travail quotidien en plus de la corvée. — Monsieur le recteur, répondit Cyprien, j’en ferai part à ma grand-mère, soyez-en assuré. Je regardai les faibles flammes vacillant au dessus de quelques braises rougeoyantes et me dis alors que le recteur ferait bien de se soucier d’alimenter son propre foyer. Je regrettais maintenant d’avoir retiré manteau et écharpe en entrant. — De plus, poursuivit le recteur, certains foyers manquent de grain, et son prix renchérit. Je me suis laissé dire que Monsieur le comte n’avait pas encore vendu tout le sien, et en bon et charitable chrétien il souhaitera sans nul doute contribuer à venir en aide aux familles les plus éprouvées vivant sur ses terres. — Je rapporterai ceci également à la baronne, mon père, assura Cyprien. Mais pour ce qui est des vêtements dont elle m’a chargé, pouvez-vous par exemple m’indiquer des noms parmi vos paroissiens les moins armés pour faire face à cet hiver glacial ? Une fois encore, je me dis que le père Hélias ne devait pas être de ces hommes pour lesquels charité bien ordonnée commençait par eux-mêmes, car je ne pouvais détacher mes yeux de sa soutane râpée et rapiécée par-dessus laquelle il ne portait pas de veste, malgré les courants d’air traversant son logis. ~ o ~ o~ o ~ Le recteur Hélias était un diable d’homme qui savait ce qu’il voulait, et auquel il était difficile de dire non. Vous veniez offrir de prêter la main, il s’arrangeait pour que vous donniez le bras tout entier. Dans le presbytère il faisait presque aussi froid que sur la place devant la petite église, le vent en moins ; encore que je pusse sentir le souffle glacé de l’air qui s’engouffrait sous les portes et à travers un carreau cassé de la fenêtre. Je tâchai de ramener la conversation plus précisément sur les vêtements et les couvertures que ma grand-mère m’avait chargé de distribuer. — Eh bien, répondit le prêtre, il y a par exemple les Hamon qui pourraient en avoir l’usage, vous savez, ceux qui ont eu le feu à leur ferme à l’automne dernier. Et puis aussi les Gestin, et les Bourhis, dont le père est parti de la pneumonie l’an passé. Vous pourriez également aller voir les Salaün, et les Guillerm chez lesquels se trouve Jeanne-Marie ces temps-ci. Et puis tenez, les Péron aussi. À force de se repasser les vêtements des aînés aux plus jeunes, chez eux les cadets ont plus de trous que de tissu à leurs habits… Ce n’est pas à vous deux que j’apprendrai que les enfants courent, jouent, sautent, grimpent, tombent et déchirent leurs vêtements, ajouta-t-il avec malice. Certes, nous étions déjà bien au fait de ceci. — Mon père, intervint alors Clément, cela fait de nombreux foyers ; j’ignore si nous aurons suffisamment de linge pour tous. — En ce cas, je ne doute pas que monsieur le comte trouvera d’autres moyens de soutenir nos paroissiens dans l’épreuve de ce rude hiver. Par exemple, en fournissant le bois et la main-d’œuvre pour finir de reconstruire le toit de la ferme Hamon. Pour l’instant l’étable est encore inutilisable et bêtes et hommes s’entassent dans la même pièce. Ou encore en faisant réparer la maison des Guillerm, qui n’est plus qu’une masure ouverte à tous les courants d’air. — Ma grand-mère ne soupçonnait sans doute pas toute l’étendue des besoins, je lui en ferai part. À l’énoncé de ces rudes conditions de vie, je sentis l’émotion me gagner. Je n’avais jusqu’ici jamais encore imaginé que sur nos propres terres du comté de Tanhouët couvaient pareilles détresses. — Permettez-moi de vous contredire, répondit le recteur, mais je crois qu’elle en avait une idée assez nette, et que c’est justement pour cela qu’elle vous a envoyé ici. C’est une femme de la terre, elle sait les conséquences que peut avoir un hiver rude sur ceux qui en vivent. — Les récoltes ont donc été si mauvaises ? demanda Clément. — Non, pas cette année. Mais on s’inquiète pour celle à venir. Le gel n’a pas encore frappé les cultures, mais cela pourrait venir. Je pensais que le régisseur de Tanhouët vous l’aurait appris. Même en ville on commence à s’inquiéter du prix que pourrait alors atteindre le pain. Certains citadins accusent nos paysans de cacher une partie de leur grain pour eux-mêmes. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’ils aient parfois raison. Tenez, Guillerm, le forgeron, pas plus tard qu’avant-hier il s’est presque battu avec le fils Joncour qui allait porter des sacs de blé au moulin. Heureusement que Jeanne-Marie les a raisonnés, parce que c’est un costaud le père Guillerm. Il parait que Joncour avait affirmé à la fille Guillerm avoir déjà tout vendu quand celle-ci avait voulu lui acheter du grain. — Pourquoi les Guillerm voulaient-ils du grain ? m’étonnai-je. Ils ne sont ni paysans ni négociants. Il est bien plus simple pour eux d’acheter directement le pain ! — Tu n’écoutes donc rien ? s’exclama Clément, une nuance d’impatience dans la voix. Ils veulent se constituer une petite réserve. Réfléchis : si le pain augmente, ils craignent de ne plus en avoir, car il ira majoritairement à ceux qui pourront le payer au prix fort. Alors que s’ils achètent du grain maintenant, ils pourront le conserver et aller le faire moudre. Même en payant l’usage du moulin cela peut leur revenir moins cher, et surtout ils seraient certains d’avoir toujours du pain. — Mon père ne permettrait pas que le blé vienne à manquer à Tanhouët tant qu’il en aura en réserve. — Et s’il le vend à l’étranger ? objecta Clément. — Il ne commerce pas avec les anglais en temps de guerre. D’ailleurs il n’est pas assez fou pour hasarder sa cargaison sur un navire qui risquerait de se faire attaquer lors de la traversée. — Mais sans parler de l’Angleterre, insista encore Clément, il pourrait le vendre à Nantes, ou ailleurs si le prix est meilleur. — En temps normal, sans doute. Pas en période de disette. Son insistance et ses sous-entendus commençaient à m’agacer. Quelle mouche l’avait donc piqué pour qu’il supposât de tels agissements de la part de mon père ? Heureusement l’abbé Hélias apaisa nos esprits quelque peu échauffés. — Votre ami a raison, dit-il alors à Clément. Monsieur le comte n’affamerait pas ceux qui vivent sur ses terres et lui paient leurs redevances. Je le connais depuis assez longtemps pour pouvoir vous affirmer qu’il saura tendre une main secourable à ceux auxquels il doit assistance. Et si cela doit lui moins rapporter, il sait pouvoir se le permettre. — D’ailleurs, continuai-je, s’il reste plus de grain par ici, nos moulins et nos fours fonctionneront plus, donc les redevances associées à leur utilisation combleront en partie la différence. — Je vois, mon fils, que vous avez un certain sens de la charité qui ne perd de vue ni les contingences matérielles, ni l’intérêt particulier, me dit le père Hélias dans un sourire ironique. Après tout, c’est peut-être ce qui fait un bon gestionnaire à défaut d’un charitable chrétien, ajouta-t-il en soupirant. ~ o ~ o~ o ~ Les Guillerm habitaient à l’entrée du village, à côté de la forge. Celle-ci avait été longtemps abandonnée avant qu’un forgeron vînt s’installer à Kertanhouët avec sa femme qui était originaire du village. Dans sa jeunesse elle était partie chercher une autre vie en ville, et était revenue au bercail quelques années plus tard avec mari et enfants. Arrivée devant la porte vermoulue, nous n’eûmes pas le temps de frapper qu’elle s’ouvrit sur une jeune fille de notre âge à l’air rétif mais aux traits tirés. Elle me dépassait d’une tête et plongea son regard las sur moi, puis ses yeux verts se fixèrent juste après sur Cyprien et se durcirent instantanément en le reconnaissant. Puis les coins de sa bouche s’étirèrent en un sourire froid. Elle releva ses cheveux blonds qui s’échappaient d’un bonnet propret mais usé et flottaient jusqu’ici négligemment le long de son dos, tenta de les discipliner puis abandonna et se contenta de les nouer d’un ruban noir. J’eus quelque peine à reconnaître dans ce visage fatigué la fillette vive et délurée avec laquelle nous avions failli nous battre quelques années plus tôt, un soir de Saint-Jean. Même s’il nous était arrivé de la croiser de loin en loin depuis cet épisode, je ne l’avais jamais vraiment revue de si près. Elle avait non seulement grandi, mais aussi vieilli. Plus vite encore que nous, semblait-il. Avant que Cyprien eût ouvert la bouche pour lui offrir l’aide que nous étions venus proposer à sa famille, elle s’adressa à lui du même ton acerbe dont elle avait usé à son endroit trois ans plus tôt. — Que nous vaut donc l’honneur d’une visite de monsieur de Granville par un temps si rude ? — Bonjour Corentine, commença Cyprien. Il me sembla qu’il ne savait trop comment poursuivre. Puis il se lança. — J’ai appris par monsieur le recteur que votre mère était alitée, continua-t-il. J’espère que ce n’est pas trop grave et qu’elle se remettra vite de sa fièvre. — Et c’est donc pour partager nos prières que vous avez parcouru ce chemin depuis Tanhouët dans la neige ? répondit-elle assez froidement. Très touchée. — Soyez assurée que nos prières se porteront vers votre famille pour souhaiter le prompt rétablissement de votre mère, mais c’est autre chose qui m’amène chez vous. — Je m’en doutais. Personne ne s’était déplacé jusqu’ici l’année dernière quand le père est tombé du toit, ni quand mon frère est parti de la grippe il y a deux ans. Alors pas de raison que cette fois-ci… Elle n’acheva pas. Je l’excusais intérieurement de la rudesse de ses paroles, car elle semblait très affectée par la maladie de sa mère. D’autant qu’elle s’en retrouvait maintenant la maîtresse de maison, en sa qualité d’aînée. — Corentine, ferme donc cette porte ! rugit une voix aiguë depuis l’intérieur. Il fait un froid de mort dehors ! C’était Jeanne-Marie, dont l’aide sous ce toit ne devait pas être superflue. À contrecœur me sembla-t-il, Corentine Guillerm se résolut à nous faire entrer. Passées les premières secondes d’éphémère bien-être, il me parut qu’il régnait dans cette maison un froid aussi pénétrant que chez le recteur Hélias. Je pensai furtivement que Jeanne-Marie devait vraiment avoir une santé à toute épreuve, à passer ainsi ses journées au presbytère ou dans la masure des Guillerm. Corentine remettait en place les chiffons qui servaient à calfeutrer le jour sous la porte d’entrée. Mais l’air froid passait également par les fentes verticales du chambranle qui décidément manquait grandement d’étanchéité. Tout en s’affairant, Corentine poursuivait la conversation sur un ton faussement léger. — Qu’y aurait-il pour le service de notre jeune seigneur ? — J’ai pensé… enfin plus exactement ma grand-mère a pensé que par des températures aussi rudes certains habitants des environs pourraient trouver l’utilité de quelques vêtements chauds et couvertures que nous avions en réserve. — Et qui encombrent les armoires de monsieur le comte ? Ce qui est passé d’usage chez lui sera toujours assez bon pour nous… — Oui… Non ! Non, ce n’est pas cela, mais…, s’embrouilla Cyprien. Enfin… il fait bien froid et il serait irresponsable de laisser villageois et paysans souffrir des rudesses de cet hiver quand on a de quoi aider un peu à supporter cette période. Corentine s’attendait apparemment à un plaidoyer plus habile de la part de Cyprien. Elle le fixa sans mot dire. Nous étions toujours auprès de la porte et elle n’avait à l’évidence pas l’intention de nous inviter à pénétrer plus avant. ~ o ~ o~ o ~ Au fond de la pièce, on devinait le lit aux volets clos où madame Guillerm devait dormir malgré le bruit que faisaient les autres occupants de la maison. Les plus jeunes enfants se disputaient un petit cheval en fer que leur père avait dû leur fabriquer, et une fillette plus âgée aux belles boucles brunes faisait doucement osciller un berceau. Le nourrisson qui y dormait poussait de temps en temps un petit grognement dans son sommeil sans pour autant se réveiller. Camille, jadis arracheuse de cheveux aux feux de la Saint-Jean, veillait avec soin sur sa dernière petite sœur sans pour autant négliger la poupée de chiffons qu’elle tenait à la main. — C’est bien gentil de la part de Madame la baronne, dit Jeanne-Marie. C’est vrai que ce sera pas superflu. Ce ne devait pas être l’avis de la fille aînée des Guillerm, car elle la foudroya du regard. — Madame la baronne est trop bonne, dit alors Corentine, mais vous trouverez sûrement ailleurs des personnes dont les besoins en couvertures sont plus urgents que les nôtres. Et je m’en voudrais de dépouiller le château de ses biens ! Elle tournait le dos à Clément et me faisait face avec sur le visage une expression de franche hostilité. L’air las et épuisé qu’elle avait en nous ouvrant la porte s’était complètement effacé de sa physionomie et malgré le ton de sa voix qu’elle s’efforçait d’adoucir, je sentais que notre présence sous son toit lui déplaisait fortement. Toutes les autres familles dans lesquelles nous nous étions rendus au cours de la journée nous avaient accueillis à bras ouverts, allant jusqu’à nous offrir un verre de leur meilleur vin ou de leur meilleur cidre – ce qui nous avait réjoui considérablement de visite en visite en plus de nous réchauffer – mais cette fois l’accueil était bien moins jovial et doucha notre bel enthousiasme. Le forgeron était absent, sa femme alitée, et la fille aînée n’était visiblement pas des mieux disposée à notre égard. Heureusement, Jeanne-Marie était là pour amortir le contact et semblait ne pas se rendre compte du déplaisir que notre simple présence causait à Corentine. Sans la servante du recteur, je crois bien qu’elle nous aurait tout simplement mis à la porte de chez ses parents. — Dis pas n’importe quoi, Tine ! Bien sur que ces couvertures seront bienvenues, affirma Jeanne-Marie. Et puis si vous aviez des vestes pour les petits, aussi… Corentine haussa les épaules et sembla se désintéresser de la question, puisque Jeanne-Marie avait pris les choses en main. Elle tournait ostensiblement le dos à Clément auquel elle n’avait pas une seul fois adressé la parole, et entreprit de balayer par terre. — Bon alors, qu’est-ce que vous nous avez là ? demanda Jeanne-Marie. — C’est dehors, indiqua Clément. Il ne reste plus beaucoup de vêtements d’enfants, parce que nous sommes passés chez les Bourhis, et chez les Salaün aussi, alors vous comprenez… — Mais nous avons encore des vestes d’adulte qui peuvent être rétrécies ou même recoupées à la taille des petits, dis-je en guise d’excuses. À ce moment, la jeune Camille se retourna vers nous un doigt sur la bouche, et fronçant les sourcils avec sévérité elle me fit signe de faire moins de bruit. Puis elle tourna la tête vers Clément et se mit à le dévisager avec curiosité. Elle sembla sur le point de lui parler, mais Jeanne-Marie la prit de vitesse. — Amenez-moi tout ça, mon garçon, dit-elle à Clément. Pendant qu’il allait chercher ce qu’il restait de vêtements, je m’approchai de Camille et du berceau sur lequel s’était reportée son attention. — Bonjour, lui dis-je doucement. — ‘jour, répondit-elle sans me regarder. — Tu as une jolie poupée, poursuivis-je histoire de dire quelque chose. Pas de réponse. — Elle a de jolis cheveux noirs et bouclés, comme les tiens. Pas de réponse. — Comment s’appelle-t-elle ? Une question directe. Cette fois elle serait bien obligée de répondre quelque chose. — Tine, dit-elle de mauvaise grâce. — Comme ta grande sœur ? Elle ne lui ressemble pourtant pas ! Regarde, dis-je en lui montrant les boutons marron qui lui servaient d’yeux et les bouts de laine noire qui lui tenaient lieu de chevelure. Elle aussi haussa les épaules et s’absorba dans la contemplation de sa petite sœur emmaillotée. Avec ses yeux sombres, ses cheveux noir de jais et son visage blanc comme un lys, cette petite Camille me faisait décidément penser à la princesse au teint blanc comme neige et aux cheveux d’ébène d’un récit bavarois lu dans notre enfance. À la différence que cette petite n’était pas une princesse et qu’elle vivait dans un monde bien réel. ~ o ~ o~ o ~ Pendant que Jeanne-Marie passait en revue les vêtements, je tentai d’engager la conversation avec Corentine, malgré la mauvaise volonté qu’elle semblait mettre à me parler. Elle avait mon âge et, tandis que son père était parti travailler, se retrouvait en charge de ses jeunes frères et sœurs, de sa maison et d’une mère malade. Elle m’émouvait. Je ne parvenais à me sortir de l’esprit l’air de lassitude extrême qu’elle avait lorsqu’elle nous avait ouvert la porte, ainsi que les stigmates que la fatigue avait laissés sur son visage. Ses traits tirés, ses joues creusées, ses yeux enfoncés, tout cela était bien loin de la fillette vive et agile de mon souvenir. En jetant un œil du côté du lit qu’occupait la malade, je ne pouvais non plus m’empêcher de me rappeler l’agonie de ma propre mère, deux ans auparavant, emportée elle aussi par l’hiver. — Je souhaite de tout cœur que votre mère se rétablisse dans les meilleurs délais, et que des temps plus heureux brillent sur votre maison. Je… je demanderai à la baronne de faire envoyer le médecin. Rassurez-vous, vous n’aurez aucun frais. Elle me foudroya du regard. Je me mordis la lèvre, mais il était trop tard. Je venais de faire preuve d’une maladresse extrême envers cette jeune fille fière et susceptible au plus haut point. — Elle ne vous a pas attendu pour le faire, répondit-elle sèchement. Vous l’ignoriez ? Mais un médecin ne peut faire plus que ce qui est en son pouvoir. Sans quoi votre propre mère serait encore là, n’est-ce pas ? Elle avait dit cela avec une agressivité non feinte, et pendant une seconde, je ressentis l’envie furieuse de la frapper, de lui occasionner un mal aussi douloureux que celui qu’elle venait de m’asséner par ses paroles. Heureusement ce sentiment me passa vite et laissa juste place à l’incompréhension la plus totale. Que lui avais-je donc fait pour qu’elle se montrât aussi agressive et blessante envers moi ? Je ne demandais qu’à lui apporter mon aide, mon soutient, et elle me traitait en retour avec une telle rudesse, une telle de dureté ! Étrangement, elle faisait tout pour se faire haïr, et pourtant je ne parvenais pas à la détester. Ses yeux si clairs qu’ils en étaient presque transparents me mettaient mal à l’aise mais ses longs cheveux blonds semblaient capter la lumière du feu tremblotant dans le fond de l’âtre, et leur vue me réchauffait le cœur et le corps. Le ruban s’était dénoué et elle avait négligé de les rattacher. Dès qu’elle bougeait, les longues mèches ondoyaient derrière elle, renvoyant encore plus de lumière, donnant de la vie à ce visage qu’elle voulait pourtant fermé et buté. Du fond de la pièce, j’entendis sa mère remuer dans son lit et Corentine tourna la tête. — Maman ? Excusez-nous, nous vous avons réveillée. Avez-vous besoin de quelque chose ? — De rien, mon ange, répondit une voix faible et ensommeillée. Je te remercie. Juste de dormir. Et tout à coup, en entendant cette voix maternelle, je me mis à envier cette fille. Elle avait encore sa mère, elle avait encore un père, elle avait quatre frères et sœurs, elle avait encore une famille. Et elle s’en prenait à moi, qui n’avais jamais connu mon père, qui n’avais plus de mère depuis deux ans déjà. Elle ne mesurait pas la chance qu’elle avait d’entendre encore la voix de la sienne lui parvenir, là, à cet instant, d’aussi près. Mais je lui pardonnais. Je connaissais la douleur de l’inquiétude et de l’incertitude. Je connaissais cette peur de perdre ceux qui nous sont les plus proches, et je savais combien elle pouvait rendre sourd aux attentions d’autrui. ~ o ~ o~ o ~ La petite Camille était retournée à son mutisme buté, et sa sœur aînée semblait elle aussi avoir brisé net la tentative de conversation que Clément avait entreprise auprès d’elle. La malade s’était réveillée et Corentine lui apportait ses soins. Camille en profita pour dévisager Clément qui regardait en direction de Corentine et sa mère. Quittant le chevet du bébé, la petite fille se releva et fronça les sourcils, semblant en proie à une intense réflexion. — Dis, est-ce que c’est vrai que ton père était charpentier ? lança-t-elle soudain en direction de Clément. Celui-ci parut surpris. Il tourna la tête vers elle en haussant les sourcils, l’air étonné. — Oui, répondit-il enfin, c’est vrai. Pourquoi cette question ? ajouta-t-il après une courte pause. — Moi, mon papa, il est forgeron, précisa-t-elle. Mais moi j’habite pas dans un château. Clément ne répondit rien. Parce qu’il n’y avait rien à répondre. Corentine se retourna prestement vers sa sœur. — Lui, il est domestique, lui dit-elle vivement. Je vis Clément rougir. Je ne parvenais pas pour ma part à le considérer comme tel, pourtant c’était objectivement ainsi que devaient le percevoir les étrangers au manoir. Et c’était d’ailleurs probablement ce qu’il allait devenir. — Mais tu sais lire, insista la gamine auprès de Clément. Je sais, je t’ai vu. Et tu sais te battre à l’épée. Et tu sais plein d’autres choses aussi. Moi je sais pas faire tout ça. Ni mes frères. Ni ma sœur. — Cesse d'importuner nos invités, Camille, lui lança sa sœur d’un ton sec. Nos histoires ne les intéressent pas… Vos présents seront sans doute tout à fait utiles, nous dit-elle d’un ton radouci, mais finalement j’aurais préféré une robe de bal… Je souris intérieurement en tâchant d’imaginer ce qui avait pu tenir lieu de robe de bal à ma pauvre grand-mère dans sa jeunesse, elle qui n’avait pour ainsi dire jamais mis les pieds en ville jusqu’à ce qu’elle vienne habiter avec nous et était toujours sobrement vêtue même lors des rares réceptions que donnait mon père. Sa garde-robe avait tout de celle d’une paysanne aisée, à l’exception peut-être de quelques tenues plus élégantes qu’elle réservait pour les occasions festives. La jeune Corentine ne semblait pas se faire une idée très nette du genre de vie que nous menions à Tanhouët. — Une robe de bal ne vous tiendrait pas très chaud ces jours-ci, fit remarquer assez inutilement Clément. — Elle m’aurait toujours réchauffé le cœur, répondit la jeune fille. Elle semblait légèrement mieux disposée envers Clément et envers nos présents que précédemment. Elle perdit même le ton acerbe dont elle avait usé jusqu’ici pour s’adresser à moi. — Vous remercierez madame la baronne pour cette attention délicate, dit-elle en se choisissant un large jupon de laine bleue rehaussé d’un galon noir brodé de motifs aux couleurs vives, un peu râpé mais tout de même encore présentable. — Il me paraît être à votre taille, remarqua Clément. Vous êtes plutôt grande pour votre âge, il vous ira bien. Elle baissa les yeux vers les siens comme si elle s’apprêtait à lui dire quelque chose, mais au lieu de cela elle appela sa sœur. — Camille ! Viens choisir quelque chose ! Il y a là des lainages, des manteaux, des gilets aussi ! Je te montrerai comment les reprendre à ta taille. Mais viens donc, insista-t-elle, voyant que sa sœur ne bougeait pas du chevet du berceau. — Non merci, je n’ai besoin de rien de ce qu’il y a là. — Viens choisir, dis-je à mon tour, tu peux prendre ce que tu veux ! — Y’a rien que j’veux, là dedans. — Et ta poupée, demanda Clément, elle n’a pas froid comme cela ? Si tu lui choisissais une écharpe par exemple, elle serait bien emmitouflée pour affronter l’hiver… — Elle est bien comme ça. Elle préfère. — Bon, dit Corentine, quand elle est comme ça, il n’y a rien à en tirer. Et puis peut-être qu’elle aussi aurait préféré une robe de bal, ajouta-t-elle dans une esquisse de sourire en lui mettant de coté un châle frangé en laine beige. — J’veux pas aller au bal ! Décidément, pensai-je alors, si elles étaient physiquement très dissemblables, les deux sœurs se ressemblaient sur bien d’autres points. Encore que l’hostilité de l’aînée semblât dirigée particulièrement à l’encontre de Clément, pour une raison que je ne m’expliquais pas, tandis que c’était plutôt sur moi que Camille dirigeait la plus grande partie de la sienne, sans que je comprisse non plus ce que j’avais bien pu faire qui la suscitât.
Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France)
Dernière édition par Hetep-Heres le Dim 11 Aoû 2013 - 13:35, édité 1 fois |
|   | | Hetep-Heres
L'ami de la rose


Age : 45
Nombre de messages : 284
Date d'inscription : 22/09/2012
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  Dim 11 Aoû 2013 - 13:28 Dim 11 Aoû 2013 - 13:28 | |
| Commentaire sur la fic:ici Chapitre XIII : Le jonc d’or Les grands froids que nous avions craints pour l’hiver 1780 n’arrivèrent pas, et après une quinzaine glaciale, les températures remontèrent à un niveau plus habituel. Les précautions prises par la baronne pour venir en aide aux villageois ne furent pourtant pas inutiles, tant certaines familles étaient mal armées pour affronter même un hiver normal. Mais le gel si redouté n’arriva pas et le grain se maintint sensiblement au même prix que les années précédentes. Au cours de l’année qui suivit, nous eûmes Cyprien et moi de sérieuses inquiétudes au sujet de l’éventualité d’être séparés, car nous surprîmes plusieurs fois des conversations entre le comte et la baronne évoquant le possible envoi de Cyprien dans un collège. Son père semblait regretter le choix qu’il avait fait précédemment de le maintenir à Tanhouët et de faire assurer son instruction par un précepteur. — Vous n’ignorez pas, mère, l’importance que j’accorde à l’instruction, et si Cyprien doit un jour devenir conseiller au Parlement de Rennes, je ne saurais tolérer qu’il s’y montrât médiocre. Or il est à craindre que les autres jeunes gens aient eux effectué une bonne part de leur scolarité au collège. Je ne veux pas qu’ils se permettent de dédaigner mon fils, voyant en lui un hobereau campagnard qui n’aurait peut-être pas reçu une instruction aussi poussée que celle qui leur aura été dispensée par les professeurs du collège. — Moi qui vous pensais suffisamment libre dans vos décisions et vos choix pour n’accorder que fort peu de place à ce qu’en penserait autrui ! Par le passé vos prises de position ont toujours été en accord avec vos principes, même si elles vous valaient l’opposition voire l’animosité de certains de vos pairs. Il y a quelques années encore, vous et certains de vos collègues n’avez pas hésité à défier une fois de plus le Roi. Un homme capable de ce genre de choses ne doit pas craindre ce que de jeunes étudiants pourraient dire de son fils… — Cela n’a rien à voire. Il s’agissait alors de politique, et non de la qualité de l’instruction de Cyprien. — Mais il s’agit toujours de politique, n’est-ce pas ? Maintenant que les collèges ne sont plus tenus par les jésuites, vous êtes prêt à y envoyer votre fils… — Mère, je vous ferais remarquer que les collèges jésuites ont été fermés avant même sa naissance ! Et quand bien même ils auraient encore été en activité, je n’aurais pu y envoyer Cyprien tout en soutenant le procureur général dans sa demande d’une réforme de l’instruction ! Il y aurait eu là une incohérence que l’on n’aurait pas manqué de relever. Que moi, en tout cas, j’aurais relevée. Et je préfère toujours rester en accord avec mes choix. — Justement, vous aviez choisi de garder Cyprien ici, à Tanhouët. Pourquoi brusquement cette lubie de l’envoyer au collège ? Les leçons de Monsieur Cloarec ne vous agréent-elles plus ? — Disons que je pensais peut-être au début qu’elles seraient suffisantes, mais le fait est qu’il s’agit d’un précepteur à l’ancienne mode, et que je souhaite une instruction un peu plus… un peu plus élargie pour mon fils. — Ah, c’est donc cela, vous trouvez que ce n’est pas assez moderne ! — Vous prononcez ce mot avec un tel mépris ! — Comprenez-moi bien : ce n’est pas de la modernité dont je me méfie, mais de votre recherche effrénée de celle-ci, ainsi que de votre promptitude à dédaigner ce qui n’en relève pas. — Madame, vous et moi sommes presque de la même génération, et pourtant vous semblez parfois trouver plaisir à vous obstiner dans les habitudes de nos parents et de nos grands-parents. — Croyez-vous donc que tout soit à rejeter dans ce qu’ils faisaient ou disaient ? Tout citadin que vous soyez devenu, vous êtes et resterez un homme de la terre, comme l’étaient mes ancêtres. Vous connaissez donc le rythme des saisons et savez qu’il est immuable, malgré les générations qui se succèdent et les discours des hommes. Il est des choses qui demeureront, telles les marées et la succession des saisons, et ce n’est pas parce tel ou tel écrira que l’océan est immobile que les vagues l’écouteront et disparaîtront. — Je vous en prie, ne m’accusez pas de prendre pour parole d’évangile n’importe quel écrit sous prétexte de nouveauté. Je suis homme de raison et c’est cela-même qui m’amène à écouter mes contemporains. Ce n’est pas pour autant que j’applaudis à tout ce qui se dit ou s’écrit ces temps derniers, vous le savez bien. — En attendant, vous vous préparez pourtant à reléguer aux antiquités le pauvre Monsieur Cloarec pour lui préférer les collèges à la nouvelle mode. — Mère, voyons, cela fait plus de deux ans que Cyprien étudie avec son précepteur. Je me suis accordé suffisamment de temps pour juger en toute objectivité l’enseignement qu’il dispense, et si mon jugement était aussi arbitraire que vous le supposez, il y aurait déjà longtemps que Cyprien serait élève au collège. Je vous rappelle que cela fait maintenant quinze ans qu’ils ne sont plus tenus par le parti jésuite. — Bien sûr, mais dans les premiers temps, il a fallu tout réorganiser, trouver des professeurs, des administrateurs, et cela laissait craindre des scolarités assez chaotiques. J’en sais quelque chose, mon fils y était alors encore élève. Mais plus pour longtemps car, j’ai honte à l’avouer mais nous avons peiné à nous acquitter des frais que cela occasionnait. En effet, vous semblez n’en pas faire grand cas, mais votre soi-disant avancée éducative a finalement fait reculer bien des choses puisque, je vous le rappelle, l’instruction des pères jésuites était gratuite tandis que ce n’est plus le cas des collèges d’aujourd’hui. Tant de familles ne peuvent maintenant plus se permettre d’y envoyer leurs fils… Beaucoup de gentilshommes devront à l’avenir se contenter d’une instruction plus sommaire, voilà où mènent vos réformes. Cela me fait bien de la peine d’aboutir à mes conclusions en usant des arguments de vos détracteurs, mais il me semble parfois que sous couvert de défense contre l’oppression monarchique ou autre, vous ne protégiez finalement que les intérêts des plus privilégiés par la situation actuelle, dont vous êtes ! — Mère, pour quelqu’un qui ne s’intéressait guère à la politique il y a encore quelques années, vous me semblez bien informée de ce qui se dit à Rennes ou même à Versailles ! — Que voulez-vous, quand on vit sous le toit d’un membre du Parlement, on finit par être au courant des remous causés par toutes ces affaires, même ici, à Tanhouët. De plus je vous apprendrais qu’ici l’on est un peu mieux qu’à Rennes au fait de ce qui se dit dans les campagnes : tout bon gestionnaire que vous soyez, tout bienveillant que vous vous montriez, méfiez-vous qu’un jour tous vos paysans qui pour l’instant vous apprécient et vous louent n’aient finalement le sentiment d’être les laissés pour compte de toute cette frénésie de modernité qui semble s’emparer des bourgeois et gentilshommes citadins. — Qu’entendez-vous par là ? — Que si Cyprien reste à Tanhouët, il ne perdra de vue ni d’où il vient ni qui il est. Car il deviendra certes un de ces messieurs du Parlement, mais il sera toujours également un homme de la terre, qui devra connaître aussi bien le calendrier des semailles et des moissons que les lois du royaume et les coutumes des provinces. — Se serait-il passé sur mes terres un évènement qui m’aurait échappé ? La disette ne menace pas, les redevances sont payées régulièrement, le four banal a été réparé… que me reprochez-vous donc ? — Rien de tout cela, l’entretien des biens et des chemins n’est en rien négligé, mais il s’agit de quelque chose de bien plus général que cela. De plus latent, aussi. De plus diffus. Je n’arrive pas vraiment à mettre de mots dessus, mais… j’ai peur que l’on ait l’impression que vous ne connaissez plus aussi bien vos gens, ici. Certaines familles sont dans une situation plus préoccupante que vous ne semblez le croire, et si la famine ne menace en rien sur vos terres, certaines difficultés s’y sont tout de même répandues. Et avec elles, le mécontentement, d’autant que vous êtes très souvent absent, à Rennes ou en voyage. — Force m’est de reconnaître que du temps où le roi avait supprimé les parlements, j’étais bien plus présent et mieux au fait des petits évènements des environs. Mais monsieur Mahé est un excellent régisseur dont je n’ai jamais eu à me plaindre, il me fait de fréquents rapports précis et détaillés et je suis certain que la gestion des terres de Tanhouët n’a pas à souffrir de mes absences. — Dans les faits, non, en effet. Mais dans les cœurs, ça ne remplace pas … C’est pour cela que moi-même, je me rends plusieurs fois par an sur les terres de la baronnie de Tévinou rencontrer les fermiers dont je continue de m’informer tout au long de l’année. D’ailleurs sur ce point, je ne peux que me féliciter de vous avoir confié la gestion de mes terres. Vous et monsieur Mahé y avez effectué un travail exceptionnel, qui a permis d’améliorer les revenus de la terre pour moi et pour mes fermiers. Soyez-en remercié. — Vous avez décidément le don d’accompagner vos critiques de louanges, et inversement. Vous me rappelez par certains côtés cette chère Lucie Guermeur, encore qu’elle n’eût pas combattu l’idée d’envoyer Cyprien au collège. C’était une femme pragmatique qui sur certains points savait s’ouvrir à la nouveauté. — Nous savons tous le faire, mon cher, mais pas toujours sur les mêmes sujets, voilà le cœur de nos petites querelles. Mais pour en revenir à Cyprien, je continue de penser que ce serait une erreur de l’envoyer loin d’ici. — Dites plutôt que vous vous êtes attachée à votre petit-fils et que vous souhaitez le garder auprès de vous, ce que je ne vous reproche pas. Mais il faut d’abord penser à son avenir. — C’est un enfant attachant, je le reconnais, et j’aurais peine à le voir partir. Mais nos enfants sont faits pour nous quitter un jour ou l’autre, je le sais mieux que personne. Aussi n’est-ce pas par égoïsme que je vous conseille de le maintenir ici, mais bien parce que, comme je vous l’ai dit, il y a autant à apprendre ici qu’en ville. — Disons plutôt qu’il y a des choses différentes à apprendre. Et il connaît déjà bien celles d’ici. Il continuera son apprentissage des choses de la campagne lors de ses séjours à Tanhouët, il n’est pas question de l’exiler, mais il doit aussi dès maintenant apprendre ce qui sans cela risquerait de lui faire défaut dans sa vie future. En quelques mots, un futur conseiller au parlement ne doit pas se contenter d’être un gentilhomme en sabot sachant à merveille le latin et la géométrie. Il doit aussi connaître les techniques nouvelles et les derniers courants d’idées afin de se forger lui-même ses opinions. — Que vous espérez proches des vôtres… — Si je ne les pensais pas bonnes, ma chère amie, je ne les aurais pas faites miennes… — Une logique à toute épreuve, je le reconnais, mais qui ne prend pas en compte le fait que ceux qui ont les opinions totalement opposées les adoptent pour la même raison. — Reste donc à inventer un système de pensée universelle…, conclut le comte dans un sourire. ~ o ~ o~ o ~ Nous nous étions dissimulés sous les fenêtres ouvertes du salon, côté extérieur, pour espionner cette inquiétante conversation. Ce que j’en retirai, hormis un intérêt insoupçonné de ma grand-mère pour la chose politique, était que je risquais fort d’être envoyé en pension au collège de Rennes, séparé de Clément la majeure partie de l’année. Une perspective difficilement envisageable pour nous, mais dont mon père ne semblait pas s’inquiéter. Nous avions déjà treize ans et peu à peu approchait le temps où Clément et moi ne pourrions vivre plus longtemps comme les simples camarades de jeu que les habitants de cette maisonnée avaient faits de nous. Je savais depuis toujours qu’arriverait le moment où nos chemins, sans totalement se séparer, suivraient des voies différentes : j’étais un gentilhomme, il était le fils de la nourrice. Nos avenirs nous attendaient, ou plutôt ils commençaient à dangereusement se rapprocher de nous et de notre adolescence. Cette possible rupture de notre mode de vie, de cette existence en doublet que nous nous étions construite me terrifiait. J’y tenais plus que tout. Et pourtant c’était un des privilèges auxquels mon rang ne me donnait aucun droit. Le bien que j’aurais pourtant voulu plus que tout conserver. Et il allait m’échapper. Le temps allait me l’enlever, comme promis depuis toujours. Nous le savions depuis le début, confusément d’abord, plus précisément par la suite. Cette relation, cette dualité dont j’avais fait l’axe principal de ma vie allait devoir s’effacer. Inexorablement. Même si j’en étais conscient depuis toujours, ce n’avait été jusqu’alors qu’une échéance lointaine et donc encore très floue. À un point tel qu’elle en avant paru presque irréelle à force d’être intangible. Et cela devenait soudain une perspective redoutablement proche. J’en reçus un coup au cœur. Une oppression sur la poitrine. J’en eus presque quelque peine à respirer jusqu’à la fin de la journée, et même lorsque je me couchai le malaise était toujours là, désagréable, presque physiquement douloureux. Je me sentais plus mal encore que le jour où Lucie mourut. Oui, jamais encore je ne m’étais senti si mal. Jamais encore je n’avais eu aussi peur du lendemain. Jamais encore je n’avais autant souffert en mon cœur, en ma poitrine. Jamais encore… Dans les semaines qui suivirent, il ne fut plus question de collège entre mon père et ma grand-mère. À l’affût, je tendais l’oreille à la moindre de leurs conversations, mais il n’y était question que de sujets plus quotidiens, plus anodins. Bien entendu, Jean-Baptiste m’aidait dans ce travail de renseignement en me rapportant le moindre fait remarqué, le moindre mot entendu dans la maison ou au dehors. Rien. Ce qui atténua ma détresse, mais pas mon inquiétude. Puis, à force de ne plus en entendre parler, je conclus que le projet avait été abandonné. Et nous pûmes nous consacrer à d’autres sujets de réflexion. Ma grand-mère avait par exemple beaucoup changé depuis son arrivée parmi nous, plus de deux ans auparavant. Elle semblait être devenue plus gaie, s’intéressait aux nouvelles venues d’en ville ou même de la Cour, lisait les gazettes que mon père nous faisait envoyer de Rennes, devenait plus critique aussi vis-à-vis de certaines décisions de mon père. Pour reprendre les mots de Clément, on eût dit qu’elle s’enhardissait. Elle ne serait pas allée bien entendu jusqu’à remettre en cause l’autorité de mon père sous son propre toit, mais n’hésitait plus à émettre des réserves ou des avis contraires aux siens. Ce qui, contre toute attente, ne semblait d’ailleurs pas déplaire à mon père. Il paraissait même satisfait d’avoir retrouvé une personne avec laquelle débattre depuis la mort de Lucie. En somme, ma grand-mère était presque devenue une autre femme depuis quelques temps, sauf envers nous, ce qui nous comblait : elle nous laissait de plus en plus vagabonder ou vaquer à nos occupations sans que nous ayons à lui rendre de comptes, tout en restant envers nous un trésor de douceur. Toutefois, l’horizon de ses critiques atteignait aussi quelquefois notre comportement lorsqu’elle le jugeait trop égoïste ou trop puéril. Pour résumer, elle nous laissait agir à notre guise tant que nous ne nous comportions pas en enfants gâtés. Autre changement dans les habitudes de la maisonnée, mon père, peut-être influencé en cela par ma grand-mère, se prit à fréquenter avec un peu plus d’assiduité les festivités paysannes lors de ses séjours à Tanhouët. De même, il lui arriva de donner quelques réceptions et de se rendre à celles données par des seigneurs voisins, tel le vicomte de Pléro dont le manoir était situé à quatre ou cinq lieues de chez nous. Mon père paraissait s’intéresser un peu plus qu’auparavant aux mondanités rurales, redécouvrant par là même qu’il existait une société hors les murs du palais du parlement, tandis que ma grand-mère semblait être enfin sortie de son deuil pour trouver un regain de jeunesse et d’allant. Un soir qu’ils se rendaient tous deux à une fête donnée par la comtesse du Cosquer, quelques temps après les Pâques, nous eûmes Clément et moi l’occasion de constater une fois de plus cette petite métamorphose. Tandis que mon père avait revêtu une tenue des plus élégantes, ma grand-mère avait, elle, abandonné la sobriété de ses toilettes habituelles pour porter une robe couleur myosotis, d’un style certes désuet mais d’une fraîcheur inaccoutumée. Elle avait même poussé jusqu’à relever sa toilette de bijoux moins austères qu’à l’ordinaire. À la place de l’habituel et discret sautoir en argent resplendissait un collier de perles ivoire. À ses oreilles pendaient deux topazes bleues tandis qu’à son majeur droit scintillait la bague assortie à ces boucles. À son poignet droit étincelait le bracelet complétant cette parure or et azur tandis qu’autour du gauche s’enroulait un bracelet d’or ciselé rehaussé de deux perles. Dans ces atours, ma grand-mère semblait rajeunie et il se dégageait d’elle plus de légèreté qu’à l’ordinaire. En face de moi, Clément lui aussi parut remarquer cette petite transformation, puis je le vis s’approcher et porter son attention vers la main gauche de ma grand-mère. Il se raidit et je regardai à mon tour : le bracelet figurait un serpent d’or s’enroulant autour du poignet et dont les yeux étaient figurés par deux perles blanches nacrées. Je fronçai les sourcils, fouillant ma mémoire. Je n’eus pas à fournir de gros efforts de concentration pour me rappeler ce que ce bijou m’évoquait : il était à l’image de la bague que Clément et moi avions trouvée dans le jardin quelques années auparavant… Ainsi donc c’était à ma grand-mère qu’appartenait cet anneau ! Pourquoi donc mon père ne nous l’avait-il pas tout simplement dit ? Et s’il le lui avait rendu, pourquoi ne le portait-elle pas à la main gauche en complément de la parure ? À moins qu’elle ignorât que la bague ait été retrouvée… Dans ce cas, pourquoi mon père le lui aurait-il caché ? Décidément, ce bijou ne cessait de susciter sans cesse en nous de nouvelles interrogations. Soudain, Clément me saisit par le bras et m’entraîna vers l’escalier, prenant sommairement congé et souhaitant une bonne soirée à mon père et à ma grand-mère. Un peu surpris, je l’imitai et gravis à sa suite les marches quatre à quatre. Il m’entraîna ainsi jusqu’au dernier étage, où au lieu de bifurquer vers sa chambre il pénétra dans le grenier. Je le suivis et le vis déplacer quelques sacs avant de s’atteler à faire glisser de côté une vieille armoire de toilette bien trop lourde pour lui tout seul. — Viens m’aider, m’exhorta-t-il. — Mais enfin à quoi joues-tu ? — Viens, te dis-je, et tu verras… Quelque chose à vérifier… Alors je vins. Poussant tous deux côte à côte, soufflant, haletant, conjuguant nos efforts, nous parvînmes à déplacer le meuble d’une demi toise sur le côté, découvrant une forme haute et rectangulaire adossée au mur et recouverte d’un drap poussiéreux. Reprenant haleine, Clément retira ce drap et découvrit ainsi quelques grands tableaux, face contre le mur. Je savais déjà ce qu’ils représentaient. Nous retournâmes le premier : il s’agissait du portait en pied d’un jeune homme en uniforme. Ce même jeune homme dont l’aspect m’avait semblé dégager quelque chose de familier lorsque que je le découvris au cours de l’hiver précédent. Mais ce n’était pas ce qui semblait présentement intéresser Clément. Il me demanda de l’aide pour retourner le deuxième : il s’agissait du portrait de la jeune fille blonde en robe jaune qui nous avait déjà frappé par la douceur qui s’en dégageait. Clément se pencha sur le tableau au niveau de la main, l’examina une seconde ou deux et se releva en s’écriant : — Je le savais ! Que savait-il donc ? Il pointa son doigt au poignet du personnage. — Là, tu vois ? Là, il y avait un bracelet d’or et de perles. Pas n’importe quel bracelet. Un bracelet très semblable à celui porté par ma grand-mère ce soir-là. Plus que très semblable. C’était tout simplement le même. Le bijou porté par le modèle du portrait à l’époque où il fut peint se trouvait en ce moment même, des années plus tard, autour du poignet de ma grand-mère. — Quand je l’ai vu tout à l’heure, reprit Clément, cela m’a rappelé quelque chose. Et en quelques secondes je me suis souvenu du détail de ce tableau. Et regarde, là ! Là, c’était cette fois un peu plus bas, au doigt de la jeune fille : un anneau d’or et de perles. Malgré le soin de l’artiste, les détails en étaient assez flous étant donné la petite taille de l’objet, mais au vu de l’autre bijou, il n’y avait plus aucun doute : la femme du portrait portait à un doigt la bague que Clément et moi avions trouvée trois ans auparavant enfouie dans le sol du parc. Ce détail ne nous avait alors pas frappés de prime abord lorsque nous découvrîmes ce portrait, mais je ne voyais à présent plus que cela. D’un coup de coude, Clément appela mon attention et me montra les pendants d’oreille de la jeune fille : ce que nous avions tout d’abord vu comme un ruban d’or vrillé figurait en fait un serpent enroulé autour d’un axe invisible et dont la tête arrivait au niveau de la mâchoire de la jeune femme. Et bien entendu, les yeux du serpent étaient imités par deux minuscules perles blanches. Ces boucles étaient aussi fines que la bague, et le peintre n’en avait pu reproduire tous les détails, mais pour qui avait identifié le bracelet et l’anneau, il n’était pas difficile de reconnaître que ces pendants d’oreilles complétaient la parure de bijoux. Nous avions retrouvé la trace du bracelet et de la bague, sans connaître pour autant leur cheminement depuis l’époque du portrait, mais qu’était-il donc advenu des boucles d’oreilles ? Étaient-elles également dans la boîte à bijoux de ma grand-mère ? Mais avant cela restait une autre question à élucider. Je pensais presque à coup sûr en connaître la réponse, mais j’avais besoin de certitudes. — Attends-moi ici, dis-je à Clément. ~ o ~ o~ o ~ Je restai seul face à ce portrait en réfléchissant à la découverte que nous venions de faire et aux nouvelles questions qu’elle soulevait. Mais surtout, je me demandais maintenant comment il se faisait qu’elle ne nous eût pas sauté aux yeux la première fois que nous vîmes ce portrait. Cela faisait donc deux mois que nous avions retrouvé la piste de l’anneau dont notre découverte avait semblé tant troubler le comte, et nous ne nous en rendions compte que maintenant. À présent je ne pouvais détacher mon regard de la représentation de cette bague au doigt de l’inconnue qui n’était assurément pas la baronne mais portait au moins l’un de ses bijoux. Cyprien avait jailli hors du grenier, saisi d’une lubie subite qu’il n’avait pas cru bon de me faire partager. J’entendis bientôt des pas gravir l’escalier et une voix ronchonner sans arrêt. — C’est que, je n’ai pas que ça à faire, moi, monsieur. Et ma cuisine, qui c’est qui va la ranger pendant ce temps ? Ça ne peut vraiment pas attendre ? — Juste une minute, Soazig, je t’en prie ! Ça ne prendra pas plus que cela, et j’ai besoin de savoir ! — Je viens, j’arrive, mais pas si vite, par pitié. C’est que je n’ai plus vingt ans, moi, Monsieur Cyprien ! — Allez, arrive donc, Soazig. Et parle moins, tu auras plus de souffle pour monter ! Cyprien apparut alors dans l’encadrement de la porte, se retourna vers l’escalier et attendit. Enfin, la cuisinière arriva en haut de l’escalier et ils entrèrent tous les deux dans le grenier. — Que venez-vous donc faire ici tous les deux ? Et à une heure pareille, en plus, trouva-t-elle le temps de s’exclamer en reprenant haleine. Brrr ! Fait un froid de messe ici ! Cyprien tendit le bras vers le tableau. — Regarde, dit-il à Soazig. Elle fronça un sourcil. — Ça alors ! J’ignorais que ça avait atterri ici. — Sais-tu de qui il s’agit ? l’interrogea Cyprien. — Vous… vous l’ignorez ? s’étonna-t-elle. — Qui est-ce ? répéta Cyprien. — Je… euh… Dans ce cas… ce n’est sans doute pas à moi… Si monsieur le comte n’a– — S’agit-il de ma mère ? lança Cyprien d’un ton sec, d’une voix qui ne trembla pas. Apparemment, Soazig n’osa formuler la réponse à haute voix, mais fit de la tête un faible signe d’assentiment. Ainsi donc c’était bien cela. Ce portrait était celui de la comtesse, la seconde épouse de monsieur le comte. Je me retournai pour la contempler. Cyprien était en train de faire de même. Soazig ne disait mot. D’un même mouvement nous nous tournâmes vers elle. Sans que nous eussions à formuler la question que nous voulions poser, elle la comprit et y répondit d’une voix faible. — Il était accroché dans le bureau de monsieur le comte, mais après la mort de madame la comtesse il l’a fait décrocher. Il ne supportait plus de voir son portrait aussi réel, grandeur nature. Il disait qu’elle paraissait presque vivante et que ça rendait les choses plus cruelles encore. Sur le moment on s’est dit que c’était juste temporaire, qu’il le remettrait quand ça irait mieux. Et puis on n’y a plus pensé. Au portrait, je veux dire ; pas à madame la comtesse, ça non. J’aurais pas cru qu’il serait comme ça au grenier, au milieu du reste je veux dire. Et tout poussiéreux, ça non. J’aurais plutôt pensé qu’il serait à l’abri dans une malle ou un coffre. — Il faudrait un très grand coffre, lui fis-je remarquer. — Il serait peut-être temps de sortir ce portrait des oubliettes. Je demanderai dès demain à père l’autorisation de le faire accrocher dans ma chambre. Ainsi il ne l’aura pas sans cesse sous les yeux, mais le tableau ne sera pas non plus au milieu des vieilleries… — À moins qu’il ne désire à présent le récupérer, dis-je. On ne sait jamais. Maintenant que le temps a passé… Treize ans… C’est assez long… Enfin je suppose… — Ce serait encore mieux, en effet, répondit Cyprien. Le voir accroché dans le salon… j’aimerais beaucoup cela. Mais je ne sais s’il acceptera. Commentaire sur la fic:ici *** Lady Oscar  Lady Oscar *** Lady Oscar *** :farao: Hetep-Heres  "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) "Caressez longuement votre phrase et elle finira par sourire..." (Anatole France) |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) Sujet: Re: Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire)  | |
| |
|   | | | | Clément et Cyprien, ou les jumeaux asymétriques (titre provisoire) |    |
|
| Page 1 sur 1 | |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
 | |
|